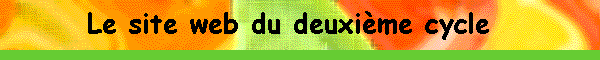
![]()
|
|
|
la mante-religieuse (suite) NOM:Mantis religiosa L (Mante-religieuse)
LIEU: Saint Michel de l'observatoire DATE: Eté 1998 TAILLE:40-75 mm (femelle plus grande que le mâle) DATE D'OBSERVATION: Août à automne dans des endroits ensoleillés. PROIES:Mouches, Guêpes, Criquets, Sauterelles, Abeilles, etc. RÉPARTITION: régions chaudes d'Europe méridionale jusqu'en Pologne, d'Asie et d'Afrique. L'espèce a été entraînée en Amérique du nord et en Australie. La mante religieuse, Mantis religiosa L., doit son nom à la posture caractéristique de ses pattes antérieures, qui évoque assez singulièrement une attitude de recueillement pieux. Paradoxalement, ces membres servent en réalité à capturer et à immobiliser tout insecte qui aurait la mauvaise fortune de se trouver à leur portée. La mante religieuse préconise la chasse à l’affût, stratégie dont l’efficacité est favorisée par une coloration qui lui permet de se fondre avantageusement avec le décor ambiant. Elle se perche dans un état d’immobilité absolue au sommet de plantes dont les fleurs sont susceptibles d’attirer les insectes pollinisateurs, et comme elle fréquente presque uniquement les champs, criquets et sauterelles forment également une proportion importante de sa diète. La mante religieuse atteint sa maturité sexuelle assez tardivement au cours de l’été, de telle sorte que l’accouplement ne survient qu’à la fin du mois d’août et parfois même en septembre. L’issue de l’événement est presque toujours fatidique pour le mâle, beaucoup plus petit que sa partenaire à qui il sert de repas nuptial et ce, durant l’accomplissement même de ses fonctions! Quelles que soient les impressions subjectives que peuvent susciter chez nous de tels comportements, elles s’avèrent injustifiées. En fait, tous les agissements de la mante sont guidés uniquement par l’instinct, ce qui proscrit obligatoirement chez cette dernière toute forme de réflexion ou d’état émotif qui pourrait valider un jugement moral de notre part. Une forme extraterrestre dont on parle depuis longtemps est celle de la Mante Religieuse: grande, noire et ressemblant à un insecte aux dires des humains. Ils n'ont pourtant aucune similitude physiologique avec les insectes de la Terre, et sont en fait une forme d'humanoïdes et des mammifères. Les Mantes Religieuses font partie des centaines de groupes d'extraterrestres qui sont impliqués dans la Transformation de la Terre, mais ils sont peu nombreux. Ils possèdent de remarquables facultés télépathiques qui surpassent celles que nous avons nous, les Zêtas. Les Mantes Religieuses qui entrent en contact avec la Terre en ce moment appartiennent tous au Service-Envers-Autrui. Description : femelle beaucoup plus grande que le mâle ; corps oblong, brun-vert à gris foncé (entre quatre et huit cm de long), thorax allongé ; dix segments abdominaux ; tête petite, triangulaire, très mobile avec corselet large et yeux composés bien développés, saillant, en forme de globes ; antennes insérées devant les yeux ; tache noir du côté intérieur des hanches ; première paire de pattes spécialisée dans la capture des proie, avec hanches libres et mobiles et pointes longues légèrement courbes, au bout des tibias ; les tibias sont beaucoup plus courts que les fémurs ; côtés intérieurs des tibias et fémurs - sauf les genoux - sont épineux ; pieds fins, composés de cinq segments ; les deux paires de pattes de derrière sont longues et relativement minces ; deux paires d’ailes, relativement fines surtout chez les femelles Larves : les différences entre les sexes sont visibles à partir de la troisième semaine après l’éclosion ; environ sept mues au cours de trois mois jusqu’au stade adulte ; premiers efforts de chasse déjà quelques heures après l’éclosion Habitat : Europe centrale et du Sud, Asie, Afrique ; naturalisée dans les États-Unis ; régions sèches au nord, au sud aussi près des lacs, surtout broussailles et plaines herbeuses, parfois au bord des forêts au sous-bois pauvre Alimentation : toute sorte d’insectes, parfois de petits vertébrés ; occasionnellement aussi du cannibalisme ; les larves chassent surtout des pucerons, parfois de petits insectes Comportement : active pendant la journée ; elle chasse surtout aux heures les plus chaudes de la journée, à l'affût sur les végétaux, les pierres ou au sol ; elle saisit la proie avec ses pattes antérieures et l’avale tout de suite ; les femelles adultes sont incapables de voler Reproduction : copulation à partir du printemps, de préférence les jours de grande chaleur, vers midi ; la copulation dure entre deux et trois heures ; ponte à partir de l’été, jusqu’à l’automne ; entre 50 et 300 oeufs placés dans des capsules écumeuses qui sont fixées sur des pierres ou des plantes, le plus souvent sur des herbes ; plusieurs (jusqu’à 10 ou 12) capsules par ponte ; les capsules passent l’hiver, les larves éclosent entre mai et juillet ; entre 40 et 50 pour cent des oeufs non fécondés portent également des larves, mais qui les plus souvent sont très faibles et à peine viables et toujours des femelles. La mante religieuse, Mantis religiosa L., est la seule espèce québécoise d’une famille par contre assez bien représenée dans les tropiques. Elle doit son nom à la posture caractéristique de ses pattes antérieures, qui évoque assez singulièrement une attitude de recueillement pieux. Paradoxalement, ces membres servent en réalité à capturer et à immobiliser tout insecte qui aurait la mauvaise fortune de se trouver à leur portée. La mante religieuse préconise la chasse à l’affût, stratégie dont l’efficacité est favorisée par une coloration qui lui permet de se fondre avantageusement avec le décor ambiant. Elle se perche dans un état d’immobilité absolue au sommet de plantes dont les fleurs sont susceptibles d’attirer les insectes pollinisateurs, et comme elle fréquente presque uniquement les champs, criquets et sauterelles forment également une proportion importante de sa diète. La mante religieuse atteint sa maturité sexuelle assez tardivement au cours de l’été, de telle sorte que l’accouplement ne survient qu’à la fin du mois d’août et parfois même en septembre. L’issue de l’événement est presque toujours fatidique pour le mâle, beaucoup plus petit que sa partenaire à qui il sert de repas nuptial et ce, durant l’accomplissement même de ses fonctions! Quelles que
soient les impressions subjectives que peuvent susciter chez nous
de tels comportements, elles s’avèrent injustifiées. En
fait, tous les agissements de la mante sont guidés uniquement
par l’instinct, ce qui proscrit obligatoirement chez cette
dernière toute forme de réflexion ou d’état émotif qui
pourrait valider un jugement moral de notre part.elle a l'air de faire sa prière.
Par un beau soleil du milieu de juin, vers les dix heures du matin, se fait habituellement l'éclosion des oeufs de la Mante religieuse. La bande médiane ou zone de sortie est la seule région du nid qui donne issue aux jeunes. Sous chaque feuillet de cette zone, on voit lentement poindre une protubérance obtuse, diaphane, suivie de deux gros points noirs, qui sont les yeux. Doucement, le nouveau-né glisse sous la lame et se dégage à demi. Est-ce la petite Mante avec sa forme larvaire, si voisine de celle de l'adulte ? Pas encore. C'est une organisation transitoire. La tête est opalescente, obtuse, turgide, avec palpitations causées par l'afflux du sang. Le reste est teinté de jaune rougeâtre. On distingue très bien, sous une tunique générale, les gros yeux noirs louchis par le voile qui les recouvre, les pièces de la bouche, étalées contre la poitrine, les pattes collées au corps d'avant en arrière. En somme, exception faite des pattes très apparentes, le tout, avec sa grosse tête obtuse, ses yeux, sa fine segmentation abdominale, sa forme naviculaire, rappelle un peu l'état initial des Cigales au sortir de l'oeuf, état dont un minuscule poisson sans nageoires donne une image assez exacte. Voilà donc un second exemple d'une organisation de très courte durée ayant pour office d'amener au jour, à travers les défilés difficiles, un animalcule dont les membres libres seraient, par leur longueur, insurmontable embarras. Pour sortir de l'étroite galerie de son rameau, galerie hérissée de fibres ligneuses, encombrée de coques déjà vides, la Cigale naît emmaillotée, avec la forme naviculaire, éminemment favorable à un doux glissement. La jeune Mante est exposée à des difficultés analogues. Elle doit émerger des profondeurs du nid par des voies tortueuses, enserrées, où des membres fluets, longuement étalés, ne sauraient trouver place. Les hautes échasses, les harpons de rapine, les fines antennes, organes qui tout à l'heure seront de si grande utilité sur les broussailles, entraveraient maintenant la sortie, la rendraient très laborieuse, impossible. L'animalcule naît donc emmailloté et affecte, lui aussi, la configuration naviculaire. Le cas de la Cigale et celui de la Mante nous ouvrent un nouveau filon dans l'inépuisable mine entomologique. J'en extrais cette loi, que d'autres faits analogues, glanés un peu partout, ne manqueront certainement pas de confirmer. La vraie larve n'est pas toujours le produit direct de l'oeuf. Si le nouveau-né est exposé à des difficultés spéciales de libération, une organisation accessoire, que je continue d'appeler larve primaire, précède l'état larvaire véritable et a pour fonction d'amener un jour l'animalcule impuissant à se libérer lui-même. Reprenons notre récit. Sous les lamelles de la zone de sortie, les larves primaires se montrent. Dans la tête se fait un puissant afflux d'humeurs, qui la ballonnent, la convertissent en une hernie diaphane, à continuelles palpitations. Ainsi se prépare la machine de rupture. En même temps, à demi engagé sous son écaille, l'animalcule oscille, avance, se retire. Chacune de ces oscillations est accompagnée d'un accroissement dans la turgescence céphalique. Enfin le prothorax fait gros dos, la tête s'infléchit fortement vers la poitrine. La tunique se rompt sur le prothorax. La bestiole tiraille, se démène, oscille, se courbe, se redresse. Les pattes sont extraites de leurs fourreaux ; les antennes, deux longs fils parallèles, se libèrent semblablement. L'animal ne tient plus au nid que par un cordon en ruine. Quelques secousses achèvent la délivrance. Voilà l'insecte avec sa véritable forme larvaire. Il reste en place une sorte de cordon irrégulier, une nippe informe que le moindre souffle agite comme un frêle duvet. C'est, réduite à un chiffon, la casaque de sortie violemment dépouillée. Ma surveillance a manqué l'instant de l'éclosion pour la Mante décolorée. Le peu que je sais se réduit à ceci : à l'extrémité du bec ou promontoire qui termine le nid en avant, se voit une petite tache d'un blanc mat, formée d'une écume friable, de très faible résistance. Ce pore rond, à peine barricadé d'un tampon spumeux, est l'unique issue du nid, partout ailleurs robustement fortifié. Il remplace la longue zone d'écailles par où se libère la Mante religieuse. C'est par là que les jeunes doivent un à un émerger de leur coffret. La chance ne me sert pas pour assister à l'exode, mais, peu après la sortie de la famille, je vois pendiller, sur le seuil du pore libérateur, un bouquet informe de dépouilles blanches, pellicules, subtiles qu'un souffle dissipe. Ce sont les défroques rejetées par les jeunes en paraissant à l'air libre, les témoins d'une enveloppe transitoire qui permet de se mouvoir dans le labyrinthe du nid. La Mante décolorée a donc aussi sa larve primaire, qui s'empaquette dans un étroit fourreau, propice à l'évasion. Juin est l'époque de cette sortie. Revenons à la Mante religieuse. L'éclosion ne se fait pas dans la totalité du nid à la fois, mais bien par fractions, par essaim successifs que peuvent séparer des intervalles de deux jours et davantage. L'extrémité pointue, peuplée des derniers oeufs, ordinairement débute. Cette inversion chronologique, qui appelle au jour le dernier avant la premier, pourrait bien avoir pour cause la forme du nid. Le bout atténué, mieux accessible au stimulant d'une belle journée, s'éveille avant le bout obtus, qui, plus volumineux, ne gagne pas aussi vite la somme de chaleur nécessaire. Parfois néanmoins, quoique toujours fractionnée par essaims, l'éclosion embrasse toute la longueur de la zone de sortie. C'est spectacle frappant que le brusque exode d'une centaine de jeunes Mantes. A peine un animalcule montre-t-il ses yeux noirs sous une lame, que d'autres soudain apparaissent, nombreux. On dirait que certain ébranlement se communique de proche en proche, qu'un signal d'éveil se transmet, tant l'éclosion se propage rapidement à la ronde. Presque en un instant, la bande médiane est couverte de jeunes Mantes qui tumultueusement s'agitent, se dépouillent de leurs nippes rompues. Les agiles bestioles séjournent peu de temps sur le nid. Elles se laissent choir ou bien grimpent sur la verdure voisine. En moins d'une vingtaine de minutes tout est fini. Le berceau commun rentre dans le repos pour fournir nouvelle légion quelques jours après, jusqu'à épuisement. Aussi souvent que je l'ai voulu, j'ai assisté à ces exodes, soit dans le plein air de l'enclos, où j'avais établi, en bonne exposition, les nids recueillis un peu partout pendant les loisirs de l'hiver ; soit dans la retraite d'une serre, où je croyais, naïf, mieux sauvegarder la naissante famille ; vingt fois pour une, j'ai assisté à l'éclosion, et j'ai toujours eu sous les yeux une scène d'inoubliable carnage. Des germes, elle peut en procréer par mille, la Mante au ventre rebondi : elle n'en a pas de trop pour tenir tête aux dévorants qui doivent émonder la race dès la sortie de l'oeuf. Les Fourmis surtout sont ardentes à l'extermination. Je surprends chaque jour sur mes rangées de nids leurs visites de mauvais augure. J'ai beau intervenir, de façon très sérieuse même, leur assiduité ne faiblit pas. Rarement elles parviennent à faire brèche dans la forteresse -- c'est trop difficile -- mais, friandes des tendres chairs en formation là-dedans, elles attendent l'occasion favorable, elles épient la sortie. Malgré ma quotidienne surveillance, elles sont là, aussitôt, les jeunes Mantes parues. Elles les happent par le ventre, les extirpent de leurs fourreaux, les dépècent. C'est une lamentable mêlée de tendres nouveau-nés qui gesticulent pour tout moyen de défense, et de féroces forbans chargés de dépouilles opimes au bout des mandibules. En moins de rien, le massacre des innocents est consommé. Il ne reste de la populeuse famille que de rares survivants échappés par hasard. Le futur bourreau des insectes, l'effroi du Criquet sur les broussailles, le terrible mangeur de chair fraîche, est mangé, dès sa naissance, par l'un des moindres, la Fourmi. L'ogre, prolifique à outrance, est limité de famille par le nain. Mais la tuerie est de courte durée. Dès qu'elle a pris un peu de consistance à l'air et qu'elle s'est affermie sur ses jambes, la Mante n'est plus attaquée. Allègrement elle trottine parmi les fourmis, qui s'écartent sur son passage, n'osant plus l'appréhender. Les pattes ravisseuses ramenées sur la poitrine, comme des bras prêts à la boxe, : elle leur en impose déjà par sa fière contenance. Un second amateur de chairs tendres n'a souci de ces menaces. C'est le petit Lézard gris, l'ami des murailles ensoleillées. Averti de la curée je ne sais comment, le voici qui cueille une à une, du bout de sa fine langue, les errantes bestioles échappées aux Fourmis. C'est petite bouchée, mais exquise, paraît-il, si j'en crois les clignotements du reptile. Pour chaque misérable avalée, sa paupière se ferme à demi, signe de profonde satisfaction. Je chasse le téméraire, opérant sa razzia sous mes yeux. Il revient, et cette fois il paye chèrement son audace. Si je le laissais faire, il ne me resterait rien. Est-ce tout ? Pas encore. Un autre ravageur, le moindre de tous, mais non le moins redoutable, a devancé le Lézard et la Fourmi. C'est un très petit hyménoptère armé d'une sonde, un Chalcidien, qui établit ses oeufs dans le nid récent. La nichée de la Mante a le même sort que celle de la Cigale : une vermine parasite en attaque les germes, en vide les coques. De beaucoup de mes récoltes, je n'obtiens rien ou presque rien. Le Chalcidien a passé par là. Recueillons ce que me laissent les divers exterminateurs, connus ou inconnus. Nouvellement éclose, la larve est pâle, d'un blanc lavé de jaune. Sa hernie céphalique rapidement diminue, disparaît. Sa couleur ne tarde pas à se foncer, et devient d'un brun clair dans les vingt-quatre heures. Très agile, la petite Mante redresse les pattes ravisseuses, les ouvre, les referme ; elle tourne la tête à droite et à gauche, elle recourbe l'abdomen. La larve en plein développement n'a pas tournure plus alerte. Quelques minutes la famille stationne, grouille sur le nid, puis se dissémine au hasard sur le sol, sur les plantes voisines. J'installe sous cloche quelques douzaines d'émigrantes. Avec quoi nourrir ces futures chasseresses ? Avec du gibier, c'est tout clair. Mais lequel ? A ces minuscules, je ne peux offrir que des atomes. Je leur sers un rameau de rosier chargé de pucerons verts. Le pou dodu, tendre morceau proportionné à la faiblesse des convives, est absolument dédaigné. Pas un des captifs n'y touche. J'essaye des moucherons, les moindres que le hasard jette dans mon filet battant les herbes. Même refus obstiné. Je présente des morceaux de mouche, appendus çà et là au grillage de la cloche. Nul n'accepte mes quartiers de venaison. Le Criquet peut-être les tentera, le Criquet passion de la Mante adulte ? De fastidieuses recherches me mettent en possession de ce que je désire. Le menu consistera cette fois en quelques acridiens d'éclosion récente. Si jeunes qu'ils soient, ils ont déjà la taille de mes nourrissons. Les petites Mantes en voudront-elles ? Elles n'en veulent pas : devant la proie si menue, elles fuient effarées. Que vous faut-il donc ? Sur les broussailles natales, quel gibier autre pouvez-vous rencontrer ? Je n'entrevois rien. Auriez-vous un régime spécial du jeune âge, végétarien peut-être ? Consultons même l'improbable. Ce que la laitue a de plus tendre dans son coeur est refusé. Sont refusés les divers herbages que je m'ingénie à varier ; sont refusées les gouttes de miel que je dépose sur des épis de lavande. Toutes mes tentatives échouent, et mes captives périssent d'inanition. Cet échec a sa valeur. Il semble affirmer une alimentation transitoire que je n'ai pas su découvrir. Autrefois les larves des Méloïdes me causèrent bien des ennuis, avant de savoir qu'il leur faut pour premier aliment l'œuf de l'Apiaire dont elles consommeront après les provisions en miel. Peut-être les jeunes Mantes réclament-elles aussi, au début, des bouchées spéciales, en rapport avec leur débilité. Je ne me figure pas bien, malgré son air décidé, la faible bestiole giboyant. L'assailli, quel qu'il soit, rue, se trémousse, se défend, et l'assaillante n'est pas encore en mesure de parer au simple coup d'aile d'un moucheron. De quoi donc se nourrit-elle ? Je ne serais pas surpris qu'il y eût des faits intéressants à glaner dans cette question des vivres du jeune âge. Ces dédaigneuses, si difficiles à nourrir, périssent plus misérablement encore que par la faim. A peine nées, elles sont la proie de la Fourmi, du Lézard et d'autres ravageurs qui guettent, patients, l'éclosion de l'exquise provende. L'œuf lui-même n'est pas respecté. Un infime sondeur inocule sa ponte dans le nid à travers le rempart d'écume solidifiée ; il y établit sa famille, qui, plus précoce, détruit en germe celle de la Mante. Combien nombreux les appelés, et combien réduits les élus ! Ils étaient un millier peut-être, issus d'une même mère capable de trois nichées. Un seul couple échappe à l'extermination, un seul fait race, puisque le nombre se maintient à peu près le même d'une année à l'autre. Ici se pose grave question. La Mante aurait-elle acquis par degrés son actuelle fécondité ? A mesure que l'émondage par la Fourmi et les autres réduisait sa descendance, aurait-elle gonflé ses ovaires de germes plus nombreux, afin de balancer l'excès de destruction par un excès de production ? L'énorme ponte d'aujourd'hui serait-elle la conséquence des ruines d'autrefois ? Ainsi le pensent quelques-uns, enclins, sans preuves convaincantes, à voir dans l'animal des modifications encore plus profondes amenées par les circonstances. Devant ma fenêtre se dresse, sur le talus du bassin, un superbe cerisier. Il est venu là par hasard, robuste sauvageon, indifférent à mes prédécesseurs, respecté aujourd'hui pour son ample branchage bien plus que pour ses fruits, de qualité fort médiocre. En avril, c'est une splendide coupole de satin blanc. Il neige sous sa ramée ; les pétales tombés font tapis. Bientôt, à profusion, rougissent les cerises. O mon bel arbre, que tu es prodigue ! que de corbeilles tu remplirais ! Aussi, quelle fête là-haut ! Informé le premier des cerises mûres, le Moineau, matin et soir, y vient, par bandes, picorer et piailler ; il avertit les amis du voisinage, le Verdier, la Fauvette, qui accourent et font régal des semaines durant. Des Papillons volent d'une cerise entamée à l'autre et puisent de délicieuses lampées. Des Cétoines mordent sur les fruits à pleines bouchées, puis s'endorment repues. Des Guêpes, des Frelons crèvent les outres sucrées où viennent après eux s'enivrer les Moucherons. Un asticot dodu, établi au sein même de la pulpe, béatement fait ventre de sa demeure juteuse, devient gros et s'engraisse. Il se lèvera de table pour se changer en une élégante Mouche. A terre, le banquet a d'autres convives. Des cerises tombées, tout un monde de piétons fait liesse. De nuit, les Mulots viennent cueillir les noyaux dépouillés par les Cloportes, les Forficules, les Fourmis, les Limaces ; ils les thésaurisent au fond de leurs terriers. Dans les loisirs de l'hiver, ils les perceront d'un trou pour en gruger l'amande. Un peuple sans nombre vit du généreux cerisier. Que faudrait-il à l'arbre pour le remplacer un jour et maintenir sa race dans un état de prospérité harmonieusement équilibrée ? Une seule semence suffirait, et chaque année il en donne des boisseaux et des boisseaux. Pourquoi, s'il vous plaît ? Dirons-nous que le cerisier, très économe de fruits au début, est par degrés devenu prodigue afin d'échapper à la multitude de ses exploiteurs ? Dirons-nous de lui comme de la Mante : « La destruction excessive a petit à petit provoqué l'excessive production ? » Qui oserait s'aventurer dans ces témérités-là ? Ne saute-t-il pas aux yeux que le cerisier est, une de ces usines où se travaillent les éléments changés en matières organiques, un de ces laboratoires où se fait la transmutation de la chose morte en la chose apte à la vie ? Sans doute, il mûrit des cerises pour se perpétuer mais c'est le petit, nombre, le très petit nombre. Si toutes ses semences devaient germer et se développer en plein, depuis longtemps il n'y aurait pas place sur la terre pour le seul cerisier. A l'immense majorité de ses fruits revient un autre rôle. Ils servent de nourriture à une foule de vivants, non habiles, comme le végétal, dans la chimie transcendante qui de l'immangeable fait le mangeable.
La matière, pour être appelée aux suprêmes manifestations de la vie, exige de lentes et très délicates élaborations. Cela débute dans l'officine de l'infiniment petit, chez le microbe par exemple, dont l'un, plus puissant que les violences de la foudre, associe l'oxygène à l'azote et prépare les nitrates, aliment primordial des végétaux. Cela commence sur les confins du néant, se perfectionne dans la plante, s'affine encore dans l'animal, et de progrès en progrès peut monter jusqu'à la substance du cerveau. Que d'ouvriers occultes, que d'ignorés manipulateurs ont travaillé, des siècles durant peut-être, à l'extraction minérale, puis à l'affinage de cette pulpe qui devient le cerveau, le plus merveilleux des outils de l'âme, ne serait-il capable que de nous faire dire : « Deux et deux font quatre ! » La fusée qui monte réserve pour le point culminant de son ascension l'éblouissant jet de ses feux multicolores. Puis tout rentre dans le noir. De ses fumées, de ses gaz, de ses oxydes, d'autres explosifs pourront à la longue se reconstituer par la voie de la végétation. Ainsi fait la matière dans ses métamorphoses. D'une étape à l'autre, d'un affinage délicat à un autre plus délicat, il lui arrive d'atteindre les hauteurs où éclatent, par son intermédiaire, les magnificences de la pensée ; puis, brisée par l'effort, elle revient à cette chose sans nom d'où elle était partie, à ces ruines moléculaires, origine commune des vivants. En tête des assembleurs de matière organique est la plante, l'aînée de l'animal. De façon directe ou de façon indirecte, elle est aujourd'hui, comme dans les temps géologiques, le premier fournisseur des êtres mieux doués en vie. Dans l'officine de sa cellule se prépare, se dégrossit au moins l'universel manger. L'animal vient, qui retouche la préparation, l'améliore et la transmet à d'autres d'ordre plus élevé. Du gazon brouté se fait chair de mouton, et de celle-ci se fait chair d'homme ou chair de loup, suivant le consommateur. Parmi les arrangeurs d'atomes nourriciers qui ne créent pas la matière organique de toutes pièces, en partant du minéral comme le fait la plante, les plus prolifiques sont les poissons, premiers-nés des animaux à charpente Osseuse. Demandez à la morue ce qu'elle fait de ses millions d'oeufs. Sa réponse sera celle du hêtre avec ses myriades de faînes, celle du chêne avec ses myriades de glands. Elle est immensément féconde afin de nourrir une immensité d'affamés. Elle continue l'oeuvre de ses prédécesseurs dans les anciens âges, alors que la nature, peu riche encore de matière organique, se hâtait d'augmenter ses réserves vitales en donnant prodigieuse exubérance à ses ouvriers de la première heure. La Mante, comme le poisson, remonte à ces lointaines époques. Sa forme étrange, ses rudes moeurs nous l'ont appris. La richesse de ses ovaires nous le répète. Elle garde dans ses flancs un reste affaibli de la fougue procréatrice d'autrefois sous l'ombrage humide des fougères en arbre ; elle continue pour une part, très modeste il est vrai, mais enfin réelle, à la sublime alchimie des choses vivantes. Serrons de près son travail. Du gazon verdoie, nourri par la terre. Le Criquet le broute. La Mante fait repas du Criquet et se gonfle d'oeufs, pondus, en trois paquets, au nombre d'un millier. A l'éclosion survient la Fourmi, qui prélève tribut énorme sur la nichée. Nous rétrogradons, ce semble. En importance de volume, oui ; en instinct raffiné, certes non. Sous ce rapport, combien la Fourmi est supérieure à la Mante ! D'ailleurs le cycle des événements possibles n'est pas clos. Avec de jeunes fourmis encore closes dans leur cocon — vulgairement oeufs de fourmi — s'élève la couvée du faisan, volaille domestique aux mêmes titres que la poularde et le chapon, mais coûteuse de soins et d'entretien. Devenue forte, cette volaille est lâchée à travers bois, et des gens, se disant civilisés, prennent un plaisir extrême à cribler de coups de fusil les pauvres bêtes qui ont perdu dans les faisanderies, disons tout bonnement dans le poulailler, l'instinct de se sauver. On coupe la gorge au poulet réclamé par la broche ; on fusille, avec tout l'apparat des grandes chasses, cet autre poulet, le faisan. Je ne comprends pas ces massacres insensés. Tartarin de Tarascon, le gibier manquant, tirait sur sa casquette. J'aime mieux cela. J'aime mieux surtout la chasse, la véritable chasse à un autre passionné consommateur de fourmis, le Torcol, le Tiro-lengo des Provençaux, ainsi dénommé de son art consistant à étendre en travers d'une procession de fourmis sa langue visqueuse et démesurée, puis à la retirer brusquement, lorsqu'elle est toute noire d'insectes englués. Avec telles bouchées, l'oiseau devient en automne scandaleusement gras ; il se plaque de beurre le croupion, le dessous de l'aile, les flancs ; il s'en fait un chapelet tout le long du cou ; il s'en matelasse le crâne jusqu'à la base du bec. C'est alors délicieux rôti, petit, j'en, conviens, de la taille au plus d'une alouette, mais, dans sa petitesse, à nul autre pareil. Combien lui est inférieur le faisan, qui, pour acquérir goût relevé, exige un commencement de pourriture ! Que je puisse au moins une fois rendre justice au mérite des plus humbles ! Lorsque, la table levée après le repas du soir, la tranquillité faite, le corps affranchi momentanément des misères physiologiques, il m'arrive de cueillir par-ci par-là quelques bonnes idées, il peut se faire que la Mante, le Criquet, la Fourmi, de moindres encore, contribuent à ces éclaircies soudaines surgies dans l'esprit on ne sait ni pourquoi ni comment. Par d'inextricables détours, ils ont fourni, chacun à sa manière, la goutte d'huile où s'alimente le lumignon de la pensée. Leurs énergies, lentement ébauchées, économisées et transmises par des prédécesseurs, s'infusent dans nos veines et soutiennent nos défaillances. Nous vivons de leur mort. Concluons. La Mante, prolifique à l'excès, fait à son tour de la matière organique, dont héritera la Fourmi, dont héritera le Torcol, dont héritera peut-être l'Homme. Elle procrée mille, un peu pour se perpétuer, beaucoup pour contribuer, suivant ses moyens, au pique-nique général des vivants. Elle nous ramène à l'antique symbole du serpent qui se mord la queue. Le monde est un cercle revenant sur lui-même : tout finit afin que tout recommence ; tout meurt afin que tout vive.
Fait par Joey le 20 novembre 2002
|
|
Mis à jour le 25 novembre, 2002 |