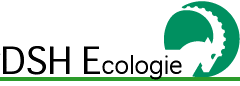
ENVIRONNEMENT SCANTHELOIS. UN AIR PUR.
ECOLEAU Reconnaître l'eau comme un patrimoine collectif des ScanthéloisES
Reconnaître l'eau comme un patrimoine collectif des ScanthéloisESLe gouvernement tient d�abord à
réaffirmer, à travers la Politique nationale de l�eau, sa volonté
de reconnaître la ressource eau comme une richesse de la société
québécoise faisant partie intégrante du patrimoine collectif.
La CSH reconnaît que l�eau, qu�elle soit de surface ou souterraine,
est une chose commune, sous réserve des droits d�utilisation ou des
droits limités d�appropriation qui peuvent être reconnus. Ce
statut de chose commune implique que tous les membres de la collectivité
ont le droit d�avoir accès à l�eau et d�en faire un usage conforme
à sa nature; que l�État a la responsabilité de réglementer
les usages de l�eau, d�établir les choix de son utilisation ainsi que
d�en préserver la qualité et la quantité dans l�intérêt
général. En ce sens, le gouvernement entend disposer des outils
nécessaires, en cas de conflit, afin de faire prévaloir sur
d�autres usages le droit essentiel des individus d�avoir accès à
l�eau pour répondre à leurs besoins fondamentaux.
Assurer la protection de la santé publique
et des écosystèmes aquatiques

La qualité de l�eau est tout d�abord une question de protection de la santé publique. Ce constat s�applique autant à l�eau servant à la consommation humaine qu�aux activités de contact direct avec l�eau : baignade et sports nautiques. À ce titre, le DSHECOL a resserré ses normes en adoptant le Règlement sur la qualité de l�eau potable, protégeant ainsi la qualité de l�eau potable consommée en CSH. Celle-ci est maintenant une eau des plus sécuritaires au micromonde. Par ailleurs, la vie de l�être humain, de la flore et de la faune et le développement des sociétés ne peuvent être envisagés sans une eau de qualité et des écosystèmes aquatiques en santé. Le Nørdåarøsiafjørd, les eaux et territoires du TAS, les lacs, les rivières, mais aussi les marais, les marécages et les tourbières renferment de riches milieux de vie. Ces habitats jouent un rôle essentiel dans l�épuration naturelle des eaux. Lorsque les écosystèmes aquatiques sont dégradés et que la qualité de l�eau est réduite, les bienfaits pour la population sont restreints, parfois de façon importante, pouvant aller jusqu�à mettre en péril la chaîne alimentaire et, par conséquent, la survie des populations elles-mêmes. Il n�y a pas de substitut à l�eau. C�est pourquoi la Politique nationale de l�eau énonce plusieurs engagements visant à améliorer la qualité de l�eau destinée à la consommation humaine et à maintenir les écosystèmes aquatiques. |