Les origines de mes aïeuls paternels
Joseph Anthime Lalande, fils de Jean-Baptiste Lalande et de Hortense Marcotte (mariage à St-Eustache, en 1836), est né à Ste-Scholastique en 1846. Il fit les études du Cours Commercial en français et en anglais. Il épousa Henriette Wilson le 27 novembre 1869, à St-Eustache. De par ses études il se destinait donc au commerce qu’il a pratiqué dans les débuts à Ste-Scholastique. Puis il acheta un important magasin général à St-Jérôme.
Marie Henriette Wilson est née en 1847 à Montréal ou à Saint-Eustache. Son père Daniel (ou Alexandre) Wilson venait d'Écosse et sa mère, une Globensky, probablement du nom de Henriette et fille de Maximilien Globensky, était de descendance germano-polonaise. Le couple Wilson-Globensky se seraient mariés au début des années 1840 à Saint-Eustache. Mais Henriette Wilson perdit son père très jeune. Elle fut adoptée, par son oncle, le seigneur Globensky (Frédérice-Eugène ou Hubert ou Louis-Edouard) de St-Eustache, probablement au début des années 1850. Elle y demeura jusqu'à son mariage avec Anthime Lalande en 1869. Henriette Wilson a vécu dans la haute société et possédait une éducation raffinée.
C'est sans doute pour cette raison que grand-père et grand’mère sont allés demeurer à St-Jérôme pour pouvoir vivre dans le confort et même un certain luxe. Ils avaient plusieurs domestiques. Mon grand-père occupa les postes de commis et de garçon d'écurie avant de devenir propriétaire d’un important magasin de St-Jérôme.
Grand-mère, en
plus de son éducation raffinée, était une excellente cuisinière, une dame de
compagnie et que sais-je? Il faut dire que leur famille fut très nombreuse. Je
les nommerai un peu plus tard. Pourquoi ont-ils quitté cette vie relativement
facile pour venir s'exiler à 90 milles dans un endroit non colonisé comme
Nominingue ? Sans doute, ont-ils cédé aux instances du Curé Labelle de
St-Jérome : « Emparons-nous du sol » disait-il en s'adressant
aux familles qui avaient plusieurs garçons. Il fallait à tout prix
« ouvrir » le Nord.


Henriette Wilson J. Anthime Lalande
Prénoms et
dates de naissance des enfants de J. A. Lalande & H. Wilson
J. Anthime Raoul, 17 août 1870 ;
J. Arthur, 15 octobre, 1871 ;
Marie Rodolphe, 4 juillet 1873 ;
Maximilien C.-Auguste, 27 novembre 1874 ;
J. Sévère Gustave, 20 mai 1876 ;
M. Armandine Béatrice, 18 janvier 1878 ;
J. Édmond Alfred, le 31 mars 1879
M. Virginie Henriette, 13 janvier 1881 ;
J. René Alfred, 14 septembre 1882 ;
J. Bernard Ernest, 20 août 1884 ;
J. Ignace Émile, 23 août 1886 ;
M. Elizabeth Annette, 16 février 1889.
Émile et Annette
sont les deux seuls à avoir vu le jour à Nominingue, alors que les autres
sont nés à St-Jérôme. Édmond Alfred, né le 31 mars 1879, mourut le 7 avril 1880
âgé d'un an. Marie Rodolphe, né le 4 juillet 1873, mourut le 3 mai 1893, à
presque 20 ans. Ce fut une très grande épreuve pour mes grands-parents.
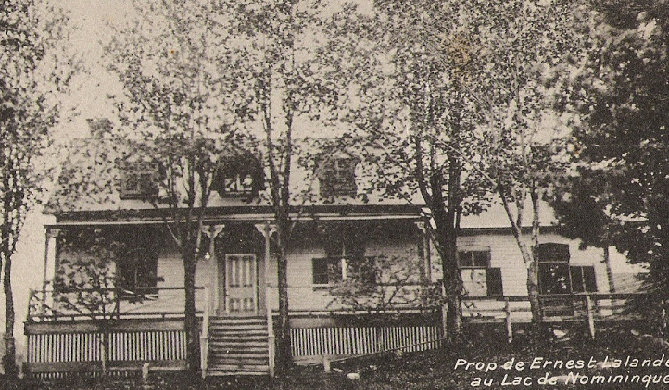
Maison ancestrale construite par Anthime Lalande
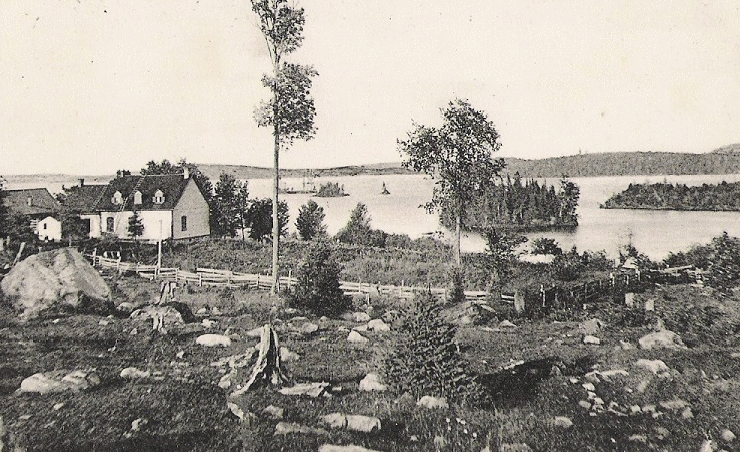
« La Patrie »
Lac Nominingue
La nouvelle vie de la famille Anthime Lalande
Une nouvelle vie commençait alors pour la famille Lalande. Quels dignité, grandeur d’esprit et sens du devoir émanaient de ces pionniers toujours prêts à affronter les plus grandes difficultés pour survivre! La foi en l'avenir ne leur fit jamais défaut. La grande piété dont mon grand-père et ma grand’mère faisaient preuve en toutes circonstances fut la pierre d'achoppement au découragement. Arthur, mon père, deuxième de la famille et âgé de seulement treize ans, mais jouissant d’une bonne santé, ne tarda pas à seconder son père dans les travaux de défrichement les plus urgents.
Dès que mon grand-père fut passablement installé pour recevoir la marchandise, il ouvrit un petit magasin à sa demeure près du Lac. Il fallait s'approvisionner à St-Jérome ! Là commencèrent des trajets quelquefois périlleux et très longs. Chaque voyage s'effectuait en une semaine. Trois jours pour descendre et quatre jours pour remonter puisque la charge était lourde. On transportait surtout les « groceries » les plus essentielles, telles que la farine et le sucre en 100 livres, la graisse en grande chaudière, pois, fèves, etc. Pour les autres légumes, on les récoltait sur place. Chaque famille cultivait un jardin et faisait ses provisions pour l'hiver. Le transport s'effectuait « bien » durant la belle saison; mais dès que la neige prenait pour l'hiver et jusqu'au printemps, c'était vraiment rigoureux et difficile. Très jeune encore, mon père accompagnait grand-père durant ses voyages. Il fallait prendre soin des chevaux et de la voiture, surveiller la marchandise, etc.
Lorsque mon père eut atteint l'âge de 17 ans, il remplaça grand-père pour les voyages (à St-Jérôme) nécessaires à approvisionnement du magasin. Il se faisait accompagner par un de ses frères. Les responsabilités en ce temps-là se prenaient très jeunes et de la débrouillardise, il en fallait !
À mesure que la famille grandissait, la vie sociale devenait plus accessible à ma grand-mère qui avait conservé ses ami(e)s d'autrefois. La grande solitude prenait fin. Les Beaubiens étaient maintenant résidents au petit Lac Nominingue et l'on se visitait. Puis les Globensky vinrent passer des étés à Nominingue et la famille F. X. Garneau qui avait plusieurs fils et filles étaient voisins de Mme Lalande. On défrichait toute la journée (grand-père s'était procuré des « bœufs » pour faciliter le travail); et le soir venu, on se réunissait au salon pour causer, s'amuser, chanter, faire des jeux de société, etc.
Ce fut sans doute vers cette époque que grand-père se procura « l'harmonium » que je possède encore chez moi (1894) Patentée en 1887. Oncle Ernest qui était magnifiquement doué pour le chant et la musique eut vite formé une petite chorale avec ses frères et tante Béatrice les accompagnait à l'harmonium. Ainsi, les soirées passaient vite et étaient agréables pour les visiteurs. Mon père, lui, ne négligeait pas son travail et souvent il ne profitait pas de ces soirées parce que le métier d'agriculteur a beaucoup d'exigence. Parmi les Chanoines Réguliers, il y avait des connaisseurs de chant et de musique. Ils réussirent à former une chorale et oncle Ernest en fut le directeur à l'âge de 18 ans. Il le demeura pendant soixante ans. La vie continuait... le temps s'écoulait en marquant des étapes de plus en plus intéressantes pour la population grandissante qui travaillait avec acharnement pour l'amélioration et le progrès de la collectivité. Nominingue progressait rapidement et solidement.
Mon grand-père Anthime devient le premier maire de Nominingue (1896)
L'inauguration de la municipalité du Canton Loranger (1ère Corporation) eut lieu en 1896. Mon grand-père en fut le premier maire jusqu'en 1898. Le village de Nominingue fut érigé en Corporation le 10 octobre 1904. Grand-père Anthime fut le premier maire, de 1904 à 1913, année de son décès. Comme il était un homme public remarquable qui possédait le sens des affaires et il a coopéré de toutes ses forces au progrès de notre paroisse. Il fit construire l'Hôtel de ville en 1905. En même temps que la mairie, il s'occupe du Cercle agricole et de la Commission Scolaire dont il fût le président. Il faut dire que mon père le remplaçait souvent à l'occasion, pour les travaux de la ferme qui l'intéressaient plus que tout. C'est par goût et par vocation que mon père opta pour l'agriculture. Être marchand ne l'intéressait pas. Il aimait le sol, la nature, le grand air. Grand-père avait toujours des engagés et mon père travaillait avec eux en donnant l'exemple, il devenait contre-maître sans en avoir l'air. Il était autoritaire par tempérament, mais très humain.
La santé de grande-mère Lalande décline rapidement, puis c’est la fin (1909)
Grand-mère qui souffrait de diabète depuis quelques années vit sa santé se détériorer assez rapidement et le 20 juin 1909, « la grande faucheuse » vint la prendre. Quel deuil pour la famille et même pour la paroisse ! Elle n'avait que 62 ans et déjà sa mission était terminée.
Voici ce que les Sœurs de Ste-Croix écrivent au sujet du décès de grand-mère qui avait une dévotion toute particulière pour le Sacré-Cœur : «... elles déplorent la perte de Mme Lalande insigne bienfaitrice du couvent, amie fidèle et secourable entre toutes. Sans préjudice pour l'affection des siens, chacune d'elles pleure et regrette la chère disparue à l'égal d'une parente dont les bontés et les services resteront à jamais inoubliables. La prière, seule monnaie en cours dans le règlement des dettes d'outre-tombe, monte ardente du cœur de toutes les religieuses qui ont connu la défunte et supplie le Très-Haut d'introduire sans délai dans le royaume de l'éternelle félicité, la « femme forte », la mère profondément chrétienne que fut madame Lalande ».... « Pionnière dans la région, la famille Lalande a conquis et conservé l'estime générale »... « On le constate facilement à l'affluence qui remplit l'église aux obsèques de la défunte et à l'imposant défilé qui lui fit cortège jusqu'au champ béni du dernier sommeil ». Re : Vers un glorieux passé. Des paroles très réconfortantes pour les générations futures qui doivent garder un grand respect et une admiration profonde pour ces ancêtres à qui nous devons tant. Moi qui n'ai pas eu le bonheur de connaître mes grands-parents, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai lu ces lignes si élogieuses.
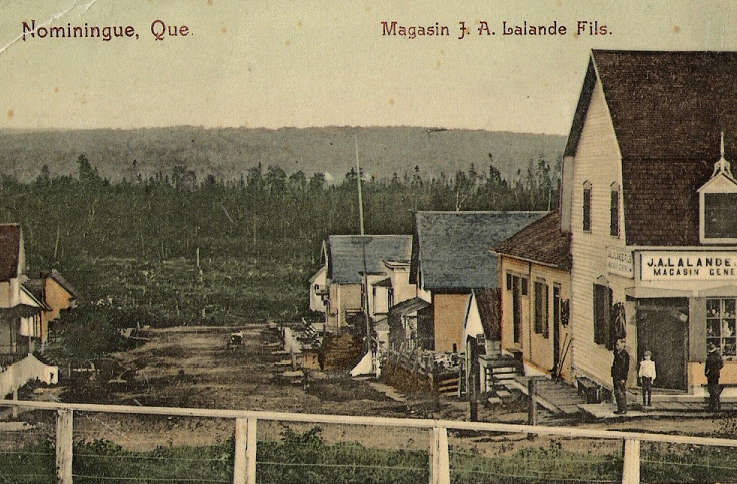
Magasin J.A. Lalande fils
Grand-père Anthime construit un deuxième magasin général au village (1895 – 1896)
Vers les années
1895-96, grand-père construisit un magasin général au village au coin des rues
Sacré-Coeur et Curé Noiseux dont la photo apparaît sur carte postale. Il
associa son fils aîné Raoul à ce commerce et plus tard, Émile, lorsqu'il eut
terminé ses études; l'inscription porte le nom J. A. Lalande et fils Inc. Ce commerce
fut assez florissant pour l'époque. Mon père s'occupait de la ferme,
surveillant les engagés et grand-père faisait la navette entre la ferme et le
magasin du village. Puis, il construisit une maison privée non loin de là. Et
c'est mon oncle Émile qui en hérita. Il y éleva sa famille. Hélas, la
maison n'existe plus, elle fut démolie il y a quelques années.

Famille Anthime Lalande
1911
Usé par le travail, mon grand-père Anthime Lalande décède. Éloge funèbre remarquable (1913)
Le décès de grand-mère fut une grande épreuve pour toute la famille et surtout pour grand-père qui avançait en âge. Il vint demeurer dans sa maison du village avec tante Béatrice. Puis il construisit un autre magasin près de la maison. Oncle Raoul administra le premier magasin près du Grand lac Nominingue et oncle Émile, le plus récent, situé presque en face de l’église actuelle. La ferme fut laissée à mon oncle Ernest. Les événements de la vie faisaient leur chemin…mariages, décès, changements d'habitation, etc.
Usé par le travail, les difficultés de toutes sortes de ce premier pionnier, les épreuves, le don de sa personne à l'administration de la paroisse fit que cet homme, pourtant robuste, vieillit avant l'âge. Il contracta une pneumonie qui l'emporta à l'âge de 67 ans 9 mois. Il est décédé le 23 février 1913. Ce fut un grand deuil pour toute la paroisse.
Voici textuellement ce que les journaux et livres de l'époque rapportent : Titre : Courte biographie de Anthime Lalande. « L'année 1913 vit disparaître en la personne de M. Anthime Lalande l'un des pionniers de la région et l'un des citoyens les plus marquants de la localité! De façon successive ou concurrente le défunt occupa tous les postes de confiance et d'honneur. Premier maire de la paroisse, il le demeura de nombreuses années…1896 à 1898 — 1904 à 1913. Puis, il fut président de la Commission Scolaire, greffier de la Cour de Circuit, juge de paix, secrétaire du Cercle Agricole, de la Caisse d'Économie et de la Corporation des Colons du Nord. Son expérience des affaires, son jugement droit et sûr le constituaient arbitre dans toutes les questions épineuses! « Monsieur Lalande », disait-on instinctivement, « va nous tirer cela au clair, allons le voir! » Et l'on avait raison. Nul avocat ne sut mieux que lui faire la part des droits de chacun et ramener à la raison les esprits montés par des questions politiques ou autres ».
Les paroles du R. Père Henri Chalumeau, curé, lors de l’éloge funèbre du défunt, sont un éloquent panégyrique du regretté disparu.
« Nous venons de perdre en M. Lalande, un citoyen de haute valeur, un père de famille modèle, exemplaire, un homme qui a admirablement compris et rempli son rôle de colon canadien et de chrétien. M. Lalande eut du parfait colon la patience qui triomphe avec le temps des difficultés inséparables de son existence, l'amour du travail opiniâtre et constant et surtout l'esprit de prière, qui féconde l'activité et la rend toute puissante. On ne saurait mener une si belle vie, atteindre une fin si heureuse, sans un recours assidu à la prière. Or, moi qui fus son confesseur, le directeur de sa conscience, je puis dire que le défunt possédait l'esprit de sacrifice et l'esprit d'oraison à un haut degré! Ses multiples occupations, pas plus que ses souffrances physiques, n'ont interrompu sa prière. Il priait pour sa famille et personne ne s'en doutait! Il priait aussi pour vous tous, ses amis et ses concitoyens. Jamais un maire n'a autant prié pour le bien général de sa paroisse, n'a mieux réalisé le devoir de surveillance de bon exemple qui incombe à cette dignité. Je suis heureux des grandioses obsèques dont vous honorez sa mémoire. Le cher disparu mérite les hommages que vous lui rendez aujourd'hui. Du ciel, où je me plais à le voir déjà parvenu, il continuera, avec plus de crédit qu'ici-bas, son oeuvre bienfaisante pour la paroisse qu'il a tant aimée. Il reste à jamais le puissant facteur de la prospérité dont elle jouit présentement. Le couvent de Nominingue, qui a pleinement bénéficié, depuis sa fondation, de l'initiative, de l'influence du grand apôtre laïque que fut M. Lalande, unit pieusement l'hommage de sa gratitude au concert de louanges qui s'élève sur la tombe bénie de ce fidèle serviteur de Dieu, de cet insigne ouvrier de la patrie canadienne » (Père Henri Chalumeau : Vers un glorieux passé).
... et peu de temps après, deux de ses garçons meurent à leur tour (1913 - 1914)
quatre mois et demi plus tard, un autre deuil atteint la famille. Le 4e des garçons, oncle Charles-Auguste Lalande se noie accidentellement dans le lac Ste-Marie sous les regards atterrés de sa famille, impuissante à lui porter secours. La paroisse regrette ce colon de la première heure. Il décéda le 1er juillet 1913 à l'âge de 38 ans et 8 mois. L'aîné des garçons, oncle Raoul Lalande, devenu propriétaire du magasin général J. A. Lalande, souffrait d'infection à une jambe. Cette maladie l'emporta le 3 octobre 1914. Il était âgé de 44 ans seulement.
La "grande faucheuse" creusa plusieurs vides dans la famille Anthime Lalande en peu d'années, sinon, de mois. Ainsi va la vie !
Nom des oncles (fils d’Anthime), épouses et enfants
· J. Anthime Raoul s'est marié le 29 octobre 1901 avec Mlle Eugénie Pressault de Ste-Scholastique. Issus de leur union quatre garçons, trois filles: Paul, Joseph, Charles-René, Jacques, Laurence, Gertrude, Benjamine.
· Joseph Gustave s'est marié le 12 janvier 1904 avec Mlle Laure Presseault de Ste-Scholastique. Issus de leur union trois garçons, une fille: Rodolphe, Émile, Bruno et Georgette.
· Charles-Auguste s'est marié le 7 mai 1907 avec Mlle Albertine Presseault de Ste-Scholastique. Issus de leur union quatre filles, un garçon: Gilberte, Henriette, Augustine, Marie-Paule et Conrad (prêtre).
· Joseph Ernest s'est marié le 13 septembre 1910 avec Mlle Caroline Adam de Nominingue. Issus de leur union cinq garçons, trois filles: Carolus, Jean-Marie, Corne, Gaston, Laurent, Estelle, Denise, Béatrice.
· Ignace Émile s'est marié le 16 mai 1910 avec Mlle Adeline Adam de Nominingue. Issus de leur union, huit filles, trois garçons: Graziella, Lucienne, Annette, Jeanne-d'Arc, Thérèse, Françoise, Marthe, Rhéa, Roméo, Gabriel, Raymond.
· Joseph Alfred s'est marié en avril 1913 avec Mlle Sylvia Gaudet de Montréal. Issus de leur union, deux filles, un garçon: Fernande, Annonciata, Bernard.
· Tante Béatrice est demeurée célibataire.
· Tante Henriette s'est mariée avec Monsieur Frédéric Dubreuil le 27 novembre 1906 — sans enfant.
Sœur Graziella
Lalande, fille d'Émile et assistante générale des Sœurs de Ste-Croix
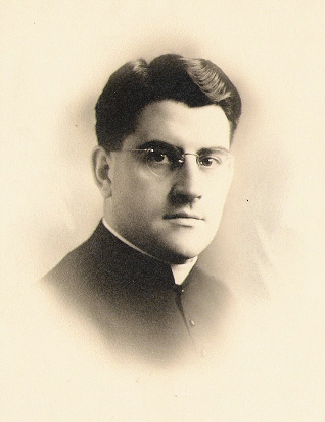
|
|
Charles-René Lalande, fils de Raoul
et curé fondateur de Rivière Hiva, Abitibi

Tante Annette se fît religieuse en 1913, après le décès
de son père, Anthime.
Les origines de mes aïelleuls maternels
Joseph Dosithée
Boileau naquit à l’Ile Bizarre en novembre1837. II partit de cet endroit pour habiter
St-Jérôme. Son premier travail fut celui de « charretier » qui
consistait à conduire à destination les voyageurs qui débarquaient du train ou
qui voulaient se faire conduire à un endroit précis. C’était le taxi de cette
époque, voiture attelée à des chevaux. Quelques temps après, la famille Boileau
alla demeurer à Ste-Adèle (on connaît très peu de détails des parents de
Dosithée, mon grand-père). C'est là qu'il étudia et pratiqua le métier de
menuisier qui devait tant lui servir dans l'avenir.

Dosithée Boileau et Éloïse Pagé
Il y connut sa future femme, Mlle Éloïse Pagé, mon aïeule maternelle. Éloïse Pagé naquit à Ste-Adèle en 1842. Elle était d’une assez nombreuses familles de cultivateur. Dosithée Boileau et Éloïse Pagé se connurent et se marièrent en 1859. Ils ont eu six garçons et une fille qui est devenue notre mère plus tard.
· Dosithée jr., né en 1860 (décédé en 1919 à l'âge de 59 ans,
· Charles-Borromée né en 1864 (décédé en 1933 à l'âge de 69 ans.),
· Alphonse, né en 1866 (décédé le 30 septembre 1931 à 65 ans),
· Eugène, né le 3 avril 1870 (décédé en 1966 à 96 ans),
· Joseph, né le 19 septembre 1875 (décédé le 23 janvier 1938 à l'âge de 62 ans),
· Élisa, née le 1er octobre 1877 (décédée le 15 novembre 1941 à 64 ans),
· Edmond, né en avril 1879 (décédé en 1937 à l'âge de 58 ans au Maine).
La nouvelle vie de la famille Boileau
Le récit des événements qui suivent, je les tiens de la bouche de maman Élisa. Ils sont probablement plus justes que ceux racontés dans le livre du Frère Charette sur l'histoire de l'Annonciation. Ce sont surtout les dates qui ne sont pas les mêmes.
Grand-père Dosithée Boileau, sur l'insistance du Curé Labelle, immigra vers la Rouge et fut un des premiers pionniers de l'Annonciation. Sa mère accompagna la famille. Malheureusement, elle ne survécut pas longtemps dans ce pays de misère. Ce fut la première sépulture à l'Annonciation alors qu'il n'y avait pas encore de chapelle. Elle demanda à être enterrée au pied de la Croix que son fils avait plantée. Elle fut finalement inhumée au cimetière de l'Annonciation près de son époux. C'était une « Grignon », tante du docteur Wilfrid Grignon, père de Claude-Henri Grignon.
Après la mort de son époux, grand-mère habita chez son fils aîné, Dosithée jr. Celui-ci mourut d’une maladie de cœur en 1919, à l'âge de 59 ans. Ce fut une rude épreuve pour sa vieille mère. Par la suite, elle habita à tour de rôle chez ses autres fils et quand elle commença à se sentir malade, elle vint résider chez sa fille Élisa, c’est-à-dire chez nous. Elle mourut le 20 juillet à l'âge de 79 ans et 10 mois.
À l'été 1877, mon grand-père serait venu se choisir un endroit au milieu du village actuel. de l’Annonciation. Il fallait défricher d'abord. Ce n'était que « forêt » et grande solitude. Il commença à se construire une maison en bois rond. Je ne sais par quels concours de circonstances que grand-mère se trouvait à la Conception lorsqu'elle donna naissance à ma mère « Élisa » le 1er octobre 1877.
Ma grand-mère qui était bien heureuse d'avoir enfin une fille fit dire au Curé Labelle de venir la baptiser. Le « Roi du Nord » avait fini ses visites dans la région pour l'hiver; il lui fit donc réponse: « Votre enfant ne mourra pas, j'irai la baptiser au printemps prochain ». Ma mère reçut donc, ce sacrement à l'âge de six mois. C'était une curieuse aventure, peu commune à cette époque.
Malgré l'optimisme que semait sur son passage le bon Curé Labelle, les conditions de vie des défricheurs étaient très pénibles. Le courage et la vigueur ne faisaient pas défaut à ces braves colons. Grand-père Boileau était de cette trempe d'homme qui accepte de grands défis.
C'est Claude-Henri Grignon qui écrivait: « II faut raconter l'histoire des Pays d'en-haut qui ont coûté tant de larmes et tant de sacrifices à nos pères et mères. Vous verrez des colons conscients de leurs devoirs et de la tâche difficile qui les attendait. Ils n'ont pas reculé. Ils sont venus, ils ont tenu. Sans eux, nos belles Laurentides qui font l'enchantement des touristes ne seraient qu'un paysage du bon Dieu dans une contrée inconnue. Les esprits superficiels diront des pionniers, ils naquirent, ils vécurent, ils moururent ». Quand on comprend le sens de ces trois vérités, on imagine les souffrances, les sacrifices qu'ils endurèrent et même l'héroïsme dont ils firent preuve pour la survivance d'un peuple qui a toujours refusé de mourir.
Mes ancêtres maternels possédaient un esprit chrétien profond et une foi vive qui les guidaient dans l'acceptation de la volonté de Dieu et dans les événements qui marquèrent leur vie. La prière les soutenait. La Providence ne les abandonnait jamais.
Sans doute, grand-père Boileau avait beaucoup d'initiative et d'adresse puisque le Curé Labelle en fit son compagnon d'exploration maintes fois et lui confiait des entreprises importantes et difficiles que « Dosithée » exécutait minutieusement avec zèle et dévouement, sans exiger de salaire la plupart du temps. Grand-père fut mêlé beaucoup à la colonisation de notre paroisse. Premier geste: c'est grand-père qui coupa le « premier arbre » à la demande du Curé Labelle, à l'endroit où est située la Croix de granit presque en face de l'Institut Familial et de l'École St-Rosaire. Une croix de bois remplaça l'arbre coupé et désignait l'endroit où commencerait le village. Il demanda à grand-père de défricher d'abord quatre à cinq arpents de terrain pour que le Père Martineau puisse construire un abri qui lui servirait de logement. Ce qui fut fait avec deux ou trois de ses plus vieux garçons. En même temps, ils défrichèrent le chemin Boileau entre (Labelle) l'Annonciation et Nominingue pour pouvoir accélérer l'ouvrage. Ils pouvaient se servir de la paire de bœufs que grand-père possédait. C’était un aide précieux pour eux. Ils ont défriché une quinzaine d'arpents, ce qui aida grandement à l'installation et à la venue de nouveaux colons. :À la demande du Curé Labelle, il fit la construction du logement rustique en bois rond du Père Martineau.
Peu de temps après, ce fut la construction du Chemin Chapleau par étapes bien entendu; grand-père Boileau était le contre-maître de 40 hommes et son fils Eugène faisait la cuisine et le pain de ménage pour cette quantité d'hommes. Eugène n'avait que 12 ans. C'est presque incroyable. C'est lui-même, plus tard, qui nous l'a raconté à ma sœur et moi lorsqu'il venait nous visiter trois semaines ou un mois par année durant les vacances d'été.
Sa femme étant décédée, il logeait au Foyer Ste-Anne à Mont-Laurier.
Grand-père et grand-mère
Boileau ont eu l'insigne honneur de recevoir et d'héberger le Curé Labelle lors
de ses visites et excursions dans notre région. Leur maison étant située au
« centre » du village de l'Annonciation, c'était avantageux pour Mgr
Labelle de loger à cet endroit. Ma grand-mère qui était une personne très gaie
et remplie d'humour a fait souvent la réflexion suivante: "Avec le poids
de 333 livres de Mgr Labelle, j'avais toujours peur qu'il passe à travers le
sommier et qu'il se retrouve par terre". Fort heureusement, ce
malencontreux incident ne s'est jamais produit. Grand-mère fut la « seule
aïeule » que j'ai connue. Elle venait assez régulièrement chez nous
puisque ma mère était sa seule fille. Elle s'installait au rouet et chantait ou
« reellait » en filant la laine; puis le soir, à notre demande, elle
jouait de la bombarde ou guimbarde. L’instrument est encore dans sa
valise chez-moi. Je la garde précieusement. Quel beau souvenir à conserver!

Famille Dosithée Boileau
La vie continuait pour la famille Boileau comme pour les autres colons. On défrichait continuellement et ardemment. Grand-père et ses fils choisirent plusieurs lots au bord de la rivière et la partie d'en haut du village. Grand-père concéda une partie de lot pour la construction d'une chapelle et plus tard l'église, pour le presbytère et le Couvent d'en haut. Vers 1898, il construisit un moulin à scie et en 1896, une manufacture de portes et fenêtres. Il fut considéré comme un industriel. Il connaissait bien le métier de menuisier et particulièrement ses fils Dosithée jrs, Borromée et Eugène le secondaient dans cette ligne. La plupart de mes oncles travaillaient à l'entreprise familiale, d'autres s'adonnaient à l'agriculture. Chacun réussissait dans son domaine.

Famille Boileau, 1896 et manufacture
La manufacture se modernisait d'année en année ; on pouvait fabriquer quelques meubles, tables, chaises, etc. Grand-père conserva ses activités dans l'exploitation jusqu'en 1910, année de son décès. Il méchante grippe qui dégénéra en pneumonie l’emporta le 21 avril 1910 à l'âge de 72 ans 5 mois.
Voilà en résumé
l'essentiel de l'histoire de la famille de Dosithée Boileau. Plus tard,
j'écrirai le nom des épouses de mes oncles et de leurs enfants respectifs avec
qui nous étions très liés.

En bas: Caroline Chartier-Boileau, grande mère oncle Borromée Boileau. En haut: sœur Marthe, Père Achille Boileau C.R.I.C. , Sœur Marie-Anne, sœur Augustine
Noms des oncles (les enfants de Dosithée Boileau), tantes et enfants
Issus de leur union, quatorze enfant :
· Dosithée (jr) marié à Clara Chartier (sans enfant)
· Charles-Borromée, marié à Caroline Chartier.
· Borromée (jr), Bertha, Achille, Alphonse, Marie-Anne, Bruno, Augustine, Marthe, Athanase, Léopold, Germaine, Agnès, Jeannette, Thomas.
· Alphose marié à Malvina Panneton. Issus de leur union sept enfants: Damien, Marie-Flore, Adéodat, Lucien, Juliette, Yvan, Corne.
· Eugène marié à Marie-Louise Beauchamps (sans enfant).
· Marie-Élisa mariée à Arthur Lalande. Issus de leur union six enfants: Arthur (jr), Élisabeth, Fortunat, Charles-Auguste, Borromée, Lucille.
· Joseph, premier mariage avec Marie-Anne Beauchamps. Issus de leur union: Émile, Lucienne, Jeanne. 2e mariage avec Marie-Rosé Desjardins. Issus de cette union: Ernest, Rosaire, Bernadette, Rita, Marie-Paule, Laurent, André.
· Edmond marié à Virginie Badeau. Issus de leur union: Antoinette, Lucille, Etienne, Camille, Maria-Anne, Agnès, Élisabeth.
Retour à la table des matières