NOTRE VIE À NOMININGUE AU FIL DES ANS
(1909 – 1940)
Déménagement permanent de l’Annonciation à Nominingue (1909)
Papa était bien découragé du peu de réussite qu'il avait. Grand-mère Lalande qui connaissait sa situation précaire lui conseillait de revenir à Nominingue. Avant sa mort, en juin 1909, elle fit promettre à son mari, grand-père Anthime, d'aider papa à revenir à Nominingue. Donc, à l'automne de 1909, la famille s’en vint passer l'hiver chez grand-père Lalande à Nominingue.
Papa vendit sa terre à l'Annonciation où il avait demeuré six ans, et attendait la chance d'en acheter une autre à Nominingue. Tout l'hiver il travailla pour son père. Grand-père Lalande, l'année précédente, avait acheté des messieurs Charbonneau les deux terres voisines sur le Chemin Chapleau. Il les destinait à deux de ses garçons. Mon père profita de l'occasion offerte et acheta les deux cents acres de terrain avec maison et bâtiments très précaires qui s'y trouvaient. Ce fut ce lieu qui présida à la destinée de toute la famille depuis 1910, jusqu’à maintenant.
C'est donc au printemps 1910 que s'effectuait l'arrivée de la famille Arthur Lalande, composée du père, de la mère et de cinq enfants. Borromée qui était le plus jeune avait 31/2 ans. Ce n'était pas reluisant. La maison était abandonnée depuis deux ans alors que les bûcherons s'y étaient logés pour couper du bois. Ce n'était pas très propre puis l'escalier qui conduisait à la porte d'entrée s'était effondré durant l'hiver. Mon père installe temporairement des madriers pour que ma mère et les enfants puissent entrer dans la maison. La première phrase de maman fut celle-ci: « Nous sommes enfin chez-nous et j'espère que nous y habiterons longtemps ». Son rêve s'est réalisé pleinement puisqu'on 1982, je l'habite encore! L'hiver passé chez mon grand-père avait été très long pour elle qui n'aimait pas déranger! Alors, même si la maison n'était pas accueillante, elle se sentait heureuse et travailla avec entrain à l'installation du foyer, encourageant sans cesse mon père et les enfants à aider selon leur capacité respective.
Il fallait recommencer à zéro dans ce nouvel endroit. Mon père n'était pas en excellente santé. À l'Annonciation où il travaillait très fort à l'usine et sur sa terre, il avait contracté une diarrhée chronique qui dura cinq ans. Il n'était pas très fort physiquement mais travaillait avec ardeur quand même, pour nettoyer les alentours de la maison qui étaient parsemés de « souches ». Quel décor déprimant ce devait être !
Avec l'ambition qui caractérisait mes parents, l'effort de chaque jour apportait une amélioration sensible au confort de la vie quotidienne.
Mes oncles Boileau venaient aider mon père pour de nouvelles constructions et réparations de ce qui existait déjà. Pour donner plus d'espace à la famille, mon père fit construire une cuisine d'extension (celle que nous avons encore).
Mon père retrouva sa santé peu à peu à mesure que la culture progressait. La terre, le sol est d'excellente qualité sauf qu'il y avait beaucoup de roches. Un nombre incalculable d'heures et de jours ont été consacrés à « l’érochage », ce qui faisait partie du travail d'autrefois avec les chevaux et de bons bras d'homme. Mon père se passionnait pour l’agriculture. Il était abonné à plusieurs revues agricoles et essayait de pratiquer les théories inscrites dans ces revues. C'était un homme de progrès; il fut membre du Cercle Agricole qui avait été fondé quelques années auparavant dans le Canton Loranger. Ce fut le début des activités paroissiales mais pas les dernières. Je parlerai un peu plus tard des études de ma sœur et de mes frères.
Si l'année 1913 fut une année de deuil (décès de mon grand pète Anthime Lalande) il y eut une compensation dans notre famille. Ce fut « ma naissance » le 23 juin.
Nos modestes études à l’école primaire, la seule disponible !
Ma sœur, mes frères et moi-même avons fait nos études à l'école du village où les religieuses de Ste-Croix enseignaient admirablement bien au cours élémentaire. À ce moment-là, l'instruction n'allait pas plus loin que le primaire. Étant la plus jeune, j'ai eu l'avantage d'aller dans un cours plus avancé.
Le transport scolaire ne s'effectuait pas en autobus comme de nos jours. Le trajet s'effectuait à pied sur une distance près de deux milles le matin et le soir. Parfois mon père travaillait à l'extérieur et pouvait ramener les enfants le soir lorsqu'ils sortaient de l'école. C'était une fête pour eux.
Durant quelques hivers, pour arriver à survivre et rencontrer les paiements obligatoires, mon père charroyait des billots jusqu'à la Minerve. Il partait très tôt le matin et revenait tard le soir. Mes frères voyaient au soin des animaux avant la classe et après la classe. Arthur, à cause de sa santé précaire, ne pouvait fréquenter l'école. Alors il aidait ma mère dans la maison et s'occupait de l'étable durant le jour.
Quand il y avait des tempêtes, les chemins n'étaient pas toujours ouverts; il fallait vouloir s'instruire pour marcher dans la neige aux genoux et nous avions l'ambition de ne pas manquer la classe disaient ma sœur et mes frères. Moi, j'ai été privilégiée, je n'ai pas marché dans la neige comme les plus vieux. J’ai commencé à l’âge de 7 ans et comme Borromée était dans sa dernière année scolaire, papa avait acheté un cheval commode et une voiture à deux roues pour l'automne et le printemps, « un selquier ». Nous voyagions tous les deux ; Borromée en arrivant le matin dételait le cheval et le mettait dans l'étable chez mon oncle Émile Lalande et après la classe, nous nous rendions chez mon oncle pour reprendre notre voiture et revenir chez nous. Ça ne dérangeait personne, Borromée étant très habile et vif. Je n'oublierai jamais cette première année d'école. J'avais mon chevalier servant qui s'occupait de moi. Je me sentais en sécurité avec mon grand frère qui était mon aîné de sept ans.
L'année suivante, il laissa l'école mais il venait me conduire chaque matin et le soir quelqu'un venait me chercher. Celui de mes frères qui était disponible. Un peu plus âgée, le soir je revenais à pied, puis l’hiver on me mettait en pension au village; une année je fus pensionnaire au couvent. Je m’ennuyais beaucoup, car j'aimais « trop » mes parents et mon chez nous. Est-ce un défaut que de tant aimer ceux qui ont fait tous ces sacrifices pour nous ?
Ma sœur manquait quelques fois la classe pour aider maman qui n'était pas très forte. Ça lui faisait de la peine, car Élisabeth aimait l'étude. Elle a commencé très jeune à aider ma mère qui a été victime de malencontreux accidents.
Ma mère victime de deux accidents graves et d’une hémorragie cérébrale
Ainsi, j'avais à peu près un mois lorsque ma mère, qui
était à étendre le linge dehors, tomba d'assez haut suite au décrochage de
la corde. Elle se brisa un poignet, ce qui la fit terriblement souffrir. Malgré
les soins du médecin, son poignet reprit croche et la douleur revenait parfois.
Mais, elle ne se plaignait jamais.
Environ cinq ans plus tard, par un dimanche pluvieux, la voiture s'arrête pour permettre à maman de débarquer pour aller à la messe. Papa avait sauté le premier pour aider maman à descendre et c'est Arthur, mon frère, qui tenait le cheval par la bride. Celui-ci bougeait sans cesse, papa attendait que la voiture s’immobilise pour prendre maman dans ses bras. Hélas, ce fut trop tard. Le cheval prit peur du parapluie qu'Arthur tenait dans une main et partit à l'épouvante. En tournant la rue, la voiture versa et maman fut projetée par terre, le siège de la voiture lui enleva son chapeau; c'est un miracle qu'elle n'ait pas été assommée mais elle eut une cheville brisée. Moi qui accompagnais mes parents (j'avais cinq ans) en petite robe blanche, je suis tombée plus loin dans la boue sans aucun mal. Nous étions tout près de chez oncle Raoul.
Alors, papa transporta maman dans ses bras chez ma tante Eugénie et avertit le Dr Alfred Adam qui était déjà rendu à l'église, il faisait partie de la chorale. Il vint en toute hâte pour lui prodiguer les soins urgents. Comme ça ne faisait pas assez longtemps que maman avait déjeuné, il ne put l’anesthésier ou l'endormir. Il lui replaça les os brisés à froid. Combien elle a dû souffrir cette pauvre maman! Après avoir replacé les os de la cheville, il lui mit le pied et une partie de la jambe dans le plâtre. Il s'était écoulé passablement de temps alors elle avait le pied enflé lorsqu'il lui fit son plâtre. Elle a beaucoup souffert pendant quarante jours.
Mes cousines Laurence et Gertrude s'occupèrent de me laver le visage rempli de boue; je pleurais pour ma robe toute salie. Elles l'ont peut-être lavée, je ne m'en souviens pas. Elles prirent bien soin de moi, pendant que tante Eugénie, avec papa et le médecin s'occupaient de maman.
Après l'enlèvement du plâtre, je me rappelle qu'elle marchait le genou sur une chaise pour se déplacer, pendant plusieurs jours. Sa première sortie avec une canne fut pour la confession de Noël. Pendant cette longue période, Élisabeth avait la charge de la maison et de la famille. Peu à peu, maman se remit de cet accident qui ne gêna pas son pied par la suite, elle revint en bonne santé. Ce fut une rude épreuve qu'elle a surmontée vaillamment!
Plusieurs années après, en décembre 1937, maman fut victime d'une hémorragie cérébrale provoquée par une haute tension artérielle. En toute hâte, Charles-Auguste alla chercher le médecin qui enleva à maman trois chopines de sang pour l'empêcher de paralyser complètement. Une paralysie partielle dura une dizaine d'heures. Elle reçut l'Extrême-Onction durant la nuit, le médecin ne pouvant affirmer si elle reviendrait de cette attaque. Elle ne devait bouger sous aucun prétexte. Après dix jours de bons soins attentifs et de ferventes prières, nous fûmes exaucés et maman revint complètement de sa paralysie mais sa convalescence fut très longue. Elle fut presque un an sans pouvoir travailler, mais Dieu nous l'avait conservée en vie, c'était l'essentiel! Elle devait se surveiller continuellement. Le médecin la traitait pour sa haute pression à cause du durcissement des artères qui s'accroissait par étape. Elle avait alors 60 ans.
Après une année, elle redevint normale et pouvait accomplir son travail comme avant sa maladie! Elle était cependant plus fragile.
Mon père entre en politique municipale (1917 - 1938)
pour le meilleur...
Mon père commença à oeuvrer en politique municipale dans le Canton Loranger en 1917. Il fut d’abord élu échevin; puis quatre années plus tard, le 7 juin 1921, il devenait "maire" pour le demeurer jusqu'en 1939 sans interruption. Il donna sa démission le 12 décembre 1938. Il n'a subi qu'une seule élection à la mairie dont il a remporté la victoire. Il fut donc toujours élu par acclamation.
Tout comme son père, il possédait les qualités nécessaires à tout homme public! Son dévouement à la bonne cause n'a pas connu de bornes ! Ce fut du bénévolat complet pour toute la durée de son règne. Il aimait sa paroisse de tout son cœur et travaillait sans relâche pour le bien-être de tous ses concitoyens!
...et pour le pire
Cependant, son engagement dans la politique municipale, surtout comme maire, causa, un jour, un grand « désarroi » à toute la famille, pour une raison tout à fait injustifiable de la part de ses adversaires. Je me dois de raconter ce fait vécu que plusieurs ne se rappellent pas ou ne connaissent pas (il y a si longtemps que la chose s'est passée). Pour les générations futures de ma famille, ce sera une révélation!
En 1917, lorsque mon père fut élu échevin, il y eût élection à la mairie entre monsieur Sem Lacaille (maire sortant) et monsieur Thomas Potvin, marchand et commerçant de bois du village. M. Thomas Potvin remporta la victoire et demeura maire jusqu'en 1921. C'est sans doute pour cette raison que Bellerive se sépara du Canton Loranger en 1920 et M. Lacaille, riche industriel du domaine forestier, devint le maire de ce premier conseil municipal.
Au début de 1921, monsieur Thomas Potvin démissionna comme maire du Canton Loranger! Pour quelle raison? Tous ceux que j'ai interrogés l'ignorent totalement. Mon père a donc été désigné pour le remplacer le 7 juin 1921. Peu après, sa « qualification » fut contestée par le maire de Bellerive. Il prétendait que mon père ne possédait pas la valeur marchande immobilière pour accéder à ce poste. La somme de $500 était requise. Pourtant, les deux cents acres de terre que mon père (Arthur Lalande) avait achetés de mon grand-père par contrat en 1911 valaient beaucoup plus que ce montant! Il ne pouvait donc y avoir de « disqualification »! Mais cela devenait quand même matière à procès!
Mon père s'empressa d'en parler à Monsieur le Curé et aux conseillers réunis en assemblée! Tous s'accordèrent à dire que c'était une cause gagnée d'avance! Il devait demeurer à la tête de la Municipalité coûte que coûte, il possédait "l'écorce" pour diriger les destinées de la paroisse. Mon père fit quelques objections: « N'oubliez pas Messieurs », leur dit-il, « qu'un procès comporte toujours des risques! S'il fallait que je perde, je n'ai pas les moyens de payer, je ne suis pas riche vous le savez tous et M. Lacaille est puissant financièrement ». « Qu'à cela ne tienne » dirent les conseillers, nous sommes derrière vous! Nous pourrons fournir chacun cent dollars! Monsieur le Curé Bazin ajouta: « Vous voyez comment l'on vous aidera! » Pourquoi ces paroles ne furent-elles pas mises par écrit ? Trop de confiance sans doute! Mon père décida alors de présenter sa requête à la Cour pour relever le défi de sa « qualification ». Il choisit maître Achille Delage de Nominingue pour le représenter et monsieur Lacaille, maître Wilfrid Lalonde de Mont-Laurier.

Mon père
Le jour du procès, en présence des deux avocats et des deux clients, le juge, dont je ne me souviens pas le nom, ne rendit pas son verdict immédiatement « Je vais étudier la cause du plaignant », dit-il, « je rendrai ma décision plus tard et vous en avertirai ». Mon père avait donc le privilège de siéger à la mairie comme auparavant.
La réponse du juge ne parvenait à personne. Un an, deux ans, trois ans, quatre ans s'écoulèrent sans rien apporter de nouveau à la situation! Après ce laps de temps, les deux avocats, voulant sans doute percevoir leurs honoraires, contactèrent un autre juge (à l'insu de mon père) qui prononça la sentence qui suit : « indéniablement le client Lalande possédait sa qualification, mais le condamnait quand même à payer tous les frais des deux avocats: $350 chacun, au total $700 ».
Mon père gagnait sa cause, mais devait payer, en plus de son avocat, celui de son adversaire! « Pourquoi » se disait-il ? C'est que ce monsieur Lacaille malgré ses grandes qualités était un entêté indomptable! « j’ai perdu ma cause, mais je ne paierai aucun frais d'avocat. S'il le faut, je me rendrai au Conseil Privé de Londres ». Lorsque mon père reçut l’avis juridique, il était consterné. Mais, il fallait s'incliner devant cette injustice. Il annonça la nouvelle à maman et au reste de la famille ensuite. Nous n'avions pas un sou pour payer ! Mon père dit: « Je vais d'abord avertir les Conseillers de ma situation. Je verrai où se trouvent mes véritables amis »!
À cette annonce, parvenue tardivement, personne ne broncha! C'était grave! Celui qui se prétendait son meilleur ami prit alors la parole pour dire : « II faut toujours payer pour apprendre ». Les cent dollars promis s'évanouirent avec cette phrase. Il fallut nous débrouiller et payer chèrement de nos deniers une dette injuste que mon père n'avait pas contractée pour lui-même. Lorsque mon père revint à la maison, c'était un homme anéanti, démoli. Vous imaginez-vous ce que représentait ce montant de « sept cents » ($700) dans la décennie 20? Il s’effondra, découragé, puis se repris. Il manifesta alors son désir de déménager loin de Nominingue. Il voulait tout vendre et s'en aller dans l'Abitibi. Tout recommencer ailleurs!
Recommencer courageusement. Toute la famille participe ...
Mais, « l'ange gardien » de la famille, c'est-à-dire notre mère, trouva les mots qui calmèrent son époux et une lueur d'espoir apparut dans ses yeux! Mon père n'était pas homme à se laisser abattre, il retrouva son courage de pionnier. Maman de son côté fit comprendre à mes frères qu'ils devaient soutenir et seconder leur père en tout pour vaincre cette lourde perte! La première solution et la seule qui s'imposait était d'emprunter de l'argent pour payer les avocats. Mon père s'adressa à sa sœur, tante Béatrice qui disposait de cette somme. Un intérêt de 7 % l'an fut convenu entre eux, pour la remise du capital, le temps ne fut pas fixé ! Mais aussitôt mon père s'organisa pour pouvoir remettre ce capital le plus vite possible.
...et exploite un lot forestier dans des conditions presque inhumaines
Après consultation avec ses garçons, mon père décida d'acheter un lot ou une terre à bois pour en faire le commerce ! Il trouva une bonne occasion d'achat, le lot 25 dans le rang VII sud. C'était une ancienne terre sur laquelle il y avait une maison rustique mais habitable et une petite écurie pour loger les chevaux. Ce qui a été très pratique pour loger les travailleurs.
Tout d'abord, contre garantie, mon père obtint un crédit d'argent de la banque Canadienne Nationale puis un crédit de provisions du marchand Hermas Fournelle. Des équipes de coupeurs de bois furent engagées pour préparer du bois de chauffage en érable de trois pieds de longueur. Leur travail consistait à couper, fendre le bois, le corder pour qu'il soit mesuré. Ils recevaient le salaire de deux dollars la corde. Il n'existait pas de « scie mécanique » à cette époque. Une scie à lame et un godendart. Le bois était beau mais situé sur une montagne et dans le flanc, ce qui rendait le charroyage plus difficile! Le coupage se faisait l'été et début automne. Dès que la neige arrivait pour de bon, commençait l'ouvrage de mes frères. Papa dût acheter un cheval pour combler deux équipages doubles et un autre pour voyager les commissions et les provisions. Il nous en fallait un sur la ferme pour tous les déplacements d'occasion. Cette montagne se trouvait à environ 4 1/2 milles de chez nous et 6 1/2 du village. C’était un travail dur et pour les hommes et pour les chevaux. Borromée conduisait deux chevaux plus âgés et plus robustes, et Charles-Auguste des chevaux plus jeunes, moins entraînés à l'ouvrage. Ils descendaient le bois de la montagne en grosses « sleigh » par petites charges et le déposaient sur un endroit plat non éloigné du grand chemin.
Durant toute la semaine, mes trois frères Fortunat, Charles-Auguste et Borromée vivaient dans la maison du lot 25. Il y aurait eu trop de temps perdu s'ils avaient voyagé chez nous matin et soir et beaucoup plus de fatigue pour eux. Quand l'hiver était vraiment arrivé, le dimanche après-midi, c’était un vrai déménagement chez nous. Il fallait être sur les lieux de l'ouvrage le lundi matin! Une voiture emportait la nourriture pour les quatre chevaux, foin et avoine. Dans l'autre voiture, c'était les provisions des hommes. Maman et Élisabeth préparaient du pain de ménage, des pains devrais-je dire, beurre, viandes cuites variées ou à cuire, une grande quantité de galettes, tartes, pâtés, mélasse, etc. Fortunat était le cuisinier attitré. Ses pensionnaires avaient beaucoup d'appétit. Le travail fatiguant et le grand air ouvraient l'estomac! Ils faisaient honneur à ses repas!


La gare et train

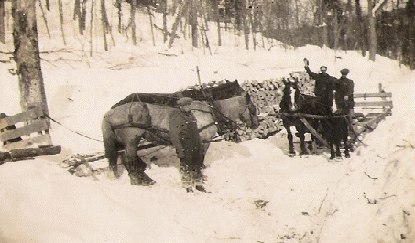

Le bois
Papa allait les visiter au milieu de la semaine, s'enquérir de l’état de leurs travaux, donner de l'encouragement et des conseils à l'occasion. Maman ne manquait pas d'envoyer, à cette occasion, un surplus de nourriture.
Depuis l'acceptation de cette épreuve et les moyens positifs élaborés pour s'en sortir, le calme et la sérénité étaient revenus à la maison. Arthur et papa s'occupaient du soin des animaux à la ferme pendant que les autres travaillaient dans le bois. Lorsque la quantité de cordes descendues de la montagne était suffisante, on retenait un wagon du Pacifique Canadien pendant deux ou trois jours pour transporter les cordes de bois à la gare, remplir et placer ce bois dans le wagon du « fret ». Comme une des photos le démontre, Arthur descendait au village et aidait au chargement du bois dans le wagon. Il aimait faire ce travail.
Il y avait un chemin raccourci qui traversait la largeur des lots pour se rendre là où le bois devait être déposé au village. La distance était moindre mais à cause des tempêtes, ce chemin n'était pas toujours avantageux! Lorsqu'il faisait beau, mes frères en profitaient pour mettre des charges plus lourdes. Fortunat les aidait pour le chargement dans les voitures.
Lorsque le wagon était rempli, 22 cordes ou 23 cordes, il était scellé et partait pour Montréal à l'adresse de Monsieur Henri Rosé de Pointe-Claire. Papa avait trouvé ce commerçant acheteur. Celui-ci possédait un clos de bois et faisait la livraison par petites quantités à Montréal. Comme c'était du bois demi-vert ou vert, papa obtenait le prix de $6.00 la corde de bois de trois pieds. Enlevez $2 pour la coupe, il restait $4 pour le transport au village, le chargement dans les voitures et dans le wagon. Le bénéfice n'était pas très élevé. Heureusement que la nourriture des chevaux venait de la ferme, foin et grain. Un travail sans répit qui dura trois ans pour venir à bout de la dette. Et en plus, que de travail l'été pour procurer l'alimentation aux animaux durant l’hiver !
L'été sur la ferme et l'hiver dans le bois! Toute la famille apportait sa collaboration sans salaire fixe. Un seul objectif animait tous et chacun, remettre l'emprunt d'argent au plus tôt. Personne n'était malheureux malgré tout. La vie apportait ses joies et ses plaisirs. Mes frères qui habitaient dans le VII sud prenaient quelques distractions en allant veiller chez les voisins. Le premier était M. Antonin Nantel, célibataire assez âgé qui possédait une belle collection de musique classique sur disques. C'était un homme cultivé et très renseigné. Il lisait beaucoup et connaissait passablement l'histoire de la musique, des chanteurs d'opéra et de belles mélodies. Lorsqu'il veillait avec des auditeurs attentifs, il était très intéressé de les renseigner. Ce qui faisait le bonheur de mes frères et de Fortunat en particulier. En face, il y avait un voisin d'un autre genre, M. Germain Cornut dont les garçons et filles étaient de l’âge de mes frères. Des conversations variées et jeux de cartes étaient à l'honneur. Quelquefois ils se rendaient jusque chez Monsieur Arthur Nantel qui demeurait un peu plus loin.
Durant deux ans, le commerce de bois fonctionna très bien. Nous expédiions six chars par année. Je crois que ce fut treize wagons de « fret » en tout. Le capital d'argent progressait lentement. Par contre, le bois devenait moins avantageux dans la montagne, il se faisait plus rare. Entre-temps, le gouvernement provincial accordait aux cultivateurs le privilège d'acquérir des lots de colonisation, appelés « lots de soutien ». Papa s'en procura deux, les numéros 16 et 17 qui se situaient en bordure du lac des Monts, non loin du lac des Grandes Baies. Peu après, il concéda le lot 16 à oncle Ernest. Le lot 17 se composait d'une variété assez grande d'arbres, érables, merisiers, mais surtout de très beaux « pins », sapins, épinettes.
Monsieur Lacaille regrette ?
Peu après cette acquisition, monsieur Lacaille lui-même fit venir mon père chez lui pour une demande importante. Mon père, très intrigué s'y rendit. M. Lacaille lui dit: « Vous avez obtenu un lot de colonisation du gouvernement »? « Oui », répondit mon père. « C'est un lot tout neuf qui n'a jamais subi de coupe de bois? ». « C'est vrai », répondit papa. « J'aurais besoin dans mon usine de très beau pin pour remplir une commande spéciale. Pourriez-vous me vendre trente mille pieds de billots de pin et me le rendre jusqu'ici avec vos chevaux? Je vous paierai $40 du mille pieds. » C'était un prix très élevé pour l'époque. Mon père accepta.
En arrivant à la maison, il nous dit: « Je crois qu'il veut atténuer les torts qu'il nous a causés »! La rancœur n'est plus de mise quand on a besoin d'argent. Ce rapprochement était en même temps un réconfort moral. Il traita mon père avec déférence. Il ne lésina ni sur la mesure ni sur le prix. Il ne faut pas oublier que la distance du transport du bois était d'environ dix milles.
Pour mes frères, après le bois de cordes, ce fut donc la manipulation de billots : la coupe (toujours avec des outils rudimentaires), la mise en amas (roule) puis le charroyage. Je ferai très sommairement le bilan de cette entreprise. Pour le charroyage, mon père engagea des charretiers de l'extérieur. Ce n'était pas facile de les garder. Il n'y en a qu'un qui observa son contrat jusqu'à la fin et Borromée dût prendre la relève des autres.
Le trajet était long pour les chevaux et pour les hommes qui marchaient en arrière de leur charge lorsqu'il faisait trop froid. Mon frère me racontait récemment ceci. Un jour qu'il arrivait chez M. Lacaille avec sa charge, notre pauvre jument « Nancy » boitait assez gravement. M. Lacaille s'en aperçut et vint vers moi m'expliquer la cause du mal de pied de ma bête. C'était un homme d'expérience! « J'ai remarqué », dit-il, « depuis quelques jours, ta jument a un pied « sensible », aujourd'hui, c'est plus grave ». Il regarda lui-même son pied en repliant son genou et il dit à Borromée: « Vois-tu, elle a un mauvais ferrage, le forgeron lui a enlevé trop de corne sous son fer; à l'avenir, ferre-la toi-même et dispense-toi de lui enlever de la corne. Tu connais ta bête mieux que le forgeron. Laisse-la reposer pendant deux à trois jours avant de reprendre le charroyage. Conseil judicieux que mon frère suivit et la pauvre bête s'en porta très bien. M. Lacaille se rendait vraiment utile par ses conseils.
La saison terminée, la vente du bois avait rapporté un montant intéressant. À la même période, tante Béatrice écrivit qu 'elle avait besoin de son argent. Pour ne plus être lésé dans nos finances, papa décida de vendre la montagne du lot 25 ce qui rapporta une petite somme rondelette et avec l'argent amassé par le commerce de bois, capital et intérêt furent payés au complet! Quel soulagement! Notre cauchemar était terminé. Nous n'avions plus aucune dette.
Notre vie sur la ferme : travail, fêtes familiales et vie culturelle (1920 – 1930)
En même temps que les événements paroissiaux se déroulaient, qu'advenait-il de notre vie familiale? Reportons-nous dans la décennie 1920 à 1930 pour parler de ce qui se passait sur la ferme.
Le métier d'agriculteur demande beaucoup d'abnégation pour le gagne-pain quotidien. Les heures de travail sont longues, surtout le printemps et l'été. Avec l'aide et la coopération qu'apportaient mes quatre frères, mon père pouvait agrandir et améliorer les champs d'année en année. Ma mère aimait autant la terre que mon père. Elle était très encourageante. Alors, celui-ci l'amenait chaque dimanche de beau temps « voir pousser » le grain et les patates. Ils s'appuyaient tous les deux sur la barrière du grand champ d'où ils pouvaient constater le progrès de la récolte. Je les accompagnais parfois malgré mon jeune âge, j'en étais ravie!
Le souvenir qui m'émeut le plus quand j'y repense c'est lorsque j'allais porter la collation de mon père chaque après-midi au fond du grand champ! Il fallait que papa mange dans l'après-midi, alors maman préparait de bons sandwiches pour papa et les garçons, avec une bonne bouteille de thé froid que mon père affectionnait. Maman ne manquait jamais de faire un petit sandwich pour moi. Elle mettait le tout dans un sac de papier bien attaché et me recommandait de faire attention de ne pas tomber pour briser la bouteille de thé qui faisait les délices de mon père. Lorsqu'il me voyait arriver, il choisissait une belle roche pour nous asseoir tous les deux. Il ouvrait le sac, offrait des sandwiches à mes frères et des bonnes galettes au beurre. Là il s'écriait: « il y en a une petite pour toi », il me la remettait avec affection. J’étais si heureuse de la manger avec lui. Il me faisait remarquer les beaux arbres qui nous entouraient. C'était un amant de la nature. Puis, dès qu'il retournait au travail, il me disait: « Bon, regagne la maison pour que maman ne soit pas inquiète. Dis-lui que c'était bien bon, que je lui dis un gros merci »! Ça devenait une aventure très importante pour moi de faire la commissionnaire.
Les hommes travaillaient sans relâche pour faire de bonnes semences qui donnaient d'excellentes récoltes quand la température était favorable. Le sol ne les décevait pas. Plus il était travaillé et engraissé, plus il produisait abondamment. Deux bons chevaux augmentaient le succès des travaux. Les récoltes de grain et la production du foin étant meilleures, on augmenta le troupeau de vaches laitières. Des « ayrshires ». C'était la race que mon père préférait. Nous élevions aussi des porcs, des veaux, moutons et des volailles. De quoi nourrir toute la famille sans trop acheter à l'extérieur. L'agriculture en ce temps-là était souvent un état de vie, presque une vocation et non un métier lucratif. Il fallait que le personnel aime ce métier qui comporte des avantages et certains désavantages comme l'absence de salaire. À cette époque, on ne pouvait payer les employés bien cher et toute la famille devait donner son temps pour la réussite familiale.
Vers 1919, il fallut remplacer certains bâtiments. La grange fut la première bâtisse renouvelée. Mon père était bon charpentier. Avec les garçons, il allait dans le bois pour abattre les arbres nécessaires. Avec les chevaux, on transportait le bois dans la cour et papa préparait les pièces de longueur requise, soles, chevrons, etc. disposait le bois « équarri » à la hache, avec une hache spéciale que je possède encore. Il plaçait les pièces de bois de manière à pouvoir installer la construction du bâtiment très rapidement. J'étais jeune, mais je me rappelle très bien la construction de la grange qui s'éleva en une journée avec la couverture en planche. Mon père avait travaillé un grand mois pour préparer tous les morceaux à leur place! Puis il organisa une corvée; seize (16) hommes sont venus prêter main forte; mes oncles Lalande et Boileau, même des cousins de Ste- Scholastique! Quel plaisir pour eux!
Imaginez la cuisine pour deux repas avec cette quantité d'hommes ! Maman était vraiment organisatrice et excellente cuisinière; Élisabeth la secondait fortement. Il devait sans doute y avoir quelques tantes pour aider au service de la table ! Avec la nourriture appropriée, les hommes étaient encouragés et heureux d'être venus « aider Arthur » disaient-ils! Tout s'est fait bénévolement! Comme on s'entraidait autrefois! Le repas du soir avait été très joyeux. La journée étant si fructueuse, tous les bénévoles étaient satisfaits, chacun y allait de son histoire, « tours de force » ou de sa chanson. Mon oncle Joseph Boileau savait faire rire son auditoire avec ses chansons comiques. Il venait souvent nous rendre visite ainsi qu’oncle Eugène spécialiste en « tours de force » et jeux de société. C'était très gai dans la maison à cette époque. On savait se "désennuyer" après le travail!
Par la suite, il y eût d'autres constructions : le hangar et l'étable. La grange et le hangar furent recouverts de grands bardeaux de cèdre faits par mon père. En 1930, ce fut la construction du poulailler et d'une colonie pour l'élevage des poussins. Le gouvernement provincial avait accordé une subvention si c’était construit selon les plans tracés par le chef aviculteur. On encourageait fortement l'aviculture. La colonie-éleveuse contenait 300 poulets et le poulailler, 150 pondeuses. C’était passionnant, maman faisait sa grande part avec mon père dans l'élevage des poussins. C'était aussi très délicat lorsqu'il se déclarait une maladie chez les poussins. Nous n'avons jamais subi de grandes pertes fort heureusement. Une année, un concours fut organisé chez les aviculteurs de la paroisse et ma mère gagna le premier prix. Elle était bien heureuse et nous aussi. Elle avait reçu soixante quinze dollars ($75). Elle aimait beaucoup les volailles surtout les petits poussins Rhode Island. « Ça me repose de la maison » disait-elle!
Nous avons continué durant de nombreuses années, même après la mort de ma mère Nous avons toujours élevé des poules, pas en aussi grande quantité cependant, mais suffisamment pour produire de bons oeufs frais. Chaque printemps, on faisait couver les poules pour remplacer avec de jeunes poulettes, les poules trop âgées. Les cochets (coqs) allaient à l'engraissement pour être tués, en décembre, au temps froid. Parfois, on les enneigeait, ils se gardaient frais. Le poids de ces coqs variait entre sept et neuf livres. Quels festins savoureux nous accordaient ces bonnes volailles. Chaque dimanche, nous mangions du poulet.
Au temps des fêtes, nous recevions la famille de nos parents et la grande table était bien garnie. Selon la quantité des convives, maman faisait cuire deux à quatre poulets exhibés sur un magnifique plat au début du repas. Quelle viande délicieuse au palais! Papa dépeçait la volaille au bout de la table et servait chacun généreusement à tour de rôle! Maman recevait de merveilleux compliments pour son excellente cuisine. Ajoutons au poulet, du rôti de porc avec graisse de rôti, délice de tous les hommes, tourtières, tartes, gâteaux, beignes, sucre à la crème, etc.
Élisabeth commença très tôt son rôle de cuisinière à l’école de ma mère. Elle devint par la suite un vrai cordon bleu! Ordinairement les oncles Boileau venaient à Noël ou aux Rois (l'Épiphanie) et les oncles Lalande au Jour de l’An. Pendant plusieurs années, mes parents recevaient les frères de mon père qui habitaient Nominingue. Oncle Alfred, Ernest, Émile et leur famille. Nous étions une soixantaine parfois! Papa étant l'aîné, c'était un devoir pour lui. Les traditions étaient observées religieusement! Après la table desservie, les amusements prenaient place; chants, musique et même danse. Mes oncles chantaient si bien à deux et même trois voix; ténor, baryton et basse.
Quelle journée mémorable que celle du jour de l'An! Le matin, c'était la bénédiction paternelle suivie de la distribution des cadeaux, le déjeuner familial en dégustant un bon verre de vin maison. Ensuite l'assistance à la messe pour recevoir la bénédiction de M. le Curé pour passer une Bonne Année, puis la préparation du souper traditionnel. Une journée bien remplie. Quelle joie de se rencontrer cousins et cousines. Ainsi se célébrait au temps de jadis la venue de l'An nouveau!
Nos parents désiraient pour nous des distractions culturelles intéressantes que pouvait offrir notre époque. Ils possédaient un goût inné pour la musique et la lecture. Ce furent donc les deux distractions principales à l'intérieur de la maison. Aussitôt que ma sœur et mes frères aînés quittèrent l’école, mon père prit un abonnement à la bibliothèque du Couvent des Sœurs Ste-Croix. On pouvait échanger des livres à volonté. Inutile de vous décrire le bon choix de ces lectures qui augmentaient nos connaissances culturelles.
J'avais cinq ans lorsque mon père fit l'acquisition de notre premier phonographe (Corona). Quel événement « sensationnel ». Quelques disques « Pathé » furent les premiers à se faire entendre! Quelles magnifiques soirées nous passions à écouter les beaux disques! C'était une belle récompense après une journée de travail parfois rudement accomplie. Le disquaire nous avertissait lorsqu'il recevait de nouveaux disques. Alors vite, on allait s'en procurer un, parfois deux ou trois selon nos moyens financiers. Ainsi le temps s'écoulait agréablement.
En 1924, papa
acheta l'harmonium de tante Béatrice que grand-père s'était procuré en 1894.
Souvenir de famille que je possède encore. Ce fut un événement tout à fait
mémorable qui élargissait le champ de nos distractions. Et pour moi
personnellement, je sentais que c'était « mon » instrument qui
entrait dans la maison. Mon amour pour la musique s'intensifia. J'avais onze
ans et beaucoup d'oreille. Pendant six mois, j'appris à jouer par oreille les
airs du temps que j'entendais sur disque ou chantés par mes parents. Je
m'efforçais de leur faire plaisir. Au début de l'année scolaire, mes parents
décidèrent de me faire apprendre le piano chez les religieuses afin de me faire
acquérir la vraie technique musicale. Je serais au même niveau que mes
cousines. J'étais très heureuse.
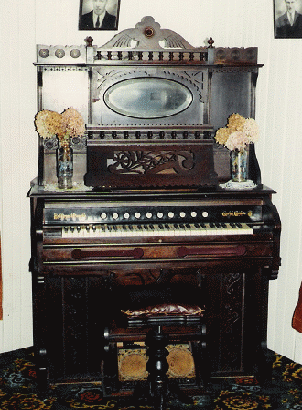
Harmonium 1894
Cependant, mon père prit soin de m'avertir que je ne devais jamais oublier de faire le bonheur de toute la famille par l'avantage qu'il me procurait d'apprendre la musique.
Mon père et mes frères s'imposaient le sacrifice de faire du bois de chauffage pour payer mes leçons de piano. Les religieuses utilisaient le chauffage au bois, donc c'était un échange. Je n'ai jamais oublié tout ce que je devais à ma famille pour les sacrifices qu'ils se sont imposés à mon égard. C'est un hommage que je leur rends publiquement! Je fus bien « choyée » dans mon enfance et mon adolescence par mes parents, ma sœur et mes frères ! J'ai toujours fait l'effort de ne pas les décevoir.
J'ouvre ici une parenthèse pour relater un détail qui me revient à la mémoire. Jusqu'à l'âge de cinq ans, ma mère me berçait pour m'endormir après le dîner. Elle me couvrait de son tablier et chantait de sa belle voix. Ces mélodies me comblaient de joie et je prenais un peu de temps pour m'endormir. Je voulais savourer ce plaisir le plus longtemps possible. J'avais déjà le goût du chant et de la musique. La dernière fois qu'elle me berça, je m'en souviens très bien! Je n’arrivais pas à fermer l’œil et je disais: « chante encore maman, le sommeil va venir ». Elle me répondit: « Sois raisonnable, j'ai tant d'ouvrage à faire. Je ne peux plus attendre. Tu es maintenant assez grande pour t'endormir toute seule » Pauvre maman!, je l'avais fait marcher ou plutôt chanter! Quel privilège d'avoir eu une telle maman!
J'étais consciente de mon bonheur et je voulais le faire partager par tous. J'ai étudié le piano durant 4 années. J'aimais profondément les études pédagogiques, mais les études musicales m'enchantaient; je pratiquais beaucoup avec l'ambition d'apprendre très vite. J'avais du succès, ce qui égayait la maison. Mes frères apprirent à chanter avec moi, les soirées étaient très agréables. Nous avions de très bons amis dans le rang VI et dans le rang VII sud. Nous nous visitions souvent, nous passions de beaux après-midi et de belles soirées le dimanche.

Charles-Émile Gadbois, Paul Lacroix
et Germain Lalande
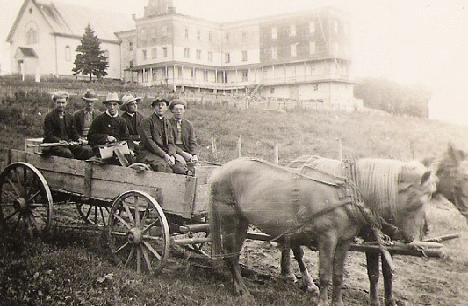
Retour d'une excursion au lac des Grandes Baies
C'est vers l'année 1923-24 que ma mère souffrit gravement d'épuisement, ce qui nécessita plusieurs visites chez le médecin. Maman et Fortunat voyageaient ensemble pou voir le médecin Robert St-Jacques et recevoir des séries d'injections tonifiantes et fortifiantes. Maman dut être une année au grand repos et prendre régulièrement des remèdes. En 1929-1930, ce fut au tour de Charles-Auguste de souffrir d'une dyspepsie nerveuse qui dura une année. Ce fut long. Il fit preuve de beaucoup de volonté pour guérir tout à fait, surmonter l'angoisse, etc. Avec le temps et la compréhension et prévenance des autres membres de la famille, qui jouissaient d'une bonne santé, celle de nos malades s’améliora pour finalement se stabiliser. Ma mère m'avait donné le rôle de distraire et d'égayer mes frères. Ce que je faisais de bonne grâce. C’était une période vraiment « creuse » pour la famille. Pas d'assurance maladie, il fallait tout payer même si on était pauvre. Il fallait que chacun prenne ses responsabilités pour maintenir le moral des autres.
Nous mettions nos efforts en commun pour améliorer notre cheptel de bovins. Charles-Auguste et Arthur travaillaient sur la ferme aidant ainsi mon père qui commençait à vieillir. Puis Élisabeth accepta d'être cuisinière dans des pensions de vacances d'été. Moi je commençai à m'engager comme institutrice. Tout en nous rendant utiles à la société, nous aidions nos parents au point de vue financier. C'était un bien mince salaire qui se gagnait à cette époque!
Au temps de la Bonne chanson !
Je ne puis énumérer toutes nos activités d'amusement. Fortunat qui dût prendre un long repos de plusieurs années à la suite d'une grave maladie, allait assez souvent à Montréal et achetait de la musique en feuilles, les chansons du temps, surtout les mélodies de Tino Rossi et autres. Notre répertoire de chansons grandissait rapidement
.
Nous avons eu la chance d'avoir quelques personnalités de choix qui ont touché l'harmonium. À l'été 1928, trois ecclésiastiques sont venus habiter une maison au village durant les deux mois de vacances. La maison appartenait aux religieuses de Ste-Croix. C'était notre cousin Germain Lalande qui devint par la suite directeur de chant au grand Séminaire de Montréal tenu par les Sulpiciens, l'Abbé Paul Lacroix et Charles-Émile Gadbois qui devint plus tard le directeur de la Bonne Chanson. Nous avons donc connu cette personnalité très jeune. Inutile de vous dire qu'ils visitèrent la « parenté », oncle Émile, Ernest, Alfred et chez nous. Ils partageaient leurs visites entre les quatre maisons. Quelles belles soirées de chants et de musique nous vivions! L'Abbé Gadbois affectionnait particulièrement jouer de l'harmonium et accompagner ses deux camarades qui chantaient très bien et nous, les jeunes, suivions leur exemple. C'est le directeur de la Bonne Chanson qui nous enseigna la ritournelle: « Vive le Nominingue, crions-le hautement en envoyant promener ceux qui ne sont pas contents » etc. On finissait chaque soirée par ce « thème » qui nous plaisait particulièrement et contribuait à nous faire aimer Nominingue. Quel souvenir inoubliable.
La musique et le chant aidèrent considérablement à traverser cette période critique. « La chanson nous apprend à fabriquer ensemble notre propre plaisir ». Les bonnes relations sont nécessaires aussi. Nous avions de bons amis, les familles Charbonneau, Leblanc, Thibault, Nantel, Hénuset et Ragot. Nous nous visitions régulièrement. C'était toujours nouveau de se rencontrer, une chaleureuse amitié nous unissait étroitement. Un bon cercle d'amis est très salutaire, les problèmes s'effacent et l'on devient joyeux. La qualité de la vie s’enrichit.
La famille Hénuset habitait Montréal. Elle venait passer les grandes vacances à Montigny à l'endroit où M. et Mme Hénuset avaient demeuré les premières années de leur mariage, au début des années 1900. Tous les « ans », ils revenaient habiter leur patrimoine. L'aînée de la famille, Germaine, était institutrice à Montréal. Elle possédait une culture raffinée et toute la famille également. Madame et sa fille organisaient de belles soirées auxquelles assistaient les familles mentionnées ci-dessus et la nôtre bien entendu.
Germaine Hénuset était une grande amie de ma sœur. À chaque année, elle faisait un court séjour dans notre famille, deux, trois, quatre jours parfois. Nous étions tous très heureux de la recevoir et surtout Élisabeth. Mme Alexis Hénuset était la sœur de Mme Conrad Gauthier, épouse du célèbre "folkloriste" québécois. Dans certaines occasions et soirées, nous avons eu l'honneur de rencontrer monsieur Conrad Gauthier et de l’entendre chanter son répertoire très étendu. Monsieur Gauthier était vraiment un homme remarquable, très jovial, d'une gaieté communicative. Une soirée passait vite en sa compagnie, interprète inlassable de chansons à répondre participant aux jeux de société organisés par l'hôtesse de la maison. Nous avons plusieurs disques – maintenant usés - de cet artiste de l'époque.
La vie publique à Nominingue durant la Grande dépression (1929 – 1939)
Ce n'était pas facile d'administrer une paroisse durant la
crise économique qui commence en 1929. Il n'y avait pas d'argent en
circulation. Les cultivateurs n'avaient pas d'argent pour payer leurs taxes. Il
fallait trouver une solution pour empêcher la vente des fermes. On devait donc
avoir recours au gouvernement provincial pour obtenir des subventions ou octrois
pour améliorer les chemins, fabriquer des ponceaux, etc. Le Conseil municipal
allait en délégation chez le député du Comté qui se faisait médiateur entre le
gouvernement et le Conseil municipal.
Lorsque les octrois étaient obtenus, chaque rang avait son inspecteur municipal. Alors celui-ci faisait travailler chaque cultivateur pour le montant de ses taxes, à tour de rôle ou ensemble selon l'ampleur des travaux à exécuter. De cette façon les agriculteurs payaient leurs taxes sans débourser d'argent. C'était du temps accordé avec leurs bras et leurs chevaux. Souvent, le transport du gravier se faisait l'hiver. Le charroyage était plus avantageux avec les « sleigh » plutôt qu'avec les « gros wagons ». On chargeait une plus grande quantité de gravier et c'était moins lourd pour les chevaux. Lorsque les citoyens travaillaient sur le chemin Chapleau, non loin de notre demeure, ils apportaient leur dîner et celui de leurs chevaux. Mon père invitait les hommes dans notre maison pour manger à la chaleur, et ma mère ou ma sœur leur servait du bon thé chaud pour accompagner leurs sandwiches et quelques fois de la bonne soupe; ce que les travailleurs appréciaient beaucoup. Mon père fut toujours très hospitalier et généreux. Son entrain faisait plaisir à tout le monde et redonnait du courage aux plus abattus. Ce n'est pas sans raison que les électeurs avaient confiance en lui, en son jugement, en sa manière d'être avec tous.
Simultanément avec la mairie, il fut président de la Commission Scolaire jusqu'en 1943, année de son décès. Président aussi du Cercle Agricole de la paroisse (Canton Loranger). Il oeuvra dans la vie politique municipale, scolaire, agricole, aussi longtemps que son père le fit à son époque. Il fut aussi marguillier. À la construction de notre église en 1933, il fut très actif apportant sa coopération, soit par des conseils ou des suggestions appropriées. Dans toutes les bonnes causes, il était présent, toujours prêt à donner de sa personne.
Quels que soient les moments de l'histoire que l'on traverse, des problèmes presque insurmontables surgissent en travers de notre route. Ce fut le cas de la vie personnelle, publique ou sociale dans les années 28 à 35. Ce n'était pas facile de gouverner. Il fallait suivre le progrès! Tout était à refaire avec très peu d'argent construction d'écoles de rang, de ponts, amélioration des routes et faire respecter les lois avec fermeté. Je me souviens très bien qu'une fois, la Municipalité dût intenter un procès contre certains commerçants de bois. Le Conseil municipal obtint gain de cause! Que de pertes de temps et de déplacements durant un mois à Mont-Laurier. Heureusement que la victoire couronna ce bénévolat.
En 1931, par l'entremise de Mlle Germaine Hénuset, nous avons connu une de ses amies, institutrice comme elle qui voulait connaître le nord et y demeurer quelques semaines, c'était Mlle Doralis Pesant. Germaine nous demanda si nous consentions à la recevoir comme pensionnaire chez nous! La demande fut acceptée avec un peu de gêne au début; mais Mlle Pesant était si gentille, si fine, elle voulait prendre ses repas avec nous à la table de famille. Elle nous mit bien à l'aise et devint une véritable amie de toute la famille. Elle s'intéressait à tout. À la culture, aux animaux, au jardin, elle possédait de nombreuses connaissances de ces choses. Puis au niveau culturel, c'était vraiment « quelqu'un »; une artiste distinguée possédant l'idéal du beau, du bon que procurent la musique et le chant. Doralis était douée d'une voix superbe; si expressive et chaude qu'elle nous faisait vibrer jusqu'au fond de l'âme! Le charme émotionnel que sa voix pouvait exercer sur ses auditeurs était « indescriptible ». Quel beau choix de chansons était le sien! L'harmonium s'est rendu utile et... moi aussi. J'étais transportée de joie d'avoir le privilège d'accompagner une personne qui chantait aussi bien! Comme je venais de réussir mon diplôme supérieur en juin de la même année, j'étais capable d'accompagner toutes les chansons même difficiles. Ma mémoire et mes doigts étaient entraînés. Doralis demeura avec nous trois semaines ou un mois. L'année suivante fût encore plus intéressante.
Le mariage de Borromée avec Jeannette Pesant (1933)
Mlle Pesant vint passer toutes les vacances d'été en pension à la maison. Puis quatre autres femmes de qualité louèrent la maison de Borromée que mon père avait achetée pour lui de mon oncle Alfred. C'était Mlles Eugénie Joly, institutrice, Gilberte Côté qui était lauréate en piano et qui avait fait son cours classique, Éliane Lefebvre, bachelière en sciences et Jeannette Pesant, sœur de Doralis, une femme incomparable et d'une « grande culture ». Elle devint ma belle-sœur l'année suivante. La Providence l'a conduite chez nous. Au point de vue culturel, l’été de 1932 fut un rêve!
Borromée était leur propriétaire, alors nos voisines nous visitaient presque tous les jours et les soirées nous les passions ensemble à ma grande joie! soit chez nous ou chez nos amis, particulièrement chez Mme Hénuset. Nous avons tous profité grandement de la venue de personnes aussi distinguées qui ont augmenté la qualité de notre vie. Après leur départ, les bonnes relations continuèrent par correspondance et visites à Montréal, car mon frère Borromée rendait visite à sa dulcinée et nous chez M. et Mme Rosaire Côté, parent de Gilberte qui demeurait sur le boulevard St-Joseph. Monsieur Pesant demeurait à Montréal-Nord, au bord de la Rivière des Prairies. Quel beau souvenir nous avons gardé de ces belles années !
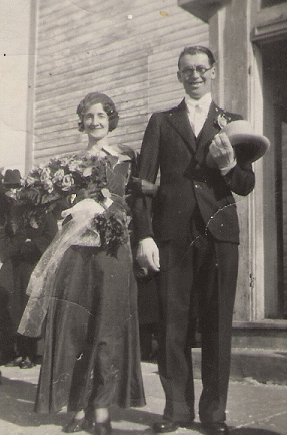
Borromée et Jeannette (1933)
Le 30 septembre 1933, eut lieu en l'église de Nominingue, le mariage de Borromée avec Jeannette Pesant. Ce fut le dernier mariage dans la vieille église près du monastère des Sœurs de l'Immaculée-Conception. Ce fut une très belle cérémonie religieuse avec un chant tout simplement remarquable. Le cousin de ma belle-sœur, Marcel Gagnon, entonna de sa belle voix de basse des cantiques superbes. Puis notre cousine Agnès Boileau, soprano, de sa voix puissante entonna à son tour des chants liturgiques appropriés à l'époque.
La réception eut lieu chez nous. Les invités furent d'abord toute la famille Pesant, puis oncles, tantes, cousins et cousines de notre famille. Il y avait même des cousins de Ste-Scholastique. Ce fut une très belle noce dont on parla longtemps. C'était le premier de la famille qui partait de la maison. Il avait 27 ans. Heureusement qu'au retour de son voyage de noce, il habita la maison d'en face, de l’autre côté du chemin Chapleau. La propriété qui avait été achetée de l'oncle Alfred.
L'année suivante, le 15 août 1934, ce fut la naissance de Jacques, le premier petit-fils et notre premier neveu. Cette naissance agrémenta beaucoup notre vie. L'année 1936 s'écoula calmement, marquée toutefois par la naissance d’André le 10 septembre. Il était le second fils de Jeannette et de Borromée. En 1937, le 29 juillet, avait eu lieu chez Borromée, la naissance de Claude. Quatre jours seulement de différence entre les deux petits cousins. Ils se sont bien amusés ensemble! Le 15 mai 1939, Georges, le quatrième fils de Jeannette et de Borromée, entrait dans notre monde. Au début de l'année 1941, le 25 janvier, naissait à son tour notre première petite nièce, Nicole. Puis Marcel en 1943 et Denis en 1946.
La famille de Borromée et de Jeannette se compose de sept enfants dont six garçons et une seule fille : Jacques (15 août 1934), André (10 septembre 1936), Claude (29 juillet 1937), Georges (15 mai 1939), Nicole (25 janvier 1941, Marcel ( 24 mai 1943) et Denis (30 avril 1946). Nicole est demeurée célibataire mais, tous les garçons se sont mariés et sont devenus pères de deux ou trois enfants : Jacques, un garçon (Martin) et deux filles (Josette et Mireille) ; André, un garçon (Guy) et une fille (Myriam); Claude, un garçon (Serge) et deux filles (Dominique et Claude Marie); Georges, deux filles (Julie et Marie Anik) ; Marcel, deux filles (Anuk et Caroline) ; Denis, deux filles (Eveline et Élisabeth) et un garçon (Jérémie).

La nouvelle église (1933)
La nouvelle église, l’actuelle, fut construite en 1933. À titre d'ancien marguillier, mon père avait discuté avec M. le Curé du projet de trouver un prêteur pour financer la construction de l'église. Une dame que nous connaissions bien, et dont mon père avait suggéré le nom, consentit à prêter à la fabrique St-Ignace le montant nécessaire pour la construction de notre église et du presbytère. Cette dame était Mme veuve Rosaire Côté de Montréal, mère de Gilberte qui était venue vivre chez nous trois saisons de vacances d'été. M. le Curé Noiseux fut très satisfait de cette réussite d'affaires. Il put entreprendre les travaux sans retard. Mon père aimait s'impliquer dans les affaires publiques lorsqu'il pouvait se rendre utile par son expérience et ses connaissances pour l'amélioration du bien commun paroissial. Personne ne pouvait aimer autant sa paroisse que lui.
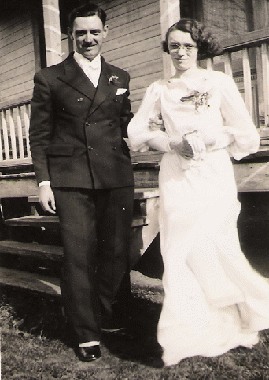
Le mariage de Fortunat avec Florida Demers (1935)
L'année 1935 vit un second mariage chez-nous. En effet, le 26 octobre 1935, Fortunat épousa Mlle Florida Demers.
Fortunat avait rencontré Florida trois ou quatre ans auparavant. Elle enseignait pour les religieuses à l'école du village. Elle fut l'une des "quatre premières finissantes" à l'école normale de Mont-Laurier. Elle devint grande amie de mes cousines Graziella et Lucienne Lalande. Ce fut le début de belles relations amicales. À la patinoire, le dimanche après-midi, c'était l'occasion d'une rencontre désirée, laquelle se terminait chez l'oncle Émile par un goûter.
Quand vint l'époque des grandes vacances d’été, Florida, avant de retourner chez ses parents à Montréal, prit chambre et pension chez Mme Télesphore Thibault pendant un mois. Les filles de madame Thibault et moi avions connu Florida, élève pensionnaire au couvent des Sœurs Ste-Croix, où nous avions fait nos études. Alors, c'était de véritables retrouvailles. Nous avions beaucoup de plaisir à nous rencontrer avec nos amies pensionnaires qui avaient loué la maison de Borromée, tantôt chez nous, tantôt chez madame Thibault ou encore chez madame Hénuset. Ce fut un été remarquable! Compositions de chansons, charades, jeux de société, chants variés et musique. Florida était mon aînée de seulement deux ans. Nous avions donc beaucoup de choses en commun. Nous avons vécu ensemble des situations comiques et des faits cocasses. Comme nous avions le rire facile, maintes occasions s'offraient pour faire éclater notre hilarité. Des explosions de rires jaillissaient malgré nous. Que de souvenirs drôles nous avons de ce beau temps de notre jeunesse !
En septembre de la même année, Florida fut engagée par la Commission scolaire pour faire la classe à Loranger. Elle venait donc passer les fins de semaine chez nous. Fortunat allait la reconduire le dimanche soir à sa pension de semaine. Les relations devinrent plus sérieuses, à tel point qu’ils décidèrent de se marier. Alors la construction de sa maison, grange et étable par papa et Fortunat, quelquefois aidés par Charles-Auguste, se fit en 1934. Peu après, papa lui concéda 90 des deux cents acres de notre terre (partie ouest). Tout fut prêt pour octobre 1935. Maman était bien heureuse que ses deux garçons soient établis tout près de nous.
Ce matin du 26 octobre 1935, le temps était radieux, le soleil brillait et vers l'heure du midi et même le soir, il faisait chaud comme en été. Comme Florida était enfant de Marie, elle se maria en blanc et la chorale des enfants de Marie exécuta le chant pour la circonstance. Après la cérémonie, la réception eut lieu chez monsieur Demers dans le 7ième rang sud. Et le soir, le souper se donna chez nous. La veillée suivit. Les invités étaient nombreux. Ils venaient de Ste-Scholastique, Terrebonne, St-Jérome, l'Annonciation ainsi que de Nominingue. Pour la circonstance, nous avions enlevé les lits et meubles de nos deux chambres en bas pour agrandir l'espace. Quel branle-bas! La maison était pleine à craquer. Quelques personnes se sont introduites sans invitation. Mon père en fut très contrarié. Tout de même, tout se passa très bien. Ce qui ne l'empêcha pas de nous dire le lendemain: « Je crois que c'est la dernière noce que nous faisons à la maison ». Il ne pensait pas dire si vrai! Ce fut en effet la dernière puisque nous sommes tous demeurés célibataires. Le nouveau couple s'installa dans la maison construite pour eux. Ils y demeurèrent seulement de sept à huit ans. Ils eurent trois enfants. Pierre qui vit le jour difficilement le 2 août 1937 et Yvon en 1945. Plus tard, au début des années 1950, Fortunat et Florida adoptèrent une fille du nom de Lucie.
Papa abandonna la vie publique en 1939. Il donna sa démission comme maire le 12 décembre 1938 pour se consacrer entièrement aux besognes de la maison. Puis, il commença à souffrir du diabète comme sa mère. Ce fut pénible pour lui et pour nous. Un régime alimentaire sévère était de mise!

Famille Arthur Lalande, 1941
Retour à la table des matières