UNE DÉCENNIE MARQUÉE DE NOMBREUX DEUILS
(1940 – 1950)
La décennie 1940-1950 fut parsemée d'événements très douloureux pour nous. En l'espace de 7 1/2 ans, nous avons vu partir pour "l'autre monde" quatre membres de notre famille. « L'implacable faucheuse » vint nous ravir notre mère, notre père et deux de nos frères. De six que nous étions à la maison paternelle, nous sommes demeurées toutes seules, ma sœur et moi.
Le décès de maman (1941)
Au début de novembre, maman tomba malade avec une température très élevée. Le lendemain, le médecin diagnostiquait une broncho-pneumonie, congestion totale des poumons et des bronches. La pénicilline n'était pas encore découverte, alors la maladie fit son oeuvre rapidement. La huitième journée avec toute sa connaissance, elle rendit l'âme. C’était le samedi 15 novembre et il était 10 heures du matin. Elle était âgée de 64 ans.
La dernière veillée et la dernière nuit, elle les passa en compagnie de son neveu, prêtre, Achille Boileau. Il lui parlait tellement doucement mais d'une manière si convaincante qu'elle s'endormait rapidement pour quelques minutes. Elle respirait avec tellement de difficulté que les instants de sommeil n'étaient pas longs. Elle s'affaiblissait graduellement. Lorsque arriva sept heures du matin, mon cousin Achille lui dit: « Ma tante, il me faut aller célébrer ma messe à l'église et je vais vous l'offrir. Vous allez voir, ça va bien aller. Je reviendrai vous voir. » À peine était-il parti que maman commença à s'agiter, incapable de prendre une position convenable.
Je n'oublierai jamais les dernières paroles qu’elle prononça lorsque j'étais seule avec elle, pendant que les autres prenaient leur déjeuner. Avec un regard de détresse en m'offrant ses mains, elle me dit: « Que je suis donc faible, qu'est-ce que je vais faire! Qu'est-ce que je vais faire? » Alors ses deux mains, qui s’échappèrent des miennes, retombèrent sans force sur son couvre-lit. Elle essaya de parler encore, mais, ses paroles malheureusement étaient incompréhensibles. Elle s'arrêta de parler et ne fit entendre aucun son par la suite, mais son regard en disait long. Elle pressentait qu'elle nous quitterait bientôt pour toujours en s'en allant toute seule vers un monde inconnu. Toute la famille au complet entourait son lit à ce moment-là. Elle nous regardait les uns après les autres. Papa lui tenait la main, elle le fixait intensément. Oncle Émile arriva avec deux religieuses sœurs St-Elphège et Ste-Ursule. Sœur St-Elphège était une véritable infirmière. Elle a assisté presque tous les mourants et mourantes de la paroisse. Elle est demeurée 35 ans à l'Institut familial de Nominingue.
La respiration de maman devenant de plus en plus difficile, Sœur St-Elphège nous fit ouvrir la fenêtre pour lui donner un peu d'oxygène et parla doucement à maman qui conserva toute sa connaissance jusqu'à son dernier soupir. Elle lui dit: « Madame Lalande, maintenant faites le sacrifice de votre vie et nous allons prier à votre place (prière des agonisants) ». Toujours docile et obéissante jusqu'à la fin, maman se recueillit et posa son regard sur le cadre de la Ste-Vierge qui était d'un côté du mur près de son lit et de l'autre côté, c'était le cadre du Sacré-Coeur. Elle se détourna la tête lentement pour le fixer, mais juste avant d'y arriver, dans un dernier souffle, elle rendit l'âme. C'était un samedi, jour consacré spécialement à la Ste- Vierge qu'elle avait priée toute sa vie et invoquée avec confiance. La Vierge est sûrement venue l'accueillir avec son beau sourire pour l'emmener au Ciel.
Les deux religieuses nous offrirent leur aide pour l'ensevelir. Combien nous les avons appréciées! C'était un véritable privilège que l'ensevelissement soit exécuté par des religieuses. Les morts n'étaient pas embaumés ni exposés dans un salon funéraire à cette époque! Tout se passait dans les résidences. C’était impressionnant et très onéreux pour la famille. Il fallait « tenir » trois jours et trois nuits à recevoir les visiteurs, les parents à qui on donnait plusieurs repas, café, etc. On dormait très peu et l'on priait beaucoup. À toutes les heures et parfois aux demi-heures on récitait le chapelet.
Toute la paroisse partageait le deuil. C'était une bonne consolation. Mais rien ni personne ne peut remplacer le départ d'un être cher. La séparation fut très cruelle pour mon père malade. Il ne s'est pas couché pendant une huitaine de jours, et n'a pu assister aux funérailles avec nous. L'abbé Achille Boileau fut le célébrant assisté de mon cousin René Lalande et d'un autre diacre.
Nous n'étions guère préparés à ce deuil qui arriva si promptement. Malgré notre propre souffrance, nous avons reporté toute notre affection sur notre père qui se sentait si « seul » sans son épouse! Inutile de vous dire que les fêtes de Noël et du 1er de l'An furent bien tristes. Le deuil était si récent.
C'est vraiment extraordinaire combien la foi chrétienne peut nous donner la force morale d'accepter ces dures épreuves. Même malgré ses 70 ans, lorsqu'une messe était célébrée sur semaine pour maman, mon père se levait sans bruit, prenait son fanal et partait à pied en hiver pour arriver à l'église à sept heures du matin. Ça lui faisait tout près de quatre milles aller et retour. Quel courage était le sien! Sa foi si grande le soutenait. Nous y allions souvent nous aussi mais l'ouvrage de la ferme nous retenait à la maison parfois. Et le temps passa. Le printemps 1942 s'annonçait assez tôt. Papa continua l'élevage des poussins comme du temps de ma mère.
Puis c’est au tour de mon frère Arthur de décéder (1943)
Au début de mai, Arthur mon frère, tomba malade. Le médecin prononça son diagnostic "broncho-pneumonie" comme ma mère l'automne précédent. A six mois d'intervalle, la pénicilline avait eu le temps de faire son apparition sur le marché. Alors il revint à la santé assez rapidement, même sa voix était meilleure que de toute sa vie. Il aurait fallu qu'il habite les pays chauds pour ne pas vivre à l'humidité et subir le changement radical de température des pays nordiques. Ce n'était pas possible. Il accomplissait son travail quotidien avec entrain comme avant sa maladie!
Ce printemps 1943, Pâques était le 25 avril je crois. Fortunat travaillait à Montréal depuis un an. Avec sa femme Florida et Pierre, il était venu passer la fête de Pâques et la semaine suivante en promenade chez nous! C'était la fonte des neiges; je n'avais pas pu me rendre au Lac Vert, où j’enseignais, parce que les chemins défonçaient à cause de l'épaisseur de neige qui cédait sous le poids du cheval et de la voiture. Nous étions donc plusieurs à la maison! Arthur n'était pas très bien, Il faisait une grippe semblait-il, très congestionné et ne pouvait tousser. De plus, depuis une quinzaine de jours, il se réveillait à la même heure chaque nuit avec une grande douleur à la tête qui durait une dizaine de minutes. Élisabeth se rendait auprès de lui et voulait lui donner des remèdes, mais aussitôt la douleur passée, il disait à ma sœur: « 'Laisse faire, je vais me rendormir maintenant » !
Au milieu de la semaine, Élisabeth et moi, sommes allées chez le médecin lui chercher du sirop et autre remède pour l'aider à se décongestionner. Le lendemain matin, jeudi à 9 heures, il n'était pas descendu déjeuner, alors je dis aux autres membres de la famille: « Je vais lui porter son déjeuner à sa chambre, il pourra mieux se reposer ensuite! ». Je monte donc avec un oeuf bouilli et une rôtie, suivie du petit Pierre. Il aimait tant Pierre qu'il lui dit: « Bonjour Pierre! Je ne t'embrasserai pas pour ne pas te donner le rhume! » Il mangea deux ou trois cuillerées d’œuf et jeta son assiette sur le bureau à côté de lui en envoyant sa tête sur l'oreiller les yeux à demi-fermés. Je le regarde plus attentivement; il avait les lèvres violacées et les mains très froides. Une pensée morbide me traversa l'esprit! Je descendis rapidement l'escalier et je crie ces mots: « Papa, Fortunat, venez vite, je crois qu'Arthur est en train de mourir ». D'un bond, ils montèrent, papa lui dit: « qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Tu vas venir avec nous en bas ». Ils le soutinrent et cela lui fut salutaire pour la circulation du sang! Fortunat le fit asseoir dans la berceuse près de la fournaise pour lui faire la barbe. Il ne disait mot. Charles-Auguste étant dans l'étable, papa me dit: « Vite, va lui dire qu'il aille chercher le médecin, Arthur est très malade ». Il attela le cheval sur le « boggy » et partit au village à toute vitesse. Le médecin prit un peu de temps, sa voiture était au garage pour la vérification du printemps. Dans l'intervalle, on fit coucher mon frère, il se tenait presque assis dans le lit; il respirait mieux dans cette position.
Enfin, le médecin arriva, il se rendit près de lui et nous dit: « II n'est même pas en état d'être osculté, je n'ai pas ce qu'il faut »". Il partit en toute vitesse et revint quelques minutes plus tard avec le vicaire de la paroisse qui lui administra les derniers sacrements. Le docteur Mailly lui fit une saignée au bras, le sang voulait coaguler. Il respira mieux après. Il l'a placé très bien sur les oreillers et nous dit à ma sœur et à moi, mettez-lui plusieurs bouteilles d'eau chaude autour de lui pour lui donner de la chaleur. Il devint inconscient et appelait maman à voix basse. Il pouvait être deux heures de l'après- midi. Petit à petit, sa respiration diminuait et à notre appel, Borromée arriva. Vers quatre heures, Arthur s'éteignit doucement. Oedème aux poumons dit le médecin. Il avait traîné toute sa vie cette « bronchite asthmatique » qu'il avait contractée à un mois. Il décédait à l'âge de 42 ans, le 29 avril 1943.
La première parole que mon père prononça après son décès fut celle-ci: « II faut croire que mon tour n'est pas loin ». Étant donné que mon frère était atteint d'une maladie chronique, mes parents étaient inquiets pour lui après leur disparition. Ils se disaient l'un à l'autre: « Si le bon Dieu pouvait venir le chercher avant la disparition du dernier survivant de nous deux, la charge serait moins lourde pour les autres enfants »! Il furent exaucés et c'est ce qui lui firent dire que son tour n'était pas loin. Ils répétèrent la même phrase au Curé Noiseux le jour des funérailles. Ce fut la stricte vérité puisque six mois plus tard, mon père partait à son tour.
La mort d’Arthur jr fut un grand choc pour toute la famille. Quelques heures de maladie seulement. La veille au soir, il soupait à table avec nous et le lendemain, il était dans sa tombe! Le printemps s'écoula tristement. Pour quelques mois, deux mois environ, Élisabeth, comme par les années passées, s'engagea comme cuisinière dans une maison de pension touristique.
...suivi de près par celui de mon père (novembre 1943)
Vers la fin du mois d'août, papa commença à être malade. Son estomac restait embarrassé, ses intestins fonctionnaient mal. Évidemment il manquait d'appétit. Il décida d'aller voir le médecin qui lui dit: « II faudrait d'abord faire enlever vos dents » elles commençaient à se déraciner. Ce n'était certainement pas la cause de son mal à l'estomac. Il lui donna quelques remèdes pour le soulager. . . le mal persistait quand même. Un jour qu'il rencontra Charles-Auguste au village, le médecin lui dit: « Voulez-vous venir à mon bureau, j'ai quelque chose d'important à vous apprendre » ! Mon frère s'exécuta. Le médecin lui dit à brûle pourpoint : « J'ai examiné votre père et je crains beaucoup le cancer pour lui. Il faudrait absolument lui prendre des radiographies. Je descends à Montréal au début de la semaine prochaine, je pourrais le conduire à l'Hôtel-Dieu de Montréal et nous saurions exactement de quoi il souffre! » Nous étions en septembre.
Le cancer s’installe et fait son oeuvre (août 1943)
Complètement abasourdi, Charles- Auguste nous apprend la nouvelle à Élisabeth et à moi-même. La stupeur s'empara de nous. Il fallait agir quand même (4 mois après la mort d'Arthur). Mon frère dit à papa ce que le médecin attendait de lui pour mieux le soigner. Il le conduirait lui-même à l'hôpital! Papa n'était pas un homme à se faire dicter sa conduite d'une manière aussi cavalière. Il répondit : « S’il faut me faire radiographier à l’hôpital, j'irai par mes propres moyens. J'ai mon cousin le docteur Stanislas Lalande à Bordeaux, attaché à l'hôpital Hôtel-Dieu aussi. J'aurais plus confiance et je serais plus à l'aise pour lui parler. » Comme la douleur ne cessait pas, il manœuvra pour descendre à Montréal au plus tôt. Il demanda à un ami de la famille, monsieur Adélard. Grégoire, s'il ne pouvait le conduire à Bordeaux chez son cousin, le docteur Lalande. Monsieur Grégoire accepta.
Mon père descendit donc avec Charles-Auguste dans l'automobile de monsieur Grégoire. Ils firent une bonne randonnée, papa racontant avec emphase toutes les péripéties de ses voyages à St-Jérome, au début de la fondation de Nominingue, se rappelant les noms de ceux chez qui il logeait s'il était retardé par la température ou tempête d'hiver. « La montagne du Sauvage », disait-il, « ne se montait pas aussi facilement qu'en automobile! Que j'en ai donc vécu des bons moments mais aussi des "mauvais" durant ces longs trajets que je n'ai pas oubliés! » Alors il était plus détendu lorsqu'il arriva à destination. Monsieur Grégoire revint chez lui immédiatement puisqu’il était gérant du Club Columbus Chasse et Pêche. Les membres étaient nombreux pour le dernier mois de la pêche. Papa eut donc le temps de passer plusieurs radiographies durant deux jours. Le docteur Lalande fut bien bon pour lui et son épouse très hospitalière.
Après deux jours, le docteur Lalande put renseigner Charles-Auguste sur l'état de santé de mon père. Il souffrait exactement d'un cancer au pancréas. Il avait déjà les 4/5 de l'estomac en "plaies". Aucune opération n'était possible, le mal était trop avancé et il ne faisait que 90 degrés de pression artérielle « Comment se fait-il », disaient les médecins, « qu'il n'a pu s'en apercevoir avant? ».
Pionnier de la première heure, il possédait une énergie indomptable! Il n'avait que trois mois à vivre selon les prévisions de l'hôpital. Quel choc ce fut pour mon frère! Ils prirent donc le chemin du retour par train cette fois. Le médecin lui avait prescrit une diète très légère pour ne pas irriter son estomac. Notre médecin, le Dr. Mailly lui avait fait enlever les dents parce qu'elles commençaient à se déraciner. Ce n'était pas la cause de son mal et ça l'empêchait de manger. Durant le trajet, il avait faim, il mangeait des pêches avec difficulté, ça calmait son estomac.
Le train arriva vers 10 heures. Aussitôt arrivé à la maison, très fatigué, mon père se coucha. Charles-Auguste en profita pour tout nous raconter. Il commença en ces termes: « J'ai fait le trajet avec un condamné à mort. Je le regardais manger avec rage. J’avais le cœur en compote de penser que dans quelques jours, il ne pourrait plus manger! » Nous étions consternés! Il fallait cacher notre inquiétude à tout prix. Nous lui disions qu'il faisait un ulcère. Nous savions ce qu'il allait souffrir. Je pense que la réalité fut encore "pire" que nos prédictions. À partir de ce moment, il affaiblissait un peu tous les jours. Il ne pouvait plus manger de nourriture solide, il prenait seulement du liquide. Il arrivait à faire quelques petits travaux bien minimes, surtout il se distrayait à faire de la lecture dans sa berceuse de la cuisine.
C'était sur des sujets religieux qu’il lisait la plupart du temps pour se sanctifier davantage. Et lorsqu'il rencontrait des passages intéressants, il en faisait la lecture à haute voix à Élisabeth qui vaquait à son travail dans la cuisine. « Tu n'as pas le temps de lire », disait-il à ma sœur, « je vais te faire partager l'espérance, la confiance en l'Esprit Saint qui offre la certitude d'une vie meilleure si notre foi est vive et constante ». Le titre du livre était: "Dispensateur des grâces; l’œuvre du St-Esprit en nous". Il ne perdait aucune occasion de proclamer hautement sa foi! Surtout depuis la mort de ma mère, il était parvenu à un haut degré de "spiritualité". Mon père était un mystique! Il l'a prouvé bien des fois au cours de sa maladie.
Le cancer dont mon père souffrait progressait très rapidement. Il s'en rendait compte d'ailleurs. Un jour qu'il avait « limé » le godendart servant à scier le bois de chauffage, il dit à Charles-Auguste: « viens, je vais aller l'essayer avec toi pour constater si j'ai bien réussi ». Évidemment, il ne put tenir bien longtemps. Il dit avec amertume: « Si je pouvais manger, je pourrais encore travailler ». De son naturel, il ne demeurait jamais à ne rien faire. Au début octobre, les légumes du jardin sont arrachés. On en profitait pour nettoyer le jardin pour le printemps suivant. Il prenait sa faucille pour couper les cotons de blé d'Inde, les mettait en tas pour donner aux animaux. Ne se sentant plus capable, il dut abandonner et revenir à la maison. Il avait oublié de rapporter sa faucille. Nous l'avons retrouvée le printemps suivant à l’endroit où il s'était arrêté de travailler.
Les derniers jours de mon père
Le 15 octobre, jour de son anniversaire de ses 72 ans, nous ne pouvions le "fêter", il ne mangeait plus. Le soir, alors qu'il écoutait la radio, nous lui avons offert nos vœux de bonne santé, Élisabeth, Charles-Auguste et moi. Il nous répondit: « Mes pauvres enfants, c’est le dernier anniversaire que je passe avec vous ». Nous le savions, hélas. À partir de ce jour, il ne mangea plus et souffrit terriblement de l'estomac. De l'eau et une tasse de thé de temps en temps, voilà ce qu'il pouvait absorber. Il décida alors de faire venir le notaire Villeneuve de l'Annonciation pour rédiger son testament. Cet après-midi-là, il était plus fatigué qu'à l’ordinaire. Tout se passa selon ses désirs, ses affaires étaient en ordre. Pas d'inquiétude pour ses héritiers.
Le lendemain, il était très souffrant. « J'ai le feu dans l'estomac » nous disait-il! À l'heure du souper, il se promena longtemps sur la "galerie", l'air frais adoucissait sa douleur. Depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, devrais-je dire, chaque soir il arpentait notre grande galerie en récitant son chapelet et même son rosaire! Ce soir-là, lorsqu'il rentra dans la maison, il était très pâle, sa souffrance devenait insupportable! On nous avait prévenus qu'il pourrait faire des hémorragies graves qui pourraient lui être fatales! Il se lève tout à coup et dit à ma sœur: « Donne-moi un bol ». Il se mit à restituer du sang brunâtre, digéré, plein le bol. Nous étions très énervés. Charles-Auguste prit son auto pour chercher le médecin. Mon frère avertit le docteur de ce qui s'était produit chez mon père, celui-ci lui répondit que c'était inutile de lui rendre visite ce soir-là. « J'irai demain pour lui faire comprendre qu'il devra tenir le lit désormais pour conserver ses forces ».
Mon frère décida alors d'aller au presbytère quérir un prêtre pour lui faire recevoir le sacrement de l'Extrême-Onction. C'est le vicaire Maurice Gareau qui vint. Un abbé très sympathique qui plut beaucoup à mon père. Comme il était assis dans sa berceuse à l'arrivée du prêtre, celui-ci jasa avec mon père qui lui raconta une bonne partie de sa vie. Sa vie de pionnier, d'agriculteur, de père de famille, de son épouse dont il vanta tous les mérites. « J'ai eu la chance », dit-il, « d'avoir pour épouse une femme extraordinaire qui m'a rendu parfaitement heureux. Elle était douce, compréhensive, prévenante, elle me secondait en tout et partout »! « Vous avez été privilégié d'avoir une telle compagne », lui dit l'Abbé Gareau. « Oui, mon Père », répondit papa, « car avec le tempérament que je possède, j'aurais pu mal tourner ». Ce qui fit rire l'Abbé. Il ajouta: « Nous avons eu de grandes épreuves, maladie surtout et pertes d'argent, avec l'aide de Dieu, nous avons toujours passé à travers ». — « Dites-moi, M. Lalande, si votre vie était à recommencer, est-ce que vous changeriez quelques orientations? » — « Non, mon Père, je referais la même chose ». — « Vous êtes donc satisfait des actions de votre vie? » - « J'ai fait mon grand possible, j'espère que Dieu en tiendra compte ». « Si vous voulez maintenant vous mettre au lit, je vais vous donner le sacrement des malades, c'est-à-dire, l'Extrême-Onction » lui dit le vicaire. Il s'exécuta immédiatement. Nous avons assisté tous les trois à la cérémonie au pied de son lit. Après le départ du prêtre, mon père était si heureux. Il ne cessait de nous remercier. « Je suis prêt maintenant, je puis partir en paix »!
Pour obéir au médecin à partir du lendemain, il ne quitta plus son lit! Ce fut seulement pour sa dernière maladie que l'on vit notre père demeurer au lit. Avec un sac de glace sur l'estomac, ses douleurs s'atténuaient un peu. Nous avons engagé une cousine infirmière pour prodiguer les soins dont il avait besoin. « Si j'avais votre mère, au moins... » disait-il avec regret. Presque tous les gens de la paroisse sont venus le visiter. À chacun, il avait un boniment spécial, des paroles réconfortantes selon la situation de chacun. Il avait été MAIRE si longtemps qu'il était un vrai père pour tous les paroissiens, principalement pour les agriculteurs. Chaque jour, des parents ou des amis défilaient dans la chambre de mon père. Celui-ci parlait sans arrêt. Nous lui disions: « Vous n'êtes pas fatigué papa de parler autant? - « Non, j'en ai tant encore à dire » répondait-il. On aurait dit que la souffrance le rendait plus loquace. Que de bons conseils il distribuait en particulier à ceux qui le lui demandaient, même des paroles pleines d'humour.
Papa se tenait presque toujours assis dans son lit. C'est la position qui lui convenait le mieux. Sur dix-sept jours qu'il a tenu le lit, il a communié quatorze jours consécutifs. Quand monsieur le Curé ne pouvait venir avec son auto, Charles-Auguste allait chercher monsieur le Vicaire avec la sienne. Après la communion, mon père se recueillait quelques minutes et ma cousine, infirmière, Jeannette Boileau, faisait l'action de grâces à haute voix. Elle possédait de si belles prières et les récitait si bien que nous assistions à cette belle lecture imprégnée d'espérance et de foi. Mon père disait: « Jeannette, où puises-tu ces pieuses paroles qui me réconfortent dans le plus profond de mon âme? Je n'oublierai jamais ce que tu fais pour moi, le bien que tu m'apportes. Je demande à la divine Providence qu'elle te donne la santé pour que tu puisses prendre soin des malades comme moi ». Il faut dire que Jeannette était elle-même une grande malade depuis plusieurs années. Elle avait consenti à venir nous aider parce qu'elle aimait beaucoup papa. « Mon oncle », disait-elle, « ne vous gênez pas, demandez-moi tout ce que vous désirez, je suis avec vous pour cela » !
Mme Arthur Nantel du rang VII sud venait souvent le voir avec Monsieur Raoul Demers père de Florida. Monsieur Nantel, un grand ami de mon père était décédé l'année précédente d'un cancer à l’estomac. Papa était allé lui rendre visite très souvent durant sa maladie, alors madame Nantel, qui était si bonne pour les malades, lui rendit la pareille. D'ailleurs, je ne sais par quelle coïncidence, elle assista nos quatre mourants. Au début de la dernière semaine de sa vie, un avant-midi qu'elle venait nous assister, mon père l'accueillit par ces paroles. « Mme Nantel, je ne suis pas encore mort. Quel saint allons-nous invoquer pour que ça se fasse vite comme les autres qui sont partis »! « Prenez courage, M. Lalande », répondit-elle. Il commençait à faire des hémorragies internes; à ce moment-là, il devenait très pâle et ne respirait plus. Jeannette, qui le surveillait de près, disait: « II ne passera pas, son pouls est encore bon ». Il revenait à lui un peu plus tard. Il fut dix-sept jours sans prendre aucune nourriture; un verre d'eau dans lequel nous ajoutions quelques gouttes de cognac pouvait lui durer deux jours. À la fin, nous faisions que lui mouiller les lèvres.
Toujours dans la dernière semaine, les deux communautés religieuses Ste-Croix et Immaculée Conception vinrent le visiter à tour de rôle. Sœur St-Elphège qui était venue à la mort de maman était du nombre. Il lui demanda: « Ma Soeur, priez pour que je meure au plus vite, je n'en peux plus de souffrir »! Elle lui répondit: « C'est demain la fête du Christ-Roi, le 31 octobre, puis le Jour de la Toussaint, puisque c'est votre désir, nous allons prier bien fort pour que vous soyez exaucé »! « Oui, Ma Sœur », dit-il, « j'ai confié mes enfants au St-Esprit, j'ai fait mon testament, je n'ai plus rien à faire ici-bas »!.
La paroisse était en retraite à ce moment là. À la clôture il était de mise que le père Prédicateur donne la bénédiction papale à tous les paroissiens. Une grande indulgence était attachée à cette bénédiction. Je crois que c'est le dimanche de la fête du Christ-Roi que M. le Curé Noiseux, accompagné du père Prédicateur, tous les deux au pied du lit de mon père lui accordèrent leur bénédiction. Puis monsieur le Curé donna la communion avec une petite parcelle d'hostie vu qu'il ne pouvait presque plus avaler, ni boire. Il réussit cependant. C'était plus que touchant! « M. Lalande », dit le Curé Noiseux, « lorsque vous étiez capable, vous veniez à l'église recevoir l'Eucharistie. Aujourd'hui, c'est le bon Dieu qui vient à vous »!
L'après-midi précédente, il avait fait une grosse hémorragie interne. Jeannette pensait que c'était la fin. Elle commençait à réciter la prière des agonisants, tout à coup, il revint à lui et nous dit ces paroles : « Je viens de pénétrer dans l'autre monde. J'ai traversé un couloir sombre et tout au bout, j'ai vu une belle prairie lumineuse parsemée de fleurs. C'était brillant! Quand vous avez dit: Partez ô âme bienheureuse, je suis revenu de mon voyage ». Ça été une grande émotion pour Jeannette. Sa sœur Agnès qui est venue la voir le dimanche décida de la ramener avec elle de peur qu'elle ne soit malade, elle était très fatiguée, c'est certain. Elle dit à mon père: « Je pars mon oncle, mais je vais revenir vous voir »
Avant le départ d'Agnès, mon père souffrait terriblement; il dit à Charles-Auguste et à Borromée qui étaient présents: « Levez-moi debout, vous savez que j'ai toujours été un homme actif, je ne peux plus rester couché, la chair me fait mal ». Il commençait à faire des plaies de lit. Mes frères l'ont soulevé un peu. Je lui tenais les pieds bien droits, il avait des étourdissements. Élisabeth eut juste le temps de replacer son drap. Cela lui fit du bien quand même. Et puis, Agnès dit à Charles-Auguste: « Va chercher le médecin, dis-lui que c'est moi qui le fait demander. On a pas idée de laisser souffrir un homme comme ça. Qu'il vienne lui injecter un calmant » ! Le docteur Mailly vint vers l'heure du souper accompagné de sa femme qui demanda à mon père: « Souffrez-vous beaucoup, M. Lalande »? « Non, madame, je n'ai jamais souffert » lui répondit-il! Le médecin se retourna vers elle pour lui dire: « II souffre le martyr » ! Et à mon père: « Ce ne sera plus bien long maintenant, vous le désirez tellement »! « Tant mieux » dit mon père.
Plus que quelques heures à vivre
Le lendemain, premier novembre, il revint lui donner une autre injection le matin et une le soir. Il ne reparla plus après, son pouls était très rapide. Florida demeura avec nous pour ne pas le quitter! Il nous cherchait des yeux, puis se rendormait. Il nous reconnaissait très bien, il était parfaitement lucide mais trop faible pour parler. Cette nuit-là, c'est mon oncle Alfred qui vint passer la nuit avec lui. Le docteur revint le matin du 2 novembre, le Jour des morts, puis le soir aussi. Il nous dit: « II ne passera pas la nuit ». Pour que nous ne soyons pas seuls, mon oncle Ernest vint veiller avec lui et il nous dit: « "Allez vous coucher, je vous réveillerai s'il se passe quelque chose ». À minuit moins quart, il nous appela: « Vite, descendez, c'est la fin ». Mon père s'en alla calmement, sans un geste. Il avait fini de souffrir! Quel choc nous avons ressenti de sa "présence disparue" à jamais!
Nous étions résignés à le voir partir, il souffrait trop. Mes frères et mon oncle Ernest ont dit qu'il pesait à peu près 75 livres! Il était méconnaissable. Quelle terrible maladie le cancer. Papa s'est éteint le 2 novembre 1943 à minuit moins quart. Six mois exactement après Arthur. Il était âgé de 72 ans et 17 jours. Quelle lourde perte! Le dernier des parents qui disparaissait pour toujours! Nous étions vraiment orphelins. Le même scénario du printemps recommença donc. Charles-Auguste choisit une très belle tombe pour mon père. Il le méritait tant! Exposition du corps dans la maison comme c'était la coutume! Parents et amis défilèrent nombreux devant la dépouille de mon père.
Des funérailles grandioses
Les funérailles eurent lieu le 5 novembre. Une foule nombreuse y assista. Ayant oeuvré pendant 22 années dans la vie publique, il était fort connu dans les paroisses environnantes de tous les maires du comté qui se réunissaient à tous les trois mois au Conseil de Comté à Mont-Laurier. L'Honorable Albiny Paquette, ministre dans le Gouvernement de Maurice Duplessis et en même temps "Préfet du Comté" assistait aux funérailles avec madame Paquette! Le docteur Côme Cartier de l'Annonciation et d'autres personnalités bien connues s’ajoutèrent à l'assistance! Toute la paroisse était présente. Ce fut une grande consolation pour nous de constater toute la sympathie des gens qui rendaient un si bel hommage à mon père!
À la messe du dimanche suivant les obsèques, lorsque Monsieur le Curé Noiseux le recommanda "aux prières", du haut de la chaire, il le fit en ces termes: « Un de nos bons paroissiens nous a quittés. Monsieur Arthur Lalande a vécu la mort d'un "parfait chrétien". Malgré ses souffrances atroces, il fit preuve d'une grande résignation à la volonté de Dieu! Il fit généreusement le sacrifice de sa vie. Toujours en récitant son chapelet, il demandait à partir pour le Ciel. Il ne doit pas être déçu présentement »!. C'était un bel éloge de la part de Monsieur le Curé!
La vie après le départ de mon père (1943 ...)
Au cours de cette période de grande tristesse, je faisais la classe à l'école du rang VI. Papa était encore président de la Commission Scolaire du Canton Loranger à son décès.
La Commission Scolaire du Canton Loranger comprenait quatre écoles de rang. Mon père, sous son règne, avait fait installer des fournaises à bois dans les caves de « trois » écoles, une par année. La mienne étant la dernière construite, il n'y avait pas de chauffage par la cave. Il y avait un gros poêle à fourneau sur le plancher de la classe qui réchauffait en même temps la cuisine et la chambre de l'école.
Au début de l'année, mon père dit aux commissaires: « II faut installer une fournaise dans la cave de l'école du rang VI, c'est la dernière et il faut le faire rapidement ». Ce qui fut fait par Monsieur Joseph Loiselle, homme très adroit et sympathique. Vers le 10 octobre, je m'en souviens très bien, mon père était venu à l'école visiter les travaux qu'il avait trouvés satisfaisants. Sentant sa fin prochaine, il recommanda à M. Loiselle d'activer les travaux avant la venue des gros froids. Ce fut accompli selon son désir
Malgré ce deuil douloureux, il fallait que la vie continue. Il faut survivre à tout. En l'occurrence, les travaux de la ferme avaient été perturbés. L'arrachage de patates avait été interrompu. Le bois de chauffage, la quantité en était insuffisante pour passer l'hiver. La disparition de deux hommes dans la même année changea beaucoup de choses. Charles-Auguste se trouvait seul maintenant pour effectuer tous les travaux à l'extérieur. Il n'était plus question de prendre des loisirs pour se distraire. Notre peine était trop immense! Le travail est la meilleure solution pour alléger la souffrance. Tous les trois, nous n'avions que cette idée en tête, le "travail". Nous avons réussi avec la grâce de Dieu à diminuer notre amertume. « II n'y a point de douleur que le temps n'apaise ».
Nous nous encouragions mutuellement. Chacun y trouvait son profit dans son travail respectif. Charles-Auguste personnifiait le chef de famille. Il administrait les affaires de la ferme! Je continuais de faire la classe à l'école du rang VI pas très loin de ma demeure. J'étais chez nous tous les soirs. Je fis la classe à cet endroit pendant six ans, jusqu'en juin 1949. Élisabeth était maîtresse de la maison pendant que j'enseignais! À la fin de l'année scolaire en juin, elle "réalisait" sa profession de cuisinière qu'elle aimait tant. Étant "cordon bleu" incomparable, la cuisine devenait un art qu'elle pratiquait dans divers endroits touristiques jusqu'à la fête du Travail. Partout où elle passait, elle était grandement appréciée! Pendant cette période, je la remplaçais à la maison de sorte qu'il y en avait toujours une qui secondait mon frère à la ferme! La besogne était astreignante, exigeante. Quelques années avant la mort de nos parents, nous faisions la vente de nos produits de la ferme, au détail. C’était beaucoup plus rentable, mais avec un supplément de travail. Étant à proximité du village, nous pouvions livrer à domicile du lait, de la crème, des oeufs, des volailles abattues, du veau, du porc.
Quand les vacances d'été arrivaient, nous faisions affaire avec les communautés religieuses. D'abord avec les Pères Ste-Croix de Bellerive qui venaient chercher du lait par gros bidons de 5 ou 10 gallons et même davantage quand la quantité de leurs villégiateurs était plus grande. Papa aimait bien la compagnie du Frère Conrad, économe des Pères Ste-Croix. Après la mort de mon père, Charles-Auguste entra en communication avec les Jésuites. À leur demande instante, il dût faire la livraison lui-même de nos produits. Ils étaient nombreux « sur la Pointe » les novices étudiants : 75 à 85 durant deux mois! Mon frère allait leur livrer 10 gallons de lait le matin et le soir. Il fallait traire les vaches, faire refroidir le lait, mettre le lait dans les bidons, laver ceux-ci lorsqu'ils faisaient l'échange et nous n'avions pas "l'électricité". Tout se faisait manuellement sans trop de confort. Nous n'avions pas le temps de flâner. Évidemment, mon frère avait une automobile, Chevrolet d'abord et Plymouth ensuite. La plupart du temps il faisait ses réparations lui-même. Il lui fallait prendre un "aide" pour la période des foins et parfois davantage. Les journées de travail étaient très longues, de 16 à 18 heures à cause de la livraison des produits matin et soir. Il fallait en profiter, ça ne durait que deux mois. Il ne fallait rien perdre. C’est pour cette raison que nous avons pu augmenter nos revenus financiers. Faire les foins avec tout le travail et tous les risques que cette opération exige et comporte, n’est pas facile, surtout que la température ne s'y prête pas. Les jours s'écoulaient trop vite, le travail s'échelonnait sur une période d'un mois et demi, parfois. C'était beaucoup de surmenage pour mon frère.
Lorsque arrivait le 31 juillet, fête de St-Ignace, patron des Jésuites, et aussi patron de la paroisse, c’était une très grosse commande qu'il fallait préparer. Surtout de la « volaille » qui était le menu principal de leur festin. Une année, entre autres, ils eurent plus d'invités qu'à l'accoutumé. Mon frère leur avoua qu'il préférait ne pas leur vendre de poulets parce que c’était un trop gros surplus d'ouvrage pour moi qui n'était pas bien habituée à « vider » les volailles. Les Pères acceptèrent de diriger la demande à leur livreur de Montréal.
Mais à la dernière minute, la veille au soir, ils dirent à Charles-Auguste que ça n'avait pas fonctionné et il leur manquait une dizaine de volailles pour atteindre la quantité nécessaire. Ils supplièrent donc mon frère de combler ce manque. C'était un samedi soir, ils ne pouvaient s'adresser ailleurs. Charles-Auguste revint aussitôt à la maison et m'annonce la nouvelle. J'étais vraiment découragée. Il fallut se mettre au travail sans retard pour que la commande soit prête le dimanche matin. Choisir les poules qui ne pondaient pas ou peu, ce n'était pas facile. Ensuite les tuer, les déplumer (j'aidais mon frère à cette opération), puis à la maison enlever les poils superflus. Nous étions bien installés dans le poulailler pour tuer les volailles et les déplumer rapidement à sec. Rien de mécanisé cependant. Un bon fanal au « naphta » nous éclairait. Le reste de la besogne se faisait à la main.
Un inspecteur avicole nous avait appris comment faire pour présenter sur le marché une belle volaille. Charles-Auguste était très habile. Premièrement, il suspendait la volaille au plafond par les pattes. Deuxièmement, il accrochait un petit bocal sous le bec pour recevoir le sang. Troisièmement, il saignait et tuait la poule par le palais avec un petit couteau spécial qui attaquait à un endroit précis le centre de la peur... la poule frémissait, rendant les plumes facilement détachables. Il ne nous restait plus qu’à les arracher et à les faire tomber dans un baril de bois que l'on plaçait en dessous. Il fallait faire vite pour profiter de cette courte période de « peur » de la poule. La chair demeurait très blanche. Heureusement que pour cette fois, les Pères ne nous obligèrent pas à vider les volailles. Nous avons terminé notre travail à deux heures et demie du matin. Tout était prêt pour le transport, mais il fallait quand même attendre la traite des vaches pour faire aussi la livraison du lait. Mon frère se leva à 6 heures pour aller chercher les vaches, les traire, etc. Il prit à peu près trois heures de sommeil ce jour-là. Les Jésuites eurent leurs marchandises à l'horaire convenu. Il furent très heureux et reconnaissants envers mon frère. Je me suis attardée à évoquer cet incident pour prouver à ceux et celles qui liront ces lignes, combien le travail ardu était l’apanage de tous ! Nul ne pouvait y échapper s'il voulait réussir. Ces sortes d'incidents se produisaient assez souvent dans notre métier. Il fallait jouir d'une bonne santé.
Pendant que nous n'étions que deux à la ferme, Élisabeth exploitait sa maison de pension touristique. Depuis quelques saisons, elle administrait, en collaboration avec M. Léon Portier, la maison de pension laissée à celui-ci par ses parents décédés. Il désirait depuis longtemps réouvrir la maison de pension de ses parents, mais il fallait d’abord, trouver une personne compétente en la matière. Quelqu'un lui recommanda ma sœur. Il vint la voir et ils discutèrent des conditions. Et après hésitation, ma sœur finit par consentir. M. Portier gardait le loyer des chambres à son profit. Il accordait l'usage de tous les accessoires de cuisine à ma sœur. Elle, elle s'occupait d'acheter toutes les provisions pour la préparation des repas des pensionnaires, le fruit de sa cuisine était à son profit. Elle payait son personnel elle-même, très souvent le dimanche, mon frère et moi allions l'aider, lui donner un coup de main. Les fins de semaine, elle avait parfois 40 à 50 pensionnaires.
Cela représentait beaucoup d'ouvrage et de l'organisation; sa cuisine était tellement appréciée que la publicité se faisait d'elle-même. Il n'y avait pas tellement de confort dans cette maison qui était antique. Il n'y avait pas de réfrigérateur, c'était une glacière avec de gros blocs de glace. L'électricité était présente, mais peu d'accessoires. La cuisson se faisait au moyen d’un gros poêle à bois qu’il fallait surveiller attentivement, faire du feu souvent, voir à ce qu'il y ait du bois sec, etc.
Avec cette quantité de personnes, si elle avait eu une cuisinière électrique! Mais que voulez-vous! C'était dans les années quarante. Ce que l’on voulait se gagnait chèrement et durement ! Lorsque arrivait le mois de septembre, ma sœur était bien contente de revenir chez-nous. Le temps des vacances amenait beaucoup de surmenage. Ce genre de vie, nous l'avons connu pendant cinq ans.
Il y avait aussi, durant les vacances, la période des foins. Les Jésuites appréciaient beaucoup les services rendus par mon frère qui faisait souvent leurs commissions dans le village. Entre autres, il allait à la gare, à l’heure du train, chercher des marchandises spéciales pour eux, il leur transportait des caisses de beurre qu'il allait quérir à la beurrerie même C'était du bénévolat qu'il pratiquait généreusement. Son travail sur la ferme souffrait de retard inévitablement.
Par compensation, les jeunes Jésuites proposèrent de venir l'aider à rentrer le foin. « 'Fauchez du foin en quantité raisonnable et en faisant un "pique-nique" nous irons vous aider » lui dirent-ils. Nous traversions une période de beau temps, ce qui fut dit, fut fait! Après la livraison du lait, mon frère ramena avec lui quatre ou cinq « pique-niqueurs ». Quelques-uns étaient partis à pied, plus tôt! Pour eux c'était une fête. Le temps d'atteler les chevaux sur la voiture à foin et tout le monde se trouvait au champ! La veille, l'aide engagé avec Charles-Auguste avait râtelé le foin avec le grand râteau et mis en veillottes (ballots) le plus possible ce qui avança beaucoup le travail! Les jeunes Jésuites étaient en appétit au repas du midi. Ils avaient apporté des provisions que je fis réchauffer ou cuire selon le cas. Ils étaient très gais autour de la table et encouragés pour rentrer beaucoup de foin! Ils prolongèrent leur séjour jusqu'au souper. J'avais préparé un bon repas et mon frère insista pour qu'ils acceptent notre invitation. Ils étaient enchantés.
Après le repas ils nous firent du chant et de la musique! Un se mit à l'harmonium et les autres chantaient à plusieurs voix, les partitions étaient merveilleuses et touchantes. En feuilletant quelques albums de la Bonne Chanson, ils exécutaient de belles mélodies. Ils terminèrent cette belle soirée de chant avec « Le vieux chalet » qui nous fit vibrer jusqu'au fond de l'âme. Je ne connaissais pas ce chant, ni mon frère. Nous étions « conquis » totalement par cette harmonie de voix. Après une bonne journée de travail satisfaisante, quel charme plus grand peut procurer un tel concert improvisé! C’était un enchantement pour des mélomanes comme nous! Quel bon souvenir nous avons gardé. Mon frère reconduisit les bénévoles qui étaient aussi heureux que nous! Ils renouvelèrent l’expérience la saison suivante. Les Jésuites étaient devenus des amis pour mon frère. Un encouragement véritable pour lui faire aimer son travail.
En 1946, petit Pierre à Fortunat passa l'année complète avec nous. Ayant été très malade, il ne pouvait suivre ses classes. Il lui fallait l'air de la campagne et de la distraction. Il avait fait une pleurésie et souffrait aussi d'anémie. Il accompagnait son oncle Charles-Auguste presque partout où il allait en automobile. Lorsque les Jésuites sont venus, il devait être avec nous puisqu'il accompagnait son oncle pour la livraison du lait dans le jour bien entendu. En 1947, Pierre est venu passer les vacances aussi, il était un peu plus fort et faisait quelques petites commissions pour nous qui étions toujours bien occupés.
Borromée déménage au village et devient conseiller puis maire du canton Loranger
Quelques mois plus tard, Borromée déménageait au village. Il avait acheté une terre de l'oncle Alfred et vendu la sienne ici. La cause : un accès plus facile à l'école pour les enfants. Il n'y avait pas de service d'autobus à ce moment-là pour le transport des écoliers. Jacques étant d'âge scolaire, il devait commencer son école en septembre, et les autres suivraient d'année en année. N'ayant pas d'électricité dans nos rangs, le travail aurait été trop lourd pour ma belle-sœur. L'entretien des vêtements, préparation des lunchs, etc. Mon frère continua d'être cultivateur. Il fut "laitier délivreur" pendant plusieurs années. Maman eut beaucoup de chagrin de ce départ. Les petits enfants égayaient nos parents lorsqu'ils venaient faire une visite ou des commissions. La distance était si courte entre nos deux maisons.
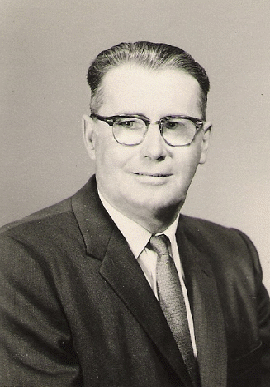
Borromée Lalande (1906 - 1987)
En 1944, mon frère Borromée décida d'entrer dans la vie municipale du Canton Loranger comme échevin. Puis en janvier 1947, il se porta candidat à la mairie. Après une lutte chaudement contestée, il remporta la victoire. C’était la 3e génération de Lalande qui oeuvrait dans la vie publique pour apporter sa collaboration entière au bon fonctionnement de notre paroisse. Tout comme grand-père et mon père, il se dépensa sans compter avec son énergie, sa ténacité et surtout sa « combativité ». Tout au long de sa carrière, il dût subir plusieurs luttes pour conserver son titre de maire. Sur toute la longueur de son règne, je crois qu'il a subi deux défaites, le ternie étant seulement de deux ans pour l'élu! À chaque nouvelle élection, il se représentait avec autant de vigueur. Il connaissait tellement les besoins de la paroisse, il avait la ferme conviction d'être utile, c'était sa première priorité. Il a travaillé de toutes ses forces au progrès du « mieux-être ». Les citoyens le savaient et l'appréciaient aussi! Il faut une vraie vocation pour être à la hauteur.
Accepter de devenir homme public, ce n'est pas toujours facile. Ça comporte de nombreuses difficultés, beaucoup de dévouement, de la bienveillance, de la bonté même. Le grand-père Anthime Lalande possédait ces qualités requises et il les a "léguées" à sa postérité je crois. On retrouve dans ses descendants la capacité du don de soi livré avec générosité comme il l'a fait lui-même au début de la colonisation de Nominingue! Mon frère Borromée fut maire jusqu'en 1971, année de la fusion avec le village de Nominingue, Bellerive et Lac Blanc. Ce fut très pénible pour lui d'abandonner la direction du Canton Loranger, dont l'état financier était en très bon, et qui accueillait déjà beaucoup de villégiateurs. Il avait beaucoup de respect pour eux parce qu’il réalisait que Nominingue était d’abord une place pour les touristes.
Un autre décès s’annonce : celui de mon frère Charles-Auguste
En 1948, mon frère Charles-Auguste engagea un adolescent pour tout l'été jusqu'à l'automne. Il se sentait toujours fatigué et avait conçu le projet de faire des grandes réparations à l'extérieur de la maison.
Durant la période des foins, en 1948, Charles-Auguste ne se sentait pas très bien. Il fit des ulcères douloureux dans la bouche et ses gencives étaient enflées et rouges. Il ne pouvait presque pas manger, seulement des mets faits au lait. Il n'était pas bien fort pour travailler aux foins. Ce mal a duré quelques jours et spécialement un après-midi alors qu'il fallait rentrer du foin, il était fiévreux et avait mal aux dents. Il dut s'aliter. Le soir venu, il alla voir le médecin sur mon conseil, celui-ci lui dit: « Tu fais de la piorrhée, il faudrait faire enlever tes dents ». Pourtant, mon frère avait les dents saines et brillantes. Il ne consentit pas à cela. À son âge, se faire enlever toutes ses dents, ce n'était rien de réjouissant, d'autant plus qu'en septembre, il voulait faire le revêtement de la maison. Il s'y préparait depuis le printemps.
Il avait coupé des billots sur notre terrain et les avait transportés au moulin à scie pour avoir des planches selon le besoin des réparations. Les coins de la maison furent remplacés ainsi que le tour de quelques fenêtres. Il commença les travaux en septembre avec un bon menuisier, M. Robert Loiselle. Mon frère ne négligea rien pour atteindre son objectif qui était de rendre la maison chaude et confortable, coquette, élégante, tout en gardant son « aspect antique" » Notre maison fut construite en 1894. Il réussit très bien à conserver les caractéristiques énumérées. Un travail très minutieux fut exécuté. Un revêtement d’« insulbrick » rouge fut apposé ; c’était le matériau le plus employé il y a 35 ans ! Depuis toutes ces années, rien ne s'est détérioré. C'est bien la plus grande preuve que le travail fut accompli à la perfection. Les travaux furent achevés en novembre! Charles-Auguste était exténué mais bien satisfait, ma sœur et moi étions ravies! Aux amis qui venaient le féliciter de sa belle réussite, il disait: « Ce n'est pas pour moi que j'ai fait tout ce travail, c'est pour mes sœurs ». Nous n'aimions pas cette phrase, ça nous faisait beaucoup de peine de l'entendre. Nous nous objections avec véhémence.
Pourtant ce fut la vérité. Un pressentiment le poursuivait sans cesse. Il ne mangeait pas beaucoup, sa digestion l'incommodait. Il ne pouvait manger du steak de bœuf, ça lui donnait des nausées. Pour comble de désappointement, Élisabeth dut aller à Montréal chez Fortunat. Florida ayant été hospitalisée, ne pouvait prendre soin de ses enfants et de sa maison. Elle passa trois semaines, ce qui était long. Moi je faisais toujours la classe dans mon rang. J'étais à la maison le matin et le soir. Je n'avais pas beaucoup le temps de faire de la cuisine. Charles-Auguste a souffert de cette absence de ma sœur. Il se pressait à s'organiser pour l'hiver. Sur une ferme, Dieu sait s'il faut prévoir! Il s'apercevait que sa santé se détériorait, alors il redoublait d'effort pour tout remettre à l'ordre. Il se sentait toujours fatigué et sa respiration haletante. Je me demandais ce qui pouvait causer ce comportement plutôt inquiétant! Lorsqu'il travaillait à des besognes harassantes, il y mettait l'énergie du désespoir. Un après-midi, j'arrivais de mon école, je le vis avec ses chevaux transportant des roches immenses. Lorsqu'il les chargeait ou déchargeait, il allait au bout de ses forces. Il faisait l'ouvrage de deux hommes. Il était à bout de souffle et d'une grande pâleur. Je lui dis: « Ça n'a pas de sens d'agir ainsi, prends un homme avec toi ou abandonne ce travail ». Il me répondit: « J'ai juste un voyage à faire et ce sera terminé, tu as raison, je me sens exténué. Je ne sais pas ce qui m'arrive, lorsque je vais dans la grange prendre du foin pour les animaux, je perds l'équilibre dans la tasserie ». J'en ai parlé à mon oncle Ernest dernièrement. Il m’a dit : « ce n'est pas normal mon neveu, tu es certainement malade, va voir un médecin ».
Ce soir-là, Charles-Auguste devait assister à une assemblée de la Caisse Populaire. Il était assigné au comité de surveillance. C'était un poste qu'il aimait occuper. Il se fit la barbe et se coupa ; des gouttes de "sang noir" s'échappèrent. Il dit avec amertume: « J'ai un conseil à donner, on doit se faire enlever les dents quand il est encore temps ». Il parlait pour lui. Élisabeth arriva le lendemain par le train. C'était plus encourageant.
Nous étions au début décembre et mon frère semblait souffrir d'un mal vraiment inexplicable. Il faisait un grand effort pour réagir aux pensées qui le tracassaient. Le temps des fêtes approchait à grands pas. Nous avions deux bêtes à tuer pour nous alimenter durant l'hiver. « Il faut que je me libère de toutes mes obligations » nous dit-il, « et après le Jour de l'An, je vais me faire extraire les dents à l'hôpital et probablement que j'aurai besoin de repos après mon retour ».
Il fit donc boucherie d'un bœuf et d'un porc l'avant-veille de Noël. Ce n'était pas trop difficile car la température était clémente. À peine avait-il terminé que notre voisin, M. Lafleur, lui demanda le service d’aller faire boucherie aussi chez lui. Charles-Auguste n'était pas très enthousiaste mais comme il était incapable de refuser un service, il se rendit à son désir. C'était présumer de ses forces. Il revint chez-nous à l'obscurité, très pâle et exténué. Le lendemain, veille de Noël, il alla chercher un surplus de moulée et de grains pour les vaches et les poules. Il désirait qu'on ne manque de rien durant son absence (à l’hôpital pour l’extraction de ses dents) après les fêtes. Il nous conduisit à la messe de minuit en automobile cette année-là, il n'y avait que très peu de neige et c’était doux. Il se donna beaucoup de mal pour réussir à la faire partir. Il l'avait remisée depuis un gros mois. Ce fut aussi la dernière fois qu'il s'en servit. Selon la tradition de quelques années, le Réveillon après la messe de minuit se donna chez Borromée et Jeanette. Fortunat et sa famille n'ont pu se joindre à nous, Florida étant en convalescence! Nous avons eu beaucoup de plaisir à savourer le bon festin que Jeanne (Jeannette) nous avait préparé et les jeunes garçons firent les frais du chant et de la musique.
Au Jour de l'An, c'était notre tour de recevoir toute la famille et faire des cadeaux à chacun, aux adultes et aux enfants. Ce jour de l'An 1949, Charles-Auguste nous fit des cadeaux particuliers et à Borromée aussi! Ce geste nous impressionna beaucoup. Après le souper succulent qu'Élisabeth apprêtait toujours si bien, commençaient les divertissements. Les jeunes faisaient chacun leur numéro, c’était bien intéressant ! On constate tout à coup que Charles-Auguste avait regagné sa chambre pour se reposer un peu. Chose qu'il ne faisait jamais les années précédentes. C'est Borromée qui s'aperçut de sa disparition. Il nous dit également : « II est certainement malade, il n'est pas à l’âge de perdre autant de forces »? Nous lui avons répondu: « II est décidé d'aller se faire enlever les dents à Montréal à l'hôpital Ste-Justine » Fortunat y travaillait comme menuisier. Borromée n'était pas certain que ce soit la meilleure solution. Ça faisait cinq mois que le docteur Mailly lui avait suggéré ce traitement. Charles-Auguste ne pouvait consentir de faire enlever ses dents par ici parce qu'il voulait une anesthésie. Il avait trop peur, se sentait trop nerveux et affaibli pour affronter cette épreuve.
Il partit donc le dimanche après le Jour de l'An. J'étais en congé scolaire, je pouvais aider ma sœur plus facilement, puis notre voisin pouvait envoyer un de ses garçons à l'occasion pour faire le train. Avant son départ, il alla faire une dernière visite aux animaux pour s'assurer qu'ils ne manquent de rien, puis il attela un cheval qu'il laissa dans l'étable en attendant la venue de Monsieur Lafleur qui devait le conduire à la gare. La porte de l'étable est vis-à-vis de la fenêtre de notre chambre, à bonne distance, bien entendu, mais nous pouvons voir très bien ce qui s'y passe. Par hasard, je me rends dans ma chambre et regarde par la fenêtre. Je restai « médusée » par le spectacle qui s'offrit à mes yeux. Charles-Auguste était sorti de l'étable dont il avait refermé la porte, et très droit, les deux mains sur les hanches, il regardait la maison d'un air tragique; maison qu'il avait réussi à rendre très attrayante. Il devait regarder son oeuvre avec satisfaction mais son attitude semblait plutôt déceler un « adieu ». J'appelai Élisabeth pour qu'elle vienne constater avec moi la gravité de la situation. Il demeura là, sans bouger, un long moment encore. C'était comme si une flèche nous avait traversé le cœur. Ce comportement étrange était bien loin de nous rassurer! Je dis à ma sœur: « Notre frère est beaucoup plus malade que nous l'imaginons »!
Avant de s'habiller pour le voyage, il prit une légère collation. Pendant ce temps, à la dérobée, je l’examinai attentivement et vit la pâleur indescriptible du visage, des mains et de ses oreilles Sa respiration était saccadée. J'en déduis intérieurement qu'il pouvait être atteint de « cancer ». Juste avant qu'il nous quitte, je lui dis: « Charles-Auguste, ne va pas à l'hôpital seulement pour faire extraire tes dents, profite de ton séjour pour passer un "examen général" de ta santé. Tu demeures chez Fortunat, il n'y a pas de gêne. Tu dois nous écouter. Ne reviens pas avant d'avoir subi un examen complet, radiographies, etc. Le médecin pourra mieux te soigner après ». Puis, je lui remis son carnet de chèque dans sa poche intérieure. « Tu possèdes de l'argent pour te faire revenir en santé. Il faut que tu en profites! Promets-nous de nous écouter, il le faut »! Il nous assura qu'il le ferait. Il partit donc avec M. Lafleur qui revint un peu plus tard avec le cheval et la voiture. Celui-ci ne nous raconta pas ce que fût leur conversation le long du trajet. Il le fit beaucoup plus tard... après son décès.
Nous étions très angoissées de ce départ spontané, mais confiantes en la réussite de sa démarche. Environ trois jours après son départ, après l'arrivée du train en gare, nous voyons la lumière d'une auto entrer dans notre cour. C'était vers 10h00 du soir. Qui pouvait être la visite qui nous arrivait en taxi? La porte de la maison s’ouvrit aussitôt, et qui nous apparut? Charles-Auguste en personne, le visage très enflé. N'ayant plus de dents, son visage était méconnaissable. La surprise nous empêcha de lui faire un accueil chaleureux. Nous lui avons demandé : « Tu n'as subi aucun examen spécifique ?» et il répondit « Durant l'extraction de mes dents, même si j'étais sous anesthésie, j'ai eu bien peur de mourir, alors je n'avais pas d'autre idée que m'en revenir à la maison chez-nous où je me sentirais à mon aise ». Il avait les gencives très enflées, ne pouvait manger que des aliments très doux, confectionnés avec du lait. Il n'y avait qu'Élisabeth qui pouvait en prendre soin comme il le désirait sans donner de trouble à personne. Il était gêné et délicat, ne voulant déranger qui que ce soit.
Nous l'avons bien compris, son foyer représentait la sécurité. Hélas, ce n'était pas suffisant pour lui faire recouvrer la santé! Il nous dit: « Je vais prendre quelques jours de repos, après je reprendrai mon travail quotidien ». Il le fit, mais lorsqu'il voulut retourner travailler un bel après-midi de janvier, il essaya de fendre quelques bûches de bois, mais il se sentit incapable de continuer. Il alla voir les animaux qui semblaient en parfaite forme, surtout ses deux chevaux qu'il aimait tant, puis il revint à la maison passablement découragé d'avoir si peu de capacité! Ma sœur lui dit alors : « Tu as perdu beaucoup de sang, il faut te donner un peu de temps pour récupérer tes forces ». « Il faudrait que j'aille voir le médecin pour qu'il me donne un bon tonique » répondit-il! « Puis nous allons engager un jeune homme pour qu'il fasse l'ouvrage de l'étable ». Nous avions huit à dix vaches laitières, deux chevaux et un ou deux porcs, environ 75 poules pondeuses. Ma sœur pouvait s'occuper du soin des poules, mais pas pour le reste. L'entretien de la maison et la cuisine pour quatre prenait tout son temps!
Élisabeth est allée toute seule au village car mon frère ne pouvait respirer l'air vif. Elle rendit visite au médecin qui lui fit savoir qu'il ne pouvait lui donner aucun remède sans l’avoir vu et examiné. « Qu'il vienne me voir, il est capable, il ne faut pas qu'il s'écoute ». Puis elle se rendit chez Mme Dussault qu’elle connaissait bien et elle put avoir son fils Denis pour venir nous aider. Donc Denis Dussault revint avec elle. C’était plus sécurisant ainsi.
Trois semaines s'écoulèrent sans apporter aucune amélioration dans son état, et le docteur ne venait pas le voir. Mon frère ne pouvait pas sortir, le grand air l'étouffait, le suffoquait. Il aidait ma sœur dans la maison, essuyait la vaisselle, faisait le feu dans la fournaise car nous chauffions au bois, nous n'avions pas l'électricité, l'éclairage se faisait au "naphta" ou à la petite lampe à pétrole. Pour l'étable, nous nous étions procuré un fanal Coleman au naphta également, un bon éclairage. Il ne dormait pas tellement dans le jour, alors il écoutait la radio attentivement, surtout l'heure du décès. Lorsque le sujet concernait quelque maladie, il cherchait à s'identifier à l'une d'elle en s'analysant minutieusement. Ma sœur et moi étions bien inquiètes à son sujet. Nous nous apercevions qu'il perdait des forces, il cherchait à s'appuyer sur quelque chose lorsqu'il marchait, soit au dossier d'une chaise ou après la table. À 43 ans, c'était loin d'être normal.
Tante Marie-Rosé Boileau et ma cousine Marie-Paule sont venues passer quelques jours avec nous, pour distraire Charles-Auguste et Élisabeth. Moi, je partais le matin et revenait le soir après avoir terminé ma classe. Un jour qu'Élisabeth était allée au poulailler, Charles-Auguste en profita pour parler de sa maladie à ma tante et à ma cousine en ces termes: « Vous savez, ma tante, de ma maladie je ne suis pas certain de m'en remettre. Je me sens diminuer tous les jours, je me sens vieux comme un homme de 85 ans. Je n'ose pas le dire à mes sœurs mais je dois être cardiaque pour être autant essoufflé. Je crains de ne pouvoir me rendre à la date de mon frère » (il était disparu un 29 avril). Ma tante l'encouragea de son mieux, mais son pressentiment l'obsédait tellement qu'il ne croyait pas à une guérison possible. Avant de partir, ma tante et Marie-Paule racontèrent cette conversation à ma sœur qui me l'apprit aussitôt.
Fortunat et Florida sont venus passer une fin de semaine avec leur deux fils, Pierre et Yvon qui était né le 17 septembre1945 et dont Charles-Auguste était le parrain et Élisabeth la marraine. Fortunat avait parlé de son état au médecin de l'hôpital qui lui avait extrait les dents. Celui-ci répondit qu'il s'était aperçu de sa grande nervosité et qu'il était sur le point de faire une grande dépression. Aucune prise de sang n'avait été prise! À Florida qui voulait le stimuler par tous les moyens, Charles-Auguste lui répondit: « Vous ne me croyez pas malade, pourtant je suis plus malade que vous, et beaucoup plus gravement que vous ne pensez »
Au début de la semaine suivante, rassemblant tout son courage et toute son énergie, il dit à ma sœur et à Denis Dussault: « Aidez-moi à m'habiller, je veux me rendre à l'étable pour me prouver si je suis capable de me rendre chez le médecin têtu qui m'ordonne d'aller le voir chez lui » Il sortit donc de la maison accompagné de ma soeur d'un côté et de Denis de l'autre côté. Rendu à mi-chemin de l'étable, il leur dit: « Allez me chercher un banc pour m'asseoir, je n'en peux plus ». Après quelques instants d'arrêt, il se rendit à l'étable, là, il demanda à s'asseoir, parla à ses chevaux qui lui répondirent par un hennissement! Ses bêtes l'avaient reconnu par sa voix! « C'était touchant » dit Élisabeth. Ce fut la dernière fois de sa vie qu'il leur parla et les regarda avec douceur. Ils allaient perdre leur maître. Charles-Auguste demanda à revenir à la maison immédiatement et là assis dans la berceuse, avec un regard de détresse, il dit: « Je suis un homme fini! Je veux faire mon testament »! Élisabeth fit signe à Denis de sortir avec elle. Et là, elle lui ordonna d'aller chercher le médecin sans délai » «dis-lui que c'est moi qui le demande avec insistance. Mon frère n'en saura rien, tu as constaté qu'il n'est plus capable de quitter la maison, et fais ça vite! Ça presse ».
Ce ne fut pas long, le docteur arriva, il lui jeta un oeil surpris. Il n'avait pas vu encore sa pâleur cadavérique, jusqu'aux lèvres qui étaient blanches. Charles-Auguste le reçut en ces termes: « Docteur, il me semble que la science est assez grande pour venir au patient et non pas le "patient" courir après la science. Je suis un homme fini! Je dois faire mon testament sans retard ». Le docteur lui répondit: « Ne crains rien, tu ne mourras pas ». Quelle parole inconséquente! Personne n'est exempt de la mort! Avant de partir, il dit à Élisabeth: « Que votre sœur vienne chercher des remèdes à mon bureau ». Deux ou trois jours après cet incident. Borromée était désigné par le Conseil Municipal pour aller rencontrer un ministre. Il voyagerait par train. En apprenant cette nouvelle, Charles-Auguste dit: « 'Je voudrais aller à l'hôpital pour être mieux soigné. Je ne serais pas inquiet, je ferais le voyage, le trajet avec toi. Je demanderais à Fortunat de venir me chercher au train et me conduire à l'hôpital ». Borromée était bien d'accord. Je lui dis: « II faut avertir le médecin. Viens avec moi chez le docteur, je préfère que tu lui parles ». Charles-Auguste m'avait fait promettre de ne pas me laisser influencer par lui. J'étais bien mal à l'aise. Borromée expliqua au médecin que Charles-Auguste voulait être hospitalisé et qu'il l'accompagnerait. « Ou bien descendez-le vous-même à l’hôpital si vous craignez quelque indisposition. Mes sœurs vous paieront généreusement »! « Non, non, non » répondit-il, « il est trop faible ». Il me met une boîte d'ampoules d'hémoglobine sur les genoux. « Donnez-lui une injection par jour et après nous verrons ».
J'arrive à la maison toute confuse . Charles-Auguste me dit: « Tu n'as pas pu lui résister, je le pressentais ». Il fit venir mon oncle Ernest pour lui couper les cheveux. En l'espace de deux mois, il devint tout à fait grisonnant. Les injections ne faisaient aucun effet ! L'anémie dont il souffrait était devenue trop grave. Un médecin étranger étant venu pour une clinique, Borromée l'amena chez nous pour la version d'un autre diagnostic. « Il ne fait pas d'infection car il n'a pas de température ». Nos démarches étaient toujours infructueuses. C'était plus déprimant.
Quelle était donc cette maladie mystérieuse qui le consumait? Nos espoirs de guérison diminuaient chaque jour. Nous étions le dernier jour de février; j'arrive de l'école, Charles-Auguste était assis dans la berceuse, il me dit: « Prends donc ma température, je me sens fiévreux ». En effet, il faisait 102 de température. Il y avait une épidémie de grippe dans la paroisse cet hiver-là. Comme sa chambre était à l'étage supérieur, il monta à peu près quatre marches de l'escalier, il s'arrêta et dit: « Je ne suis plus capable »! « Attends », lui dis- je, « tu vas coucher dans la chambre voisine de la nôtre »! « Ah », dit-il, « la chambre dans laquelle nos disparus ont passé »! Quel choc ce fut de lui entendre dire cette phrase.
Le lendemain, on faisait venir le médecin qui lui fit une injection pour 48 heures. « C'est une mauvaise grippe ». Son système n'avait aucune défense. Il ne gardait pas le lit continuellement mais marchait difficilement. Il avait la poitrine gonflée sans perdre de poids, il se plaignait de douleurs à l'estomac! Lorsque le docteur revint, il semblait plus soucieux. Il lui fit deux autres injections, on aurait dit qu'il faisait une bronchite, sa gorge était très embarrassée, sa respiration difficile. Il me faisait penser à maman. Nous vivions une angoisse terrible.
Le dimanche matin, 6 mars, il se leva, puis s'installa près de la fournaise. Il semblait un peu confus, sa conversation plutôt étrange! Fortunat nous avait dit que lorsque l'anémie atteindrait le cerveau, il deviendrait confus. Je le fis manger; il n'avait pas la force de le faire, sa vision était très faible également. Il parlait très peu. Après la messe, une dame amie vint lui rendre visite. C’était Mme Remi Cornut qui avait perdu son mari subitement l'année précédente. Charles-Auguste l’a reconnue et je le vis faire un effort inouï pour recouvrer ses esprits et soutenir une conversation intéressante, c'était une dame si sympathique! Il réussit complètement à redevenir lui-même, cette attitude ne le quitta plus jusqu'à son décès! Le soir de ce même jour, nous eûmes la visite de Mme Arthur Nantel et son fils Léopold. Lorsque ce fut le temps d'allumer la petite lampe à pétrole dans sa chambre, je le sentis très nerveux et vis une grande inquiétude dans son regard.
Il ne nous a jamais parlé de la mort, sans doute pour ne pas nous effrayer ou nous attrister. Que de tristes pensées devaient assaillir son esprit durant ces longues journées et nuits sans sommeil! Lui si profond se sentant aller vers "l'inévitable". Combien de questions devait-il se poser à notre sujet? Qu'allions nous devenir sans lui? Et lui-même qui redoutait tant la mort? Aussi quand Mme Nantel apparut sur le seuil de la porte, il la salua par ces paroles: « Mme Nantel, vous venez passer la dernière nuit avec moi »? Paroles tout à fait inoubliables, même après 34 années! Mme Nantel fut tout à fait à la hauteur. Elle lui dit: « Bien non, je viens jaser avec vous et vos sœurs, bientôt ce sera le printemps, il faut faire des projets ». « Pas moi, madame, c'est fini ». Avant que Léopold ait attaché son cheval, Élisabeth lui demanda d'aller chercher le médecin, il avait besoin de son assistance pour passer la nuit.
En cette journée du dimanche, Borromée avait demandé à monsieur le Curé de venir rendre visite à Charles-Auguste qui déclinait à vue d’œil. Il profita de la voiture du médecin pour venir. Puis Borromée vint aussi avec sa femme en voiture. Nous n'étions pas seules. Ça contribuait à maintenir notre moral. Le médecin lui injecta un remède pour le cœur par deux fois. « Donnez-moi de ses nouvelles demain » nous dit-il! Quand monsieur le curé partit, mon frère d'une voix forte dit: « Monsieur le curé Perreault, vous allez voir comment ça meurt un célibataire ». Ils s'entendaient très bien tous les deux. Le curé le taquinait souvent et Charles-Auguste acceptait très bien ses plaisanteries! Ensuite Borromée et sa femme nous quittèrent. Borromée avait son travail le lendemain ; il était laitier au village. Lorsque Jeanne dit: « Bonsoir, Charles-Auguste », il reprit après elle: « Bonsoir, Jeanne » Lorsqu'elle ouvrit la porte extérieure de la maison, il lui cria d'une voix forte: « Bonsoir Jeanne, bonsoir Jeanne » ! C'était un adieu qu'il lui faisait! Elle l'a constaté après son décès.
Mme Nantel, toujours bonne et dévouée, nous offrit de passer la nuit avec nous, mon frère était agité et une autre présence l'encouragea. Elle dit à Léopold: « Va chez nous, tu viendras me chercher dans la journée de demain ». La nuit nous parut assez longue. Il sommeillait quelques minutes sans perdre tout à fait conscience. Comme tout était bien calme, Mme Nantel me dit: « Allez vous reposer Lucille, je vais veiller avec votre sœur ». Elle croyait que j'irais enseigner le lendemain. Lorsqu'il ouvrit les yeux, Charles-Auguste s'aperçut que je n'étais pas dans la chambre. Il dit à Élisabeth: « Où est Lucille »? « Elle est allée se coucher » répondit-elle. « Dis-lui qu'elle vienne! On a pas assez longtemps à vivre ensemble maintenant, qu'elle reste ici avec vous »! De ma chambre, j'entendis cette phrase. Je me levai donc instantanément et je me mis à lui parler pour le convaincre que j'étais bien là. Il souffrait de la faim, il nous demanda un verre de lait et du jello. Nous hésitions un peu car c'était le milieu de la nuit! Alors il nous dit: « Tout ce que je demande, c'est un peu de sympathie ». Avec empressement, nous lui avons apporté ce qu'il désirait. Il mangeait avec avidité tout ce qu'on lui donnait. Il manquait tellement de globules rouges.
Le jour se leva enfin avec sa lumière bénéfique qui chasse les affres de la mort. Les ombres de la nuit favorisent les angoisses, la lumière ensoleillée remet le calme et la sérénité dans l'âme. Mon frère était beaucoup plus paisible durant le jour! Ce matin-là, le 7 mars, il parlait très peu. De bonne heure, je me rendis chez le médecin avec Borromée tel que demandé par lui la veille ! Nous l’avons averti qu'il allait de plus en plus mal. Alors il décida de le conduire à Montréal le lendemain matin vers 7h30. Il téléphona devant nous à l'hôpital en ces termes: « Demain avant-midi je vous amènerai un patient qui souffre d'anémie au « dernier degré ». S'il avait connu mieux la maladie, il aurait dit qui souffre de leucémie ou cancer du sang ». En 1949, c'était une maladie peu connue.
Nous étions durant le temps du carême ou "temps pascal", alors je vais avertir Monsieur le Curé que mon frère s'en allait à l'hôpital le lendemain matin avec le médecin et que nous désirions qu'il fasse ses "pâques" avant de partir; confession, communion, j'eus l'idée d'ajouter "extrême-onction", mais le médecin ne le jugeait pas nécessaire. Pourtant il était bon chrétien! Il ne pouvait s'imaginer que la fin de son patient fut si proche. Charles-Auguste eut une dernière déception car ce ne fut pas M. le Curé lui-même qui vint mais son vicaire arrivé dans la paroisse depuis trois jours à peine. Ne le connaissant pas, il n'eût pas la même satisfaction qu'il aurait eue avec M. le Curé avec qui il avait tant conversé. Après le départ du vicaire, j'allai près de mon frère, faire avec lui une courte "action de grâces". C'était de rigueur à cette époque après la communion
Après cette prière, je lui demandai: « Est-ce que tu as aimé notre nouveau vicaire »? « Ah »!, me répondit-il, « oui, mais pas tellement »! Je sais qu'il s'attendait à voir M. le Curé ! Destin inexorable parfois! J'eus beaucoup de peine pour lui qui avait subi "plusieurs désillusions dans sa vie" surtout moralement! Il disait souvent: « Nos désirs sont comblés, toujours trop tard et souvent pas du tout »! « La vie est un combat dont la palme est aux cieux ».
En toute circonstance il faut être réaliste. Je dis à ma sœur: « Charles-Auguste s'en va demain, nous reviendra-t-il vivant »? Il avait quelques comptes non payés. Je pris l'initiative de lui faire signer quelques chèques à nos deux maisons bancaires où il déposait son argent. « Pourquoi me faire faire cela »? dit-il. L'occasion était toute choisie pour ne pas l'inquiéter. Il avait acheté du foin à la Coopérative et il n'était pas payé. « II faut aussi payer le voyage du médecin et les remèdes! Tu as raison » me dit-il! Je lui présentai un premier chèque pour avoir sa signature. « Comment vais-je me placer pour écrire, je ne vois presque rien »? « Essaie »", lui dis-je, « je vais t'aider »! Cette bonne madame Nantel était encore avec nous, elle nous servit de témoin. J'avais le cœur serré de constater cette déficience. Pas de vision et une main incertaine. Je lui en fis signer deux, mais pas davantage. Il était incapable. C'était suffisant pour nous! Intérieurement, je pensai: « II ne survivra pas longtemps. »
Les dernières heures de Charles-Auguste
Mme Nantel nous quitta dans l'après-midi. Elle dit à mon frère: « Je reviendrai vous voir demain ». Il a eu la force de lui répondre « Merci beaucoup madame Nantel pour tout ce que vous faites pour moi » Et le soir, c'est Borromée qui vint passer toute la nuit avec nous, la dernière de sa vie. Il n'avait pas parlé de l'après-midi, sauf lorsque nous le faisions manger. Quand Borromée arriva dans sa chambre, quel réconfort pour lui, ça paraissait tellement ! Élisabeth et moi nous préparions sa valise pour le lendemain matin. Mon oncle Ernest Lalande, bien sympathique et compréhensif pour Charles-Auguste et pour nous, l'accompagnait pour le trajet et son entrée à l'hôpital. L'aurore pointait à l'horizon, bientôt apparaîtrait la lumière du jour qui s’annonçait très beau ce matin-là. Bientôt le soleil brillera de tous ses rayons, mais quelle journée serait la nôtre?
Tous les trois, nous n'avions pas fermé l’œil de la nuit. Notre malade fermait les yeux pour dormir, un soubresaut le secouait, il râlait par moment. C'était un bien court repos. Une fois, en s'éveillant brusquement, il dit à Borromée: « J'ai rencontré papa au village, il n'est pas arrivé à la maison »? Quelle phrase surprenante qui annonçait sa fin très prochaine! En le faisant manger au cours de la nuit, je m'appuyai contre lui et je sentais sa chair trembler. J'en étais stupéfiée.
Dans la chambre qu'il avait toujours occupée, un lampion a brûlé toute la nuit devant une statue de la Vierge. Je montai plusieurs fois pour prier et demander à la Ste-Vierge et à mes parents défunts de ne pas permettre qu'il meure en chemin. Nous avons été exaucés.
Vers 5h30 ou 6h00, ma sœur lui porta à déjeuner. Il mangea un oeuf bouilli avec rôtie et un jus de fruits. Puis il demanda: « 'Envoie-moi de bonnes petites choses que je puisse manger durant le trajet »! « Ne crains rien », dit-elle, « c'est déjà préparé, je t'envoie des pêches que tu aimes tant et du bon jello froid »! Après il ne parla plus… ne faisait aucun geste
Comme il approchait sept heures, Élisabeth dit à Borromée: « II faut le préparer, commencer à l'habiller, le docteur vient à 7 1/2 heures ». Elle s'approcha de lui, lui lava doucement le visage. Il ouvrit alors les yeux, la regarda avec douceur et tristesse. Deux larmes s'échappèrent de ses yeux et roulèrent sur ses joues. Élisabeth me dit: « Viens voir Lucille comme son visage est doux et beau »! ! ! Elle prit son visage dans ses deux mains. Il fît un effort pour lui dire: « Ma pauvre Zabeth, si tu savais »! Ce fut ses dernières paroles. Lorsque Borromée et Élisabeth ont voulu le retourner pour l'habiller, il respirait tellement fort en râlant qu'ils ont abandonné... Je leur dis à tous les deux: « Je cours chez M. Lafleur ». « Allez chercher le médecin, dites-lui que nous ne pouvons l'habiller et ramenez le prêtre pour l’Extrême-Onction »
Monsieur Lafleur avait la grippe. Il lui fallait atteler son cheval. Je trouvais qu'il était lent à sortir de la maison. Il sortit enfin et je lui dis :« M. Lafleur , ça presse, mon frère se meurt »! Je revins en courant à la maison. Il était dans le même état, les yeux fermés, respirant un peu moins fort et ne bougeant plus. Nous trouvions le temps très long. Finalement, monsieur Lafleur revint avant le médecin et nous raconta qu'il était allé chercher son auto au garage, qu'il passerait par l'autre chemin et qu'il n'avait pas le temps d'attendre le vicaire. Je dis à M. Lafleur, c'était de l'amener dans votre voiture. Mais le docteur ne voulait pas être contrarier. Il retourna cependant au presbytère chercher monsieur le vicaire. Mais toutes ces démarches furent inutiles. Quelques instants plus tard, Charles-Auguste expirait calmement, sans un geste. Il aura gardé le lit seulement deux jours.
À ce moment précis, le médecin arrivait à notre barrière du chemin où il laissa son auto. Alors qu’il se dirigeait vers la maison à pied avec sa trousse, ma sœur sortit sur la galerie et lui cria presque: « Docteur, quand on vous fait demander, vous ne venez pas, c’est trop tard maintenant, il est fini». Il s'arrêta quelques instants, avec hésitation, ne sachant s'il devait venir à la maison ou s'en retourner. Il prenait le parti de s'en retourner. À mon tour je lui dis: « Venez le voir au moins pour constater son décès ». Il vint et ne dit pas un mot. Borromée en le voyant entrer lui dit : « Venez voir celui que vous avez ridiculisé pendant si longtemps en l’accusant de manquer de coeur ». Il repartit sans nous adresser la parole. À peine dix minutes plus tard, il revenait avec M. le vicaire qui lui fit une seule onction sur le cou avec le Saint-Chrème. Ce que l'on appelait dans le temps Extrême-Onction « sous condition »! Comme il avait communié la veille, il était en état de grâce. Mais nous étions tous les trois tellement énervés et remplis de chagrin que nous doutions de la validité du sacrement! À tort bien entendu!
Le médecin était aussi blanc que Charles-Auguste. Il se sentait tellement dépassé par cette brusque fin, pour lui incompréhensible et prématurée. Il lui avait aménagé un lit-civière dans son auto. Il y avait seulement deux jours que mon frère gardait le lit. « Il a fait une pneumonie de vieillard » cause de son décès. Affaibli par la leucémie, son organisme n'avait aucune défense. Des tests avaient permis de voir que son sang étant composé d'un nombre incalculable de globules blanc, signe d’infection En 1949, la recherche sur cette fameuse maladie « leucémie ou cancer du sang » n'était pas bien avancée. On ne la connaissait pratiquement pas. La pneumonie a devancé beaucoup son heure de décès. Il aurait souffert terriblement s'il s'était rendu au terme de la maladie. Dieu en avait décidé autrement. Décès : le 8 mars à 7 1/2 heures du matin à l'âge de 43 ans et 6 mois. L'irréparable était consommé. Nous nous sentions démolis, anéantis!
Réagir et préparer les funérailles
Nous avons alors discuté de plusieurs sujets avec le médecin. « II est mort sans testament et les chèques qu'il a signés ne sont pas échangés. Que peut-on faire en pareil cas? ». Voulant sans doute se rendre utile après tout ce qui venait de se passer et suite à nos dernières paroles il nous dit : « Confiez-moi vos chèques, je vais m'occuper immédiatement de vous faire récupérer cet argent . . son décès n'étant pas encore connu » Le docteur était aussi président de la Caisse Populaire. Il est certain que son manque de connaissance au sujet de cette maladie n'était pas volontaire. C’est tout comme si mon frère avait été victime d'un accident.
Après le départ du médecin, nous tournions en rond. Nous nous sentions dépassés par cette cruelle épreuve. Pourtant il nous fallait « agir », la situation l'exigeait! Ce ne fut pas long, notre bonne Mme Nantel nous arriva vers 10 heures! Elle s'informa comment s'était effectué le départ de mon frère? Nous n'avons pas répondu... et pour cause!. Elle nous demanda: « Que s'est-il donc passé?... Il n'est pas parti pour l'endroit prévu ? » « Madame, il est parti pour le grand voyage d'où nous ne revenons plus »! « Quoi »! nous répondit-elle! » « Venez le constater dans la chambre » ! Elle fut consternée autant que nous. Elle prononça de bonnes paroles d'encouragement. « C'est mieux ainsi. Il est mort chez lui dans son lit! On ne transporte pas un moribond »!
Ce qu'il y a de plus cruel après un décès, nous ne pouvons donner libre cours à notre douleur, à notre peine. Il faut réagir et s'oublier jusqu'après les obsèques. Quatre fois nous avons dû subir cette situation en sept ans et quatre mois! Situation indescriptible! Borromée descendit au village, chez-lui, pour son travail quotidien et apprendre la triste nouvelle à sa femme. Un peu plus tard, j'allai le retrouver pour qu'il m'accompagne dans l'organisation des funérailles. C'est Généreux & fils qui était entrepreneur funéraire à Nominingue. Monsieur s'occupait de tout. Une chance que j'avais Borromée pour m'aider à prendre les décisions d'usage. Choix d'un cercueil, etc.
Une étape des plus pénibles, fût d'avertir Fortunat à Montréal de ce qui venait d’arriver. Il attendait l'arrivée de Charles-Auguste à l'hôpital et trouvait que son transport retardait énormément. Ce fut un choc terrible pour lui qui n'avait pas suivi la maladie de son frère dans les derniers jours. Il fut consterné, atterré. Il décida de venir le soir même à la maison pour nous assister, partager notre douleur et remplir les dernières obligations dues à notre cher disparu. Il vint avec Florida sa femme et leurs deux fils, Pierre et Yvon.
Le même scénario se répétait encore une fois. Plusieurs personnes sont venues rendre un dernier hommage à notre frère. Nous avons eu beaucoup de sympathie de la part de ses amis d'âge et de toute la paroisse en général! Les gens étaient tellement surpris de ce « départ prématuré » lui qui était si jovial, si amical avec tous. Nos voisins amis nous prodiguèrent une aide remarquable dans les circonstances. Ce fût un grand réconfort pour nous. Outre la présence de nos oncles et cousins de la paroisse et ceux de l'Annonciation, un grand nombre de parents de Ste-Scholastique sont venus pour la dernière veillée et les funérailles le lendemain jeudi le 10 mars. Le premier visiteur qui vint nous offrir ses condoléances fut monsieur le Curé Perreault ! Il était très affecté lui-même. Les Frères de l'Instruction Chrétienne avec « leurs élèves » du village ont fait le trajet à pied, aller et retour! Nous en étions très émus! Aussi, les différents organismes de la paroisse se sont fait représenter.
Le jour des funérailles, l'Église était remplie à craquer, il y en avait même debout en arrière des bancs. Lui qui avait dit après les funérailles de mon père qui avaient rempli l’église et réuni plusieurs personnalités : « Nous, célibataires, quand la mort viendra nous cueillir, il y aura à peu près une vingtaine de personnes qui seront présentes à nos funérailles ». À ce moment-là, les célibataires étaient moins appréciés! Pauvre lui, il manquait de confiance en sa vraie valeur. S'il avait pu voir ce grand nombre de personnes venir lui dire adieu, il aurait été heureux. Après les obsèques, Fortunat et sa famille passèrent le reste de la semaine avec nous.
Charles-Auguste voyait venir sa mort. Il s’en est confié à un ami...
Mon frère voyait venir sa mort dès le début de janvier, mais, ne voulant pas nous effrayer, il ne nous en parlait pas. Cependant, il se confia à monsieur Arsène Lafleur, chemin faisant en voiture vers la gare, prendre le train qui devait l’emmener à Montréal pour l’extraction de ses dents. Il lui dit : « Je suis très malade... je ressens un malaise inconnu qui me détruit. Je ne passerai pas à travers... je ne me rendrai pas à la date de mon frère Arthur (29 avril). Je pense à mes deux sœurs, que vont-elles devenir sur la ferme? Je crois qu'elles se débrouilleront. Lucille va pouvoir conduire l'auto, j'en suis certain! Élisabeth sait atteler le cheval gris "Soldat". Elle va pouvoir s'en servir. Quant à Maguy, ma belle petite jument brune, je ne sais pas .Elle est bien fringante. Vous y verrez, M. Lafleur. Quand les autres sont morts, j'étais là pour voyager le médecin et surtout le prêtre, je n'aurai pas la même chance. J'ai fait mon grand possible pour mon père, j'ai voyagé le prêtre pendant 14 jours et pour moi, personne ne pourra le faire »! M. Lafleur lui répondit: « Je suis là moi si ça arrivait » ! « C'est encore curieux », dit mon frère, « vous pourrez être malade, incapable de sortir! Je pense que le bon Dieu me demande ce sacrifice-là »! « Ce n'est pas rassurant, j'ai peur de mourir sans secours religieux » M. Lafleur reprit: « Ne te tracasse pas avec cela » Dire que ce pressentiment s'est déroulé à la lettre tel que prévu par mon frère. Monsieur Lafleur ne nous en a pas parlé avant parce qu’il pensait jamais que les événements se passeraient ainsi. Il croyait, de plus, que Charles-Auguste « divaguait et dramatisait son état » Devant le « destin inexorable ».Que pouvons-nous faire maintenant? « Le Seigneur », dit-on, « nous conduit avec un bandeau sur les yeux mais il conserve sa main sur notre épaule ». Elle pèse lourdement parfois. La réalité cruelle était là devant nous. Il fallait porter notre croix !
Charles-Auguste, la personne
Juste quelques mots sur la personnalité de Charles-Auguste. Il était doué d'un talent remarquable, d’une grande sensibilité et d'une mémoire prodigieuse. Si les circonstances l'avaient permis, il aurait pu recevoir une instruction supérieure, ce qui aurait comblé son esprit de recherche et sa culture personnelle. Dans ses loisirs, c'était le dictionnaire qui devenait son compagnon pour mieux choisir ses expressions. Durant sa maladie (dyspepsie nerveuse), à l'âge de 24 ans, il a appris de mémoire un nombre incalculable de poésies, de poèmes qu'il découpait dans les journaux. Il pouvait en réciter pendant des heures. Le soir, alors que je jouais en sourdine une mélodie mélancolique sur mon harmonium et qu’une émotion prenante remplissait l'atmosphère, il vibrait de toute son âme. Lui particulièrement, mais aussi ceux qui étaient présents. Très sensible, nerveux, très gêné ou timide au début de l'âge adulte, il ne put accomplir bien des choses qu’il avait souhaitées. Évidemment, cet embarras s'est éclipsé avec le temps, heureusement. Charles-Auguste avait une personnalité attachante.
Il oeuvra dans quelques activités sociales qui lui allaient très bien, que ce soit à titre de membre actif de la Coopérative agricole, de directeur dans le Comité de Surveillance de la Caisse Populaire ou de marguillier durant trois ans. Il possédait un sens remarquable du devoir.
Retour à la table des matières