La santé d’Élizabeth de plus en plus précaire, un accident banal cause sa mort (1971 – 1976)
La santé d’Élizabeth et la mienne se détériorent. La cause : le diabète
Au début janvier 1971, Élisabeth fut hospitalisée à Ste-Rose. Elle devait aller à Maisonneuve, il n'y avait aucune place libre. Alors Fortunat la conduisit à Ste-Rose par l'entremise de Cécile Poirier Lalande qui en était la directrice. Durant tout le mois décembre précédent, elle n'était pas bien du tout. Glycémie trop élevée, hypertension à la hausse, trouble d'intestin. Il lui fallait une vérification générale de son état de santé. Son absence dura un mois pour un bon équilibre de son diabète. Germain s'occupait de la ferme et aussi de la maison quand j'étais à l'école. Je venais dîner tous les midis. Son absence nous parut longue à tous les deux. Lorsqu'elle revint, je fis une grosse grippe.
Elle avait été si bien traitée qu'elle voulut m'envoyer à mon tour, ma glycémie étant très haute. Je demandai à la directrice qui me l'accorda. Je maigrissais sans arrêt. Je fis un séjour d'un mois à l'hôpital Ste-Rose. Étant très nerveuse, le médecin avait de la difficulté à équilibrer mon diabète. J'ai jeûné plus qu'à mon goût. Je ne manquais pas de visite. Ma cousine Fernande travaillait dans la comptabilité à cet hôpital. Elle me faisait une visite tous les jours et m'encourageait tellement. Elle était une véritable sœur pour moi. Depuis notre tendre enfance, nous avons été « liées » étroitement.
Mon frère Borromée et sa femme demeuraient dans les environs pour la durée de l'hiver. Mon frère est venu me voir souvent, et lorsque j'ai obtenu mon congé après quatre semaines (tout le mois de mars), c'est lui qui m'a ramenée chez nous en automobile.
Je pris quelques jours de convalescence et je retournai prendre ma classe au début de la semaine sainte. Les élèves étaient très heureux de mon retour. Trois suppléantes avaient séjourné durant mon absence. Je ne voulais pas que mes élèves perdent leur année scolaire, je leur dis: « Êtes-vous prêts à redoubler d'effort, pour obtenir de bons résultats à la fin de l'année »? Un cri unanime retentit: « Oui, Mademoiselle »! C'était touchant de les voir aussi ambitieux. Ce ne fut pas long que ma santé s'en ressentit mais il ne fallait pas « flancher ». Jusqu'au bout, il fallait résister! Hélas! Ce fut la limite. Je perdais constamment du poids. Sur le conseil du Dr Roy, je donnai ma démission à la Commission Scolaire en juin 1971. C'était la fin d'une carrière qui m'avait apporté beaucoup de joies et de nombreuses compensations. J'ai donné le meilleur de moi-même partout où j'ai oeuvré.
En 1972, au début janvier, je me sentis terriblement fatiguée, sans entrain et je n'avais pas le courage d'aller chez mon médecin à Mont-Laurier. Je pressentais que je faisais beaucoup de « sucre » que ma glycémie était à la hausse. Un peu avant la fin janvier, je me rendis à l'hôpital Mont-Laurier pour une prise de sang et au début de l'après-midi chez le Dr Roy pour le résultat du laboratoire. Comme je l'avais deviné, je faisais un taux de sucre très élevé. Je n'arrivais plus à contrôler mon diabète. Le Dr Roy était très déçu et inquiet, je faisais au-dessus de 400 ce qui était de « l'hyperglycémie ». « Je vous envoie tout de suite à l'Hôtel-Dieu de Montréal » me dit-il. « Pouvez-vous partir ce soir pour Montréal? J'appelle tout de suite l'Hôtel-Dieu et je vous recommande à un médecin que je connais très bien; il va s'occuper de vous avec intérêt ». Je lui répondis: « Docteur, il faut que je retourne chez-moi (30 milles en voiture) et que je prépare ma valise pour un séjour assez long. Je partirai demain matin. Je vous le promets. Je suppose que l'on va me donner de l'insuline »? « Vous ne pourrez jamais vous équilibrer sans cela »".
Et il a eu raison. Je téléphonai à Fortunat lui demandant s'il voulait être assez aimable de venir me chercher à l'arrivée du train à Montréal. Pierre insista auprès de son père pour qu'ils viennent me chercher en automobile tous les deux. Ce qui fut fait. Le lendemain était un samedi, il pleuvait et les chemins étaient glacés. Nous sommes arrivés assez tard à Montréal. Je me fis conduire immédiatement à l'hôpital. C'était le 22 janvier. On me prit en charge aussitôt et deux jours après mon taux de sucre était à 117 degrés. L'insuline produisait son « efficacité » déjà. Après examens complets de la tête aux pieds, je dus subir une opération grave le 28 janvier et une autre mineure quinze jours plus tard. Je suis demeurée un gros mois à l'Hôtel-Dieu où je fus traitée admirablement bien.
Pendant mon absence, Élisabeth avait Normand comme compagnon. Heureusement. Avant de partir, je lui avais prescrit un horaire de classe pour qu'il continue de faire des progrès lorsque je serais de retour. Je téléphonais souvent à la maison et ma sœur me disait que Normand exécutait très bien son travail scolaire. Il s'était fixé une heure et plus de liberté chaque jour, et il était ponctuel à son horaire. Je l'encourageais par téléphone. Il aimait mieux les mathématiques que le français. Qu'importe, il avançait en faisant sa recherche lui-même. À mon retour, je fus étonnée du travail qu'il avait accompli. J'ai dû prendre quelques mois de convalescence pour le travail. J'avais une diète sévère à observer, je souffrais de la faim. Lorsque je sortis de l’hôpital, mon poids était de 97 livres, j'en avais à reprendre.
Le diabète est une maladie difficile à accepter. Il faut posséder une volonté rigide qui s'acquiert avec le temps. Lorsque je commençai à reprendre un peu de poids, je me sentais encouragée. Il faut beaucoup de discipline pour éviter les complications que cette maladie peut apporter. On peut faire une vie normale si on se résigne à accepter certaines incommodités. Il faut cultiver la gaieté, c'est très important. Dramatiser tout ce qui nous arrive, c'est trop « négatif ». Nous devons vivre « positivement » Tout allait bien, mes forces revenaient graduellement
Ma sœur Élizabeth victime d’un accident banal qui se complique (1971)
Au début de l'été, il arriva un malencontreux accident à Élisabeth; incident banal qui tourna au tragique. À l'heure de la traite des vaches, Normand rentra les animaux dans l'étable, ma sœur lui aida à attacher les vaches. Alors qu'elle s'apprêtait à en attacher une, la jeune taure qui était à côté lui donna un coup de corne en arrière d'une jambe presque au mollet sur une « veine ». Ma sœur physiquement n'était pas sensible. En revenant à la maison, elle boitait. Je lui dis: « Que t-est-il arrivé »? « Ce n'est rien, c'est un coup de corne que j'ai reçu en arrière de la jambe » répondit-elle. Elle continua à vaquer aux occupations de la maison. Le soir au coucher, sa jambe la faisait souffrir un peu. Je lui dis: « Demain, nous irons à l'hôpital ». « ¨Ca ne sera pas nécessaire ». Le lendemain, sa jambe « bleuissait » autour de la veine mais elle ne boitait pas. Je voulais la conduire au médecin. « Non, non », dit-elle, « ça va se passer ». Le surlendemain matin, sa jambe était bleu-violet, plus grand que la veille. Elle commença à s'inquiéter. « Habille-toi » lui dis-je, « nous allons à l'urgence, c’est peut-être un peu tard ».
Après examen les deux médecins, lui disent : « Mlle, vous faites un hématome, votre veine a été crevée, nous allons devoir vous opérer demain sous anesthésie ». Nous nous sommes rendues le lendemain matin. Deux médecins très compétents lui enlevèrent 3/4 de tasse de sang « coagulé ». Ça faisait toute une plaie. Deux heures après, je la ramenais à la maison. Elle passa trois jours sans marcher, puis deux fois la semaine, nous allions à l'hôpital pour que le médecin lui change son pansement. Durant quatre semaines, nous faisions deux visites à l'hôpital. Au dernier pansement, le médecin l'examina très soigneusement et d'un air tragique dit: « Mlle vous faites de l'infection dans votre plaie. Après-midi je vous envoie à l'hôpital Ste-Agathe, ils sont mieux équipés que nous ici à l'Annonciation ». Quel choc! Pour elle et pour moi, qui n'avait pas fini ma convalescence. Il n'en était plus question. Il me fallait agir rapidement. Je demandai à Florida de m'accompagner. Pour combien de temps? Nous ne le savions pas. Tout d'abord un diabétologue s'en est occupé. Un régime de 1,000 calories seulement lui fut prescrit. Elle était « isolée » dans une chambre seule pour prévenir la contagion. Sa plaie était désinfectée tous les jours. « Probablement que nous serons contraints de vous faire une greffe » dirent les médecins. Elle s'ennuyait énormément. Après trois semaines, le médecin lui dit: « Vous allez retourner chez vous, continuer de vous tremper la jambe dans une solution spéciale, deux fois par jour ». Elle mettait sa jambe dans une chaudière remplie d'eau solutionnée, une demi-heure chaque fois. Après deux semaines de ce traitement chez nous, sa plaie commençait à manifester un signe de guérison. Au bout d'un mois, une visite chez son médecin nous apprit que la greffe serait évitée. La guérison suivrait son cours normal. Bravo! Nous étions bien contentes. Il fallait quand même que ma sœur prenne certaines précautions. Lorsque je pris ma retraite, j'avais fait le rêve de voyager avec ma sœur. Cet incident imprévu venait perturber la réalisation de ce désir. Je devrai peut-être en faire mon deuil ou ce n'est que partie remise ! L'avenir nous l'apprendra.
Durant l'été 1972, mon frère Fortunat sur la demande de ma sœur avait accepté de faire certaines rénovations à la maison de ma sœur au village. Point de locataires durant un an pour de grandes améliorations. Mon frère ajusta toutes les fenêtres des deux logements et installa une chambre de bain au 2e étage. Électricité, plomberie, menuiserie, tous ces gens de métier y ont travaillé. Lorsque vint l'automne, mon frère retourna à Montréal. Il fallut continuer avec un autre menuisier, M. Eugène Croisetière qui a travaillé tout l'hiver. J'ai dû m'occuper de l'organisation car ma sœur ne se sentait pas en forme pour tous ces déplacements. Je faisais donc la navette entre notre résidence et le village pour voir aux différents achats que nécessitaient les améliorations requises. Tout fut terminé pour le printemps en avril.
En 1973, rien d'extraordinaire ne s'est produit, si ce n'est que Normand fréquenta l'école de Mont- Laurier pensionnaire à la semaine, du lundi matin au vendredi. Durant trois années, ce fut le lieu de ses études. Son absence nous dérangeait, nous nous sommes organisées autrement. À partir de la fin novembre, nous placions nos animaux en pension jusqu'au début mai. Nous nous accordions un peu de repos pour la saison hivernale.
Nous sommes victimes d’un « hold up » (1974)
L’année 1974 restera marquée longtemps dans nos mémoires en raison du vol à main armée dont nous avons été victimes ma sœur et moi, le 28 janvier au soir, vers 8 1/4 heures. Pénible expérience à vivre dans une résidence privée. Les deux « mauvais drôles » n'ont pas pénétré par effraction. Ils ont frappé à la porte et moi, sans méfiance, j'ai l’ai déverrouillé. Ils sont entrés en vitesse. J'ai aperçu l'arme à feu, j'ai reculé jusqu'au divan. Je suis demeurée debout sans bouger. Je n'ai pas l'intention de tout raconter, sauf que les mutins m'ont volé $150 et mon automobile. Ils m'ont contrainte à leur remettre mes clés et ils sont partis. Heureusement qu'ils ne nous ont pas molestées. Ma sœur ne bougea pas de son fauteuil, elle était « sidérée ». Les bandits furent arrêtés par les policiers trois semaines après leur forfait à St-Eustache. Je n'ai jamais retrouvé mon porte-monnaie avec toutes mes cartes importantes, ni mes clés de voiture. Quel trouble ce malheureux incident nous a causé physiquement et moralement. Une telle aventure ne s'oublie pas. La santé de ma sœur se détériore encore une fois (1975).
À l'automne de cette même année, la santé de ma sœur se détériorait. Elle était si faible qu'elle ne mangeait plus. Elle fut hospitalisée à l'Annonciation à l'hôpital des Laurentides. Elle y séjourna presque un mois. On lui donna du sérum, ce qui lui permit de récupérer plus vite. Je lui rendais visite tous les deux soirs. Son diabète se contrôlait assez bien, son hypertension aussi mais son organisme en général était déficient. L'outrage des ans se faisait sentir. Elle obtint son congé, je la ramène à la maison pour une convalescence plus fortifiante. À la maison, on acquiert plus de force qu'à l'hôpital. Elle était si heureuse d'être au milieu de ses choses. Elle prenait beaucoup de repos, faisait quelques menus travaux, mais très peu. L'hiver se passa bien. Au printemps assez avancé, fin avril, ses muscles étaient moins flexibles, sa démarche plus lente, ses forces diminuaient. C'est normal l'hiver nous affaiblit, nous manquons d'oxygène.
Nous étions en 1975. Dans les premiers jours de mai, le
médecin souhaitait un examen général du sang pour ma sœur, afin de lui
prescrire un médicament particulier à son état. Nous allons l'hospitaliser et
un hématologiste étudiera son cas. En l’occurrence c’était le Docteur Robert Péloquin de Nominingue attaché à plusieurs hôpitaux de la
région pour exercer sa spécialité. Malgré son manque de désir de retourner à
l'hôpital, elle partit courageusement, confiante qu'elle reviendrait plus
forte. En effet, elle souffrait d'anémie assez grave et ses reins étaient
malades. Ce résultat n'était pas très réjouissant. Pendant son absence, j'ai
demandé à Monsieur Eugène Croisetière de faire
quelques améliorations pour rafraîchir notre maison, la rendre plus attrayante.
Je fis peinturer plusieurs appartements. Avec l'aide de Normand, le grand
ménage se fit rapidement. Tout reluisit de propreté. Je voulais que notre foyer
dégage une atmosphère chaleureuse et accueillante pour son retour. Elle fit un
séjour de trois semaines. J'allai la chercher avec Normand pour qu'il l'aide à
embarquer, et ici pour la débarquer, il la prenait dans ses bras et la déposait
dans la berceuse. Cela la faisait sourire. Il était si fort. Lorsqu'elle
constata les transformations exécutées dans la maison, elle en fut émerveillée!
« Comme on est bien chez nous » s'écria-t-elle! Elle jouissait du
bien-être de son environnement. Ça paraissait dans ses yeux. Quel grand
réconfort pour moi! Hélas! sa santé n'était pas de
tout repos. De plus en plus, elle avait moins de facilité à se déplacer. Ce
n'est pas le vieillissement qui cause cet état, c'est sa maladie
impitoyable : le diabète.
Ma sœur souffrait de diabète depuis 1949. Elle observait un régime très sévère car il n'y avait aucun médicament sur le marché pour aider à contrôler cette fameuse maladie. De plus, elle faisait de l'hypertension. Rien ne l'empêchait de travailler quand même. Un jour qu'elle allait au bureau du médecin, celui-ci lui dit: « Bonne nouvelle pour vous. mademoiselle, un nouveau médicament est maintenant disponible pour soulager le diabète. Je vous en prescris immédiatement ». Il n'y avait pas de pharmacie, c'était le médecin qui vendait les médicaments. Son régime était à observer quand même, ce médicament procurait un bon effet physique, une influence très favorable sur le moral. Je l'entourais de soins méticuleux, elle le méritait tellement.
En juillet 1977, elle commença à prendre des injections de B12 pour l'anémie. Avec sa « marchette » ou sa canne, elle se promenait dans le chemin ou sur notre grande galerie. Elle s'émerveillait encore de la beauté du paysage, des mille petits bruits de la nature, du chant des oiseaux, etc. Elle aimait encore la vie.
En novembre, il se produisit une autre complication. Elle n'avait plus d'appétit, et parfois elle avait des nausées. J'en ai parlé au médecin qui me répondit: « II va falloir l'hospitaliser encore, elle élimine la moitié des protéines de son corps par le rein. C'est pour cette raison qu'elle est d'une si grande faiblesse. Elle a les reins plus malades que le pancréas ». En effet, elle était presque normale de son sucre. Il est important de dire que le traitement subi à l'hôpital différait totalement des autres déjà reçus précédemment. Pas de sérum plutôt un surplus d'aliments sans s'occuper de son régime diabétique, afin que son organisme récupère par lui-même. Avant son retour à la maison, on lui donna les pilules qu'elle avait l'habitude d'absorber pour son diabète. Les médecins ne réussirent pas à l'équilibrer. Alors, on décida de lui injecter de l'insuline qu'elle n'avait jamais utilisée pendant 28 années de diabète. J'en fus très étonnée, mais il faut obéir à la médecine.
Depuis septembre, Normand fréquentait l'école de l'Annonciation. Il revenait donc chez nous tous les soirs. C'était beaucoup plus sécuritaire pour moi. Le 2 décembre, Élisabeth revenait à la maison. J'allai la chercher avec Normand. Elle semblait en meilleure condition de vie. Elle était gaie et détendue. Une chose m'inquiétait cependant, la prescription des unités d'insuline, étant donné son état de faiblesse générale.
Tout alla très bien jusqu'en date du 16 décembre à l'heure du midi. J'avais préparé une bonne soupe, je l'appelai pour venir dîner. Elle se couchait chaque avant-midi. Je l'appelai une seconde fois, encore sans réponse. Je me précipitai dans sa chambre, là, je l'aperçus en grande transpiration, le visage ruisselant de sueurs. « Qu'est-ce que tu as »? lui demandai-je. D'une voix inintelligible: « Je ne sais pas » dit-elle. « Je vais te donner du jus d'orange ». Lorsque je revins, elle était déjà inconsciente, la respiration haletante. Je savais qu'elle manquait de sucre. Elle était victime d'un coma hypoglycémique. Sur le champs, j'appelai l'ambulance pour la transporter à l'hôpital. « Allez, je vous prie » leur dis-je. «Je prépare ses effets personnels et je vous rejoins à l'hôpital ». Elle demeura « quatre » heures dans le coma. Je me sentais une véritable « automate » n'osant penser à ce qui pourrait arriver. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, j'étais auprès d'elle. On lui avait fait une prise de sang pour déterminer sa glycémie. A quel taux était-elle croyez-vous? Incroyable, mais véridique! « 14 ». Le normal est entre 80 et 120 degrés. Elle aurait pu mourir ou demeurer totalement paralysée. Dieu et la Ste-Vierge m'ont préservée de cette épreuve. Elle avait paralysé un peu du côté droit, pas pour l'empêcher de bouger ni de marcher. Son cerveau, ayant manqué de sucre et d'oxygène, était un peu endommagé. Elle ne pouvait exprimer tout ce qu'elle désirait.
Ce fut un triste jour, ce Noël 1975. Je passai tout l'après-midi auprès d'elle à l'hôpital et le soir j'étais seule avec Normand. Il fut bien gentil avec moi, il ne me laissa pas du tout. Nous nous sommes échangés des cadeaux, pour ma part le cœur n'y était pas. Il fallait que je m'oublie pour pas que la tristesse règne dans la maison. Je lui avais offert un beau petit radio en cadeau. Il était comblé car il aimait beaucoup la musique. Je m'efforçais de lui rendre la vie agréable. Entre Noël et le Jour de l'An, j'insistai auprès des médecins pour qu'Élisabeth vienne passer le Jour de l'An chez nous à la maison. Je constatais qu'elle s'ennuyait. Elle ne demandait rien aux infirmières. Les médecins consentirent à condition de venir la reconduire à l'hôpital le lendemain du Jour de l'An. La veille nous sommes venus la chercher Normand et moi. Lorsqu'elle arriva dans notre chambre, elle se jeta sur le lit et dormit quatre heures sans arrêt, tellement elle se sentait en confiance, en sécurité. Quelle émotion fut la mienne!
Une tristesse profonde envahit notre âme en constatant qu'un être cher qui fût rempli de capacités physiques en ayant une vie très active, tout à coup sombre dans l'impuissance totale. Nous sommes là, spectateurs impassibles, sans pouvoir rien changer. Quelle affliction! Le 1er janvier 1976, nous étions réunies ma sœur et moi. Pour combien de temps? La pensée qui m'obsédait n'était pas très gaie. J'ai fait bonne figure quand même, pour ma sœur et pour Normand. Ils étaient en appétit tous les deux.
Le lendemain après-midi, il fallait la reconduire. Je me demandais: « Comment vais-je lui annoncer ce nouveau départ »? Elle m'a facilité la tâche en disant elle-même: « II faut encore retourner là-bas »? « Oui, nous l'avons promis, mais c’est seulement pour quelques jours ». Je l'ai trouvé bien courageuse.
En effet, le 6 janvier, elle revenait pour de bon. Son état de santé exigeait beaucoup de soins et d'attention. Je m'en accommodais bien, au moins j'avais « sa présence ». C’est tout ce qui comptait pour moi. La nuit comme le jour, j'accomplissais ses moindres désirs. Elle était d'une grande docilité, elle s'en remettait totalement à ma volonté. Elle avait été une deuxième mère pour moi. Elle m'avait tant choyée lorsque j'étais jeune ou malade. C'était à mon tour de lui faire des actes de bonté, de bienveillance. Ce que je fis avec tendresse. Lui faire sa toilette, l'aider à s'habiller ou à se déshabiller, etc. J'eus beaucoup de chagrin lorsque je constatai qu'elle ne pouvait plus lire. Sa vue avait diminué mais c'était surtout qu'elle ne pouvait « enchaîner » les lettres. La cause: avoir manqué de sucre au cerveau. Pour écrire son nom, je devais lui faire un exemple, il ne fallait pas que la durée soit trop longue. Signer un chèque ou un reçu, elle réussissait bien. Je l'encourageais toujours, lui répétant sans cesse: « Continue, tu fais des progrès », alors, elle me souriait.
Mais, un événement aussi grave qu'imprévu nous enleva notre sécurité. Au mois de mai, vers le 20, Normand décida de nous quitter sans avertissement au temps où nous en avions un besoin urgent. Il avait subi de mauvaises influences, il n'y avait rien, ni personne qui puisse lui faire changer d'idée. Élisabeth a eu beaucoup de peine de son départ. Et moi donc! Nous avions tant d'attachement et d'affection pour lui. Pourtant nous l'avions bien traité, même choyé. Il avait toujours été gentil pour nous. Nous étions atterrées de ce brusque départ. Il avant seize ans et ça faisait cinq ans qu'il demeurait chez nous. Nous lui avions répété souvent : « Tu seras toujours chez-vous ici, tu es maintenant de la famille ». J'étais tellement angoissée à la pensée que lorsque ma sœur me quitterait, je serais seule. Elle était si gravement malade qu'elle ne pouvait vivre très longtemps. Hélas! brusquement, je devais faire le deuil de mes illusions. Lorsque mon travail me retenait à l'extérieur, j'étais constamment inquiète. Je lui recommandais d'être très prudente dans ses déplacements.
Vers la fin du mois d'août (1976), je réalisai qu'elle perdait des forces, elle avait moins d'équilibre. « Elle achevait sa journée » pour employer l'expression colorée de monsieur le Curé Poulin qui depuis un an venait régulièrement faire une visite chez nous, tous les premiers vendredis du mois et apporter la communion à ma sœur et à moi en même temps. Les paroles réconfortantes qu'il nous adressait, produisaient un baume dans nos âmes tourmentées. La foi redonne l'espoir. Le 6 septembre, ce fut sa dernière visite car il quittait la paroisse, son terme étant expiré. Il prolongea la conversation après nous avoir distribué la communion. "Avant de vous quitter" dit-il à ma sœur, « je vais vous lire une prière spéciale qui vous aidera pour une meilleure acceptation de votre maladie ». Je n'avais jamais entendu une prière aussi touchante portant à la réflexion sur « l'au-delà ». L'émotion nous gagnait toutes les deux.
Un accident banal qui cause le décès de ma sœur Élizabeth (1976)
Le 14 septembre, il faisait un temps superbe. Cette année-là, la gelée était venue tôt. Les arbres avaient revêtu leur costume automnal. Les feuilles multicolores donnaient aux montagnes un paysage d'une beauté féerique. Élisabeth me dit: « Lucille, que j'aimerais donc faire une visite à nos chalets et voir le lac des Grandes-Baies » ! Je fis le trajet lentement pour mieux admirer la nature. Arrivée au chalet, je l'installai confortablement dans la véranda en face du lac. J'avais apporté des fruits, de la liqueur, des biscuits que je déposai sur la petite table devant sa berceuse. De cette hauteur, le panorama était splendide, le lac calme avec une petite brise légère. « Repose-toi », lui dis-je, « fais la touriste. Je vais descendre au chalet 3 pour voir si tout est à l'ordre ».
Après deux heures, je remontai au premier chalet; elle avait la visite de François Vachet qui demeurait tout près. Il jasa quelques minutes avec moi, puis il partit. Nous aussi c'était l'heure de revenir à la ferme. Quand elle se leva de sa chaise, ses muscles étaient raides. Je ferme le chalet et je lui prends le bras pour monter l'escalier qui menait à l'auto, elle s'appuya à la rampe du côté droit et moi je la soutenais du bras gauche. En arrivant en haut de l'escalier, elle me part du bras et tombe. Je la tenais bien pourtant, elle venait de mettre le bout du pied droit sur une petite roche. Elle tomba, le genou droit par en dedans, ce qui lui a été fatal. « Je me suis fait mal » dit-elle. J'essayai de la relever, impossible, elle ne pouvait pas s'aider du tout. Je lui dis : « Reste assis dans l'herbe je vais aller chercher François ». Je pris la voiture, arrivée chez lui je ne le voyais pas. J'appelai bien fort, tout à coup, il apparut. « J'ai besoin de toi », lui dis-je. « Élisabeth est tombée, je ne suis pas capable de la relever ». Il vint avec moi, la prit dans ses bras pour la porter dans la voiture. Quand elle fut assise, ça lui faisait moins mal. Je craignais une fracture. À cause de ses nombreuses maladies, ses os étaient devenus d'une extrême fragilité. Durant le trajet, je lui dis: « Je vais te conduire à l'urgence, on ne sait jamais! » « Non, non » répondit-elle, « je veux demeurer à la maison ». Avant de quitter le chalet, François m'a demandé si j'avais quelqu'un pour la débarquer? Je dis non. ' 'Alors je vais vous suivre avec ma camionnette". « Tu nous rends un immense service » lui dis-je. Arrivée chez nous, j'allai préparer le lit. Il la prit délicatement dans ses bras et vint la déposer dans le lit. En le remerciant, Élisabeth lui dit un bonjour si triste qui ressemblait à un adieu. François sortit très ému. Il me fit voir qu'elle prévoyait la fin.
Elle fut très souffrante durant la nuit ne sachant quelle position prendre. Le lendemain matin, elle avait la cuisse enflée. C’était une journée de clinique, alors je demandai au docteur Dubé de venir la voir. Ce qu'il fit dans la soirée ayant eu trop de patients à son bureau. En la voyant, il osa prédire une belle fracture. « Il faut qu'elle passe des radiographies » dit-il « et si c'est vraiment une fracture comme je le prévois, nous ne pourrons pas la garder à l'Annonciation, nous ne sommes pas équipés pour traiter les fractures ». "Faites venir l'ambulance demain matin, je l'attendrai à la chambre de la radiographie et si la fracture est confirmée, vous continuerez jusqu'à l'hôpital Hôtel-Dieu de St-Jérome. C'est là qu'elle sera le mieux traitée. Je vais préparer son dossier que vous apporterez avec vous. J'exécutai les ordres. Après le verdict du médecin, ma sœur réussit à se placer pour ne pas trop souffrir; elle s'endormit tout près de moi et ne bougea pas de la nuit. Elle avait reposé mieux. Moi, très peu. Borromée s'était rendu tôt le matin pour garder la maison durant mon absence, lui qui était venu m'aider plusieurs fois durant l'été après le départ de Normand.
Je quittai aussitôt après l'ambulance avec, encore une fois, la valise des effets personnels de ma sœur. Arrivée à l'hôpital, le médecin vint à moi et me dit: « C'est bien ce que je prévoyais c'est une fracture. Voici son dossier, filez sans plus tarder à St-Jérome. C'est une opération qu'elle va subir et je me demande si elle pourra supporter l'anesthésie. Il me donnait un grave avertissement. J'embarquai avec elle dans l'ambulance, ma présence lui était nécessaire. Je la trouvais à la fois courageuse et résignée. Elle voulait survivre. Nous sommes arrivés à St-Jérome à l'heure du midi. Elle avait mangé très peu le matin, elle put donc passer des tests presque en arrivant. Je signai tous les documents obligatoires mais je ne vis pas sa chambre; elle était demeurée à la salle d'urgence. Je revenais avec l'ambulance, je ne suis pas demeurée longtemps. Avant de nous dire « bonjour » elle eut la pensée de cette phrase: « N'oublie pas de dîner, tu dois avoir faim, fais attention à toi » ! J'avais le cœur gros de chagrin lorsque je la quittai c’était si loin, qu'adviendrait-il maintenant? Je l'ai recommandée au « Très-Haut », Maître de nos vies et à la Ste-Vierge. Je n'avais qu'à attendre.
Revenue chez-moi, j'ai téléphoné la nouvelle à Jacques qui enseignait à St-Jérome et demeure à Bois Briand. Le lendemain soir, Jacques accompagné de sa femme Lorraine sont allés la voir. Elle avait la jambe dans le plâtre jusqu'au milieu de la cuisse. Elle les a très bien reconnus et leur donna quelques nouvelles, même si elle ne pouvait pas dire tout ce qu'elle voulait. Les mots parfois lui manquaient. Le lendemain, Jacques vint à Nominingue et m'offrit de retourner avec lui pour aller rendre visite à Élisabeth le soir même. La chambre qu'elle occupait n'était pas très confortable. Elle était bien heureuse de me voir. Je remarquai qu'elle était "essoufflée". Je suis allée à la réception avec mon neveu pour lui obtenir une autre de chambre. Ce que la direction accepta. Nous allons la « transférer » demain matin dans une semi-privée. Elle avait l'os de la cuisse brisé.
Les dernières heures d’Élizabeth
Le lendemain, dimanche, ce fut mon neveu Marcel de Rosemère qui me conduisit à l'hôpital. Surprise lamentable, elle avait tellement changé depuis la veille, respiration difficile avec plaintes intermittentes, jambe suspendue. Elle ne pouvait pas bouger sans aide. Je reçus un choc en plein cœur, j'avais la certitude qu'elle ne pourrait pas subir l'opération, que sa vie tenait à un fil qui allait bientôt être coupé. L'hôpital lui avait donné deux transfusions de sang pour améliorer le sien qui n'était pas adéquat pour l'opération. Ça lui faisait un surplus de sang qu'elle n'a pas pu assimiler. Son cœur s'est trouvé surchargé. Elle avait sûrement pris un refroidissement. Marcel aborda le médecin qui lui affirma qu’une personne âgée qui avait une grave fracture s'en remet rarement. "Nous surveillons son cœur". J'aurais voulu demeurer avec elle, la direction ne pouvait le permettre. Je pris l'autobus pour revenir à la maison très tard vers 11 heures. Mes frères étaient anxieux de connaître le résultat de ma visite. "Ça va très mal" leur dis-je.
Le lendemain avant- midi, vers 11 1/4 heures, elle rendit l'âme. Personne de sa famille n'était auprès d'elle. Que le destin est donc cruel parfois. Je me suis bien culpabilisée. À quoi bon ! La grande faucheuse venait de me ravir ma compagne avec laquelle j'avais vécu 63 ans pour le meilleur et pour le pire. Je connus l'étape la plus cruciale et dramatique de ma vie. On a beau se préparer à cette épreuve mais lorsqu'elle nous atteint, il n'y a pas de mots pour traduire nos sentiments. Le vide est si grand. Six jours après l'accident, elle décédait le 20 septembre 1976 à l'âge de 75 ans 2 mois 20 jours.
Sa maladie fut longue. Elle nous a donné à tous une leçon de patience, de résignation et d'espérance aussi. Elle n'abandonna jamais le désir de vivre. Ce qui contribuait à me stimuler pour lui prodiguer les meilleurs soins de tous les instants. La mort est inévitable. J'abrège plusieurs détails, ça ne fait que six ans et demi, la plupart s'en souviennent. Jusqu'aux obsèques, il faut déployer une force de caractère insoupçonnable. Mes frères et mes neveux me furent d'un précieux secours. Je ne l'oublierai jamais. J'ai traversé cette pénible semaine sans « flancher ». Je me suis oubliée totalement. Ma cousine Fernande m'accorda sa présence jusqu'au dimanche. Je suis allée la reconduire au train dans l'après-midi.
En revenant à ma demeure, je sentais une angoisse insurmontable m'envahir. et en pénétrant dans la maison, j'avais le désir de me défouler par les larmes mais une voix intérieure me l'interdit. Une chaleur spirituelle m'enveloppait pour me convaincre que la « communion des Saints » existe vraiment. Je ne me sentais pas seule. Je vais traduire mon état d'âme par cette admirable pensée d'Alexandre Dumas: « Ceux que nous avons aimés que nous avons perdus ne sont plus où ils étaient, mais ils sont toujours et partout où nous sommes ». Quelles paroles véridiques et pleines d'espérance. Je l'ai constaté maintes fois! Il y a des moments difficiles à passer mais avec la persévérance, on y arrive. « Le temps » est un facteur très important pour atténuer le vide d'un grand départ. En terminant ce triste récit, j'aimerais graver dans votre mémoire un poème que j'aime beaucoup. En hommage à son Souvenir.

Ma Sœur Élizabeth
Ma sœur était là, attentive
À tout m'expliquer avec son grand cœur,
Depuis les travaux de la ferme active
Jusqu'à la chanson de l'oiseau moqueur.
Ma sœur n'est plus, et l'herbe vivace
Pousse sur sa tombe, et dans le jardin,
Où chaque saison un peu plus efface
Son doux souvenir déjà si lointain.
Ma sœur! L'écho se tait.
La nuit voile
Le jardin désert, la maison sans feu..
Mais sur le coteau s'allume une étoile:
Est-ce toi, ma sœur, aux jardins de Dieu?
Les mois suivants, les « affaires » me réclamaient sans répit. Règlement de la succession, transfert de nom, cartes de remerciements, souvenirs mortuaires, etc. Je n'avais pas le temps de m'apitoyer sur mon sort. C'était mieux ainsi. Les fêtes arrivèrent. L'année précédente, nous étions « trois » et là j'étais seule, c'était difficile d'être gaie. Cependant la Providence me réservait une heureuse surprise! Nos sympathiques voisins Monsieur et Madame Marcel Chartrand m'invitèrent à partager leur souper de Noël! Guy, leur fils, vint me chercher et me reconduire après la veillée. Comme c'était bon de prendre part aux joies d'une famille unie. Pour plusieurs « Noël » suivants, c'était devenu une tradition, je n'oublierai jamais ce geste amical de toute la famille! Le Jour de l'An, je le passai dans ma famille, c'est-à-dire chez Borromée où le souper traditionnel avait lieu pour leurs enfants et petits-enfants. C’était bon de se retrouver ensemble pour festoyer, et faire du chant, de la musique et même de la danse.
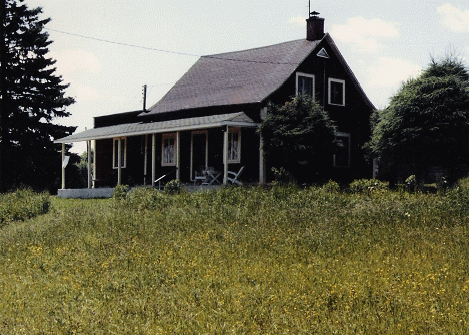
La maison familiale, construite en 1894, rénovée
en 1932, revêtement en 1948.
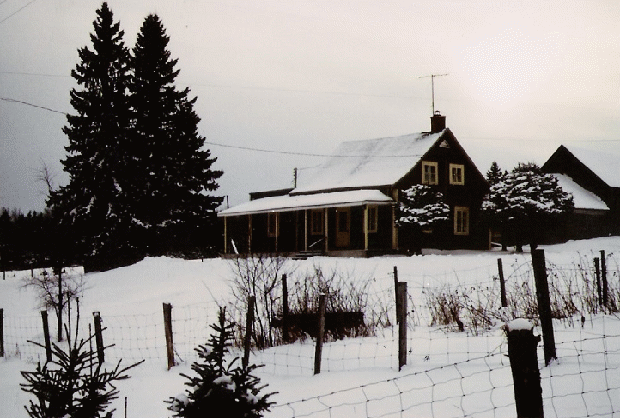
Maison, scène d'hiver
Retour à la table des matières